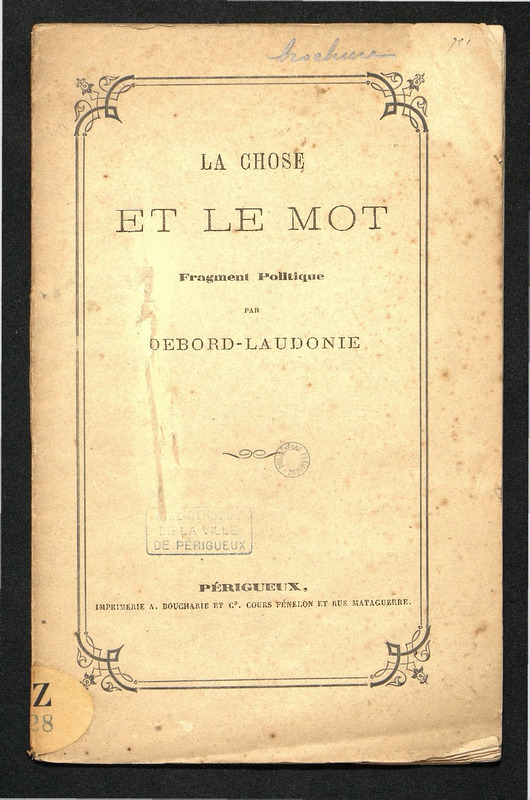FRB243226101PZ-528.pdf
Médias
Fait partie de La chose et le mot : fragment politique
- extracted text
-
LA CHOSE
ET LE MOT
Fragment Politique
PAR
DEBORD-LAUDONIE
PÉRIGUEUX ,
IMPRIMERIE A. BOUCHARIE ET C°. COURS FENELON ET RUE MATACUERRE.
LA CHOSE
ET LE MOT
Fragment Politique
DEBORD-LAUDONIE
PÉRIGUEUX ,
IMPRIMERIE A. BOUCHARIE ET Ce. COURS FÉNELON ET RUE MATAGUERRE.
y
LA CHOSE ET LE MOT
Fragment Politique.
Depuis quelle se meut dans le milieu troublé où il a plu
à l’ordonnateur des mondes de la faire naître, la société fran
çaise, ignorante ou docile, a eu pour habituel de se payer de
mots. Ceux qui l’en ont tour à tour bercée se sont servis de
différentes appellations, selon le temps et les circonstances.
Mais s’ils ont fréquemment changé leur enseigne, ils n’en ont
pas moins concurremment participé, qu’ils l’aient voulu par
entraînement généreux ou que la force même des choses les
y ait contraints, à la satisfaction des besoins toujours grandis
sants de l’humanité.
Cette transformation non interrompue d’une condition im
parfaite en une autre plus équitable et meilleure, qu’elle se soit
accomplie au commencement de notre ère, en plein moyenâge, sous la monarchie absolue, sous la royauté constitution
nelle, sous la république ou l’Empire, se nomme de son vrai
nom la Révolution-.
Il ne faudrait donc pas s’effrayer du mot, puisque la chose
se retrouve à toute époque et à tous les âges, remplissant pro
videntiellement sa mission.
On le niera peut-être ?
Il importe alors d’ouvrir l’histoire et de s’éclairer de son
flambeau.
Quelques lignes rapides nous suffiront. Le cadre que nous
nous sommes tracé dans ce travail ne comporte, en effet, ni
de longs développements, ni une étude régulière et servile.
En eussions-nous le désir, nous n’en aurions pas les forces.
Au point de vue spécial de notre thèse, il n’est besoin, du
reste, que d’un aperçu très-sommaire et, pour ainsi parler, à
vol d’oiseau. Nous estimons que notre tâche sera pleinement
remplie, si nous établissons à grands traits que l’esprit révo
lutionnaire a laissé partout son empreinte, et qu’il a été par
tout réparateur.
À ce propos, que l’on nous permette une observation.
Ordinairement, on donne, dans le monde, au mot Révolu
tion, une signification qui n’est pas la sienne : ceux-ci par
ignorance et de bonne foi, ceux-là par rancune, d’autres par
faux calcul. On croit, ou l’on affecte de penser que le mot
Révolution veut uniquement dire bouleversement et ruine.
On se trompe ou l’on veut tromper. La Révolution ne détruit
pas pour détruire ; elle ne renverse que pour mieux fonder :
c’est l’expression d’un besoin social. Toutes les fois que ce
besoin surgit et que l’on met obstacle à son accomplissement,
il en résulte une révolution. Et plus la résistance est tenace,
plus les déchirements sont profonds.
Mais, à qui la faute? et sur qui faut-il en faire peser la
responsabilité formidable ? Est-ce sur le gouvernement qui
ne peut affirmer son droit que par ses services? ou bien sur le
gouverné qui en est venu, par de successifs mécomptes,
jusqu’à lui en contester l’efficacité ou la suffisance ?
*
Evidemment sur celui des deux qui s’est acharné à la rou
tine et qui a voulu empêcher l’effectuation d’une plus grande
somme de bien-être général.
— 5 —
Ce principe établi, poursuivons.
IL
En ouvrant la première page de nos annales, nous voyons
que des peuplades sauvages couvraient primitivement le sol
gaulois. A leur tête, comme chef religieux, et souvent aussi
comme chef militaire, il y avait le Druide sacrificateur de
victimes humaines. C’est le point de départ.
La conquête romaine n’apporta pas, dans l’ordre moral, de
notables changements à cet état de choses. Les Druides conti
nuèrent de se livrer, presque sous ses yeux, à leurs pratiques
sanglantes, et c’est en vain quelle essaya, non de les in
quiéter, mais de les détruire. L’honneur de cette destruction
devait appartenir au christianisme, qui réalisa seul ce que
n’avaient pu faire César et ses successeurs plus ou moins in
dignes.
Ainsi, le christianisme apparaît sur la scène du monde en
même temps que la révolution, ou plutôt c’est le christianisme
qui l’y introduit. Et c’est à la lumière de son foyer que vien
dront se fortifier et s’éclairer, en s’échelonnant à travers les
siècles, la plupart des hommes de patriotisme et de foi des
tinés par la Providence à être l’avant-garde de la civilisa
tion.
III
Un barbare devenu chrétien, Clovis, mit le premier une
main robuste sur le chaos des temps primitifs. A ses mœurs
•demeurées farouches, on a soupçonné avec vraisemblance
que sa conversion était calculée plutôt que sincère. Au vrai,
c’est qu’il s’appuya sur l’Eglise et sur sa force morale nais
sante pour fonder l’empire franc, ce à quoi, sans elle, il
ne serait point arrivé.
Les temps qui suivirent la mort de Clovis jusqu’à Charle
magne sont, à bon droit, considérés comme la période la plus
affligeante de notre histoire. On ne voit de tous côtés quebri-
— 6 —
gandage, spoliation, et meurtres. Charlemagne lui-même, en
tant qu’homme d’épée; ne différa pas sensiblement des habi
tudes violentes de ses devanciers. Ce qui lui a fait une part
exceptionnellement grande, ce sont ses capitulaires. Le réfor
mateur de premier ordre se révèle à chaque page de ces
immortels règlements. Il s’y occupe de tout et de tous, parti
culièrement du pauvre et de l’opprimé. S’attaquant à l’or
ganisation subsistante, il s’applique à la modifier le plus qu’il
peut dans un sens d’équité et de justice, et les lois qu’il pro
mulgue sontdans leur ensemble un véritable avancement dans
le mieux.
Et par là se trouve légitimée l’usurpation de son père,
Pépin-le-Bref, car ce dernier des maires du palais eut raison
de poursuivre, et la papauté de favoriser la déchéance du der
nier des rois fainéans, puisqu’il devait résulter de cette dé
chéance quelque chose de réparateur et de salutaire.
IV.
Après Charlemagne, la civilisation semble rétrograder.
Pourtant, ce n’est plus la nuit, mais ce n’est pas non plus la
même clarté. Au demi-jour qu’il avait répandu succède un
crépuscule sombre et obscur. Son vaste empire, mal partagé
entre ses héritiers, engendre des complications et des guerres
qui aboutissent premièrement au traité de Verdun signé par
Charles-le-Chauve dans le courant du neuvième siècle, et en
second lieu à l’avènement, par l’élection, de Hugues Capet, ce
chef illustre d’une race noble et virile, qui existe encore et
qui n’a point dégénéré.
V.
Du traité de Verdun qui nous dépouilla du Rhin et des Alpes,
deux de nos naturelles frontières, date le commencement de
la féodalité. A partir de cette époque, le sol national se divise
partout en un nombre infini de petites principautés. Sans
lien entre eux, sans esprit aucun de solidarité sociale, les
seigneurs féodaux qui en avaient le gouvernement n’eurent
d’abord pour seul souci que leur intérêt propre, et rendirent
ainsi possible le succès de ces premières invasions normandes
dont le pays eut tant à souffrir. Heureusement qu’ils ne tar
dèrent point à se raviser. Comprenant que le salut de tous
dépendait de mutuels secours, ils s’empressèrent comme à
l’envi de construire ces châteaux fortifiés dont il subsiste encore
d’imposantes ruines, s’unirent patriotiquement contre l’en
nemi commun, et opposèrent de la sorte aux invasions subsé
quentes d’insurmontables barrières.
Ce fut le premier bienfait du régime féodal. Le second et le
plus important a été de resserrer les liens de la famille et de
placer la femme sur un piédestal d’où elle n’est plus des
cendue. „
Voilà son œuvre révolutionnaire et ses deux titres d’hon
neur. Il n’en eut pas d’autres. Ne reconnaissant pour frein
que la force, il tomba bientôt dans l’injustice ; n’aimant que
la guerre, dédaigneux du commerce et de l’industrie, ces
deux greniers d’abondance, il eut à essuyer d’affreuses fami
nes. Elles furent, au onzième siècle, si répétées et si meurtriè
res, qu’elles oblitérèrent le sens moral jusque dans ses racines
les plus profondes ! si bien et si complètement que plus d’un
haut baron, spadassin et pillard, ne négligeait pas de s’apos
ter, la nuit, au coin des chemins publics, pour détrousser les
passants attardés! si bien et si complètement que des légions
d’affamés se faisaient réciproquement la chasse pour se dévo
rer, et qu’il se trouva des gens pour vendre, à la face de
Dieu, et d’autres pour acheter, horrible pâture ! des lambeaux
de chair humaine !
De pareils excès, qui constituaient en défaut la conscience
universelle, devaient amener la chute d’un système pendant
lequel, si le progrès avança de quelques pas, la faiblesse eut
tout à redouter et beaucoup à souffrir des abus de la force
impunis et déchaînés.
L’Eglise, il est bon de le constater à son éternelle gloire,
lui porta courageusement des coups fort sensibles. C’est le
moment où elle a brillé avec le plus de splendeur et d’éclat.
Seule gardienne alors, vigilante et glorieuse, des travaux de
l’esprit, elle empruntait à ses lumières, relativement supérieu
res, au mieux qu’elles lui permettaient d’entrevoir et qu’elle
voulut accomplir, une autorité que rehaussait l’élévation de
sa doctrine, et dont elle tira parti.
Elle avait commencé par demander et par obtenir ce qui
fut appelé la Trêve de Dieu. A juste titre elle ambitionnait
davantage, et, soit inspiration d’en haut, soit calcul révolu
tionnaire profond, elle alla conseillant et prêchant, par l’or
gane de Pierre l’Ermite, la première croisade.
vII.
L’équité, le droit, la civilisation, doivent beaucoup aux
croisades. Elles provoquèrent le réveil du génie commercial
et industriel de la nation. Elles firent tout-à-coup surgir une
foule empressée de hardis spéculateurs : ceux-ci, les mar
chands, pour renouer avec le continent asiatique des relations
d’affaires, et ceux-là, les artisans, pour équiper les hommes
d’armes qui s’en allaient en guerre à la conquête du saintsépulcre.
Ce fut comme une fièvre de production et de labeur qui fit
affluer dans la main des uns et des autres, en récompense de
mutuels efforts, des masses énormes de numéraire.
Ce numéraire, qui créait une fortune mobilière à côté de la
fortune terrienne, partage exclusif des heureux du temps, on
dût songer à le garantir contre les entreprises de l’arbitraire.
De là, l’origine de ces associations ouvrières qui devinrent
promptement une force avec laquelle il fallut compter, et de
ces chartes communales qui se conquirent de proche en proche,
apportant l’ordre où existait le désordre, et refrénant partout
la violence.
Or, des chartes communales, des associations ouvrières,
— 9 —
deux fécondes choses, naquit cette société nouvelle, qualifiée
en principe de tiers état, et qui se nomme présentement la
Bourgeoisie.
VIII
Le mouvement rénovateur qui avait enfanté cette société
nouvelle trouva dans la royauté, dontelle favorisait les secrets
desseins, un auxiliaire intéressé et ardent. Il s’ensuivit que
le tiers-état et la royauté poursuivirent de concert l’amoin
drissement du pouvoir féodal dont ils avaient eu respective
ment à souffrir, bien que ce fût à des titres et à des degrés
différents. Ajoutons que ce résultat une fois atteint, la royauté,
devenue plus puissante, se hâta de faire défection à son allié
d’un jour et de confisquer à son profit le plus qu’elle pût des
franchises qu’elle l’avait aidé à conquérir.
Et si ce fut une trahison, dont le funèbre holocauste du 21
janvier 1793 sera comme l’expiation et le châtiment, ce ne
fut point un mal. Gela fut même profitable, car le tiers-état,
content d’être parvenu à sauvegarder sa richesse et à tenir en
échec ses anciens oppresseurs, faisait peu de cas de tout le reste.
Il n’avait pas encore rencontré sa voie, qu’il devait faire plus
tard si éclatante et si large, tandis que la royauté, en aspirant
à faire disparaître les divers groupements de petits états qui
se partageaient le territoire et à le transformer en une souve
raineté autonome ne dépendant que d’elle, marchait avec
résolution dans la sienne, et se trouvait de plus en intime
communion avec les besoins virtuels du temps.
Quoiqu’il en soit, elle a mis plus de quatre siècles pour
terminer son travail d’assimilation et d’unité. Pendant plus de
quatre siècles, la royauté, s’inspira donc imperturbablement
du génie révolutionnaire. Sans doute, et c'est là ce qui cons
titue l’infériorité morale de son œuvre, elle n’eut en perspec
tive que le développement continu de son autorité et de sa
puissance. Mais si, comme à la féodalité qu’elle vainquit, on
est en droit de lui reprocher des énormités de tout genre, on
doit aussi reconnaître que, par contre, elle précipita l’épa1
— 10 —
nouissement de réformes grandes et utiles, dont chacun de
nous bénéficie.
IX
Au treizième siècle, Philippe Auguste disposait déjà d’un
certain pouvoir. La royauté commençait à prendre son essor,
et à cheminer d’un pas assez ferme vers l’accomplissement de
ses destinées.
Saint Louis vint ensuite, qui introduisit dans l’administra
tion intérieure du royaume un esprit d’ordre, de régularité,
de droiture, qui valut à la couronne de France une autorité
morale toute nouvelle, et l’entoura d'un prestige qu’elle n’a
vait pas eu jusque-là.
En revanche, la guerre de cent ans, si préjudiciable à no
tre renommée militaire, le fut également à son extension.
Elle ne reprit son mouvement progressif que sous Charles
VII, après l’intervention presque miraculeuse de Jeanne
d’Arc, et surtout pendant le règne de Louis XI. Car il ne
faut pas se dissimuler qu’il ne soit dû beaucoup à ce déloyal
et méchant homme, dont les pratiques sans vergogne inspi
rent une répulsion instinctive et sollicitent l’ingratitude.
Sous un autre point de vue, et dans un autre ordre de
faits, la révolution est aussi redevable à François Ier. Datant
du seizième siècle, c’est-à-dire de la Renaissance, il aimait,
comme son époque, tout ce qui se rapporte aux choses de l’in
telligence et des arts. S’il ne put inspirer à la nation un goût
quelle avait, celui de l’étude, il eut au moins le mérite, peu
commun, de l’encourager. Or, c’est à l’étude et aux facultés
qu’elle développe, que ces travailleurs méprisés, dont les croi
sades firent la fortune et procurèrent des fructueux loisirs,
doivent d’être arrivés à l’exercice du principal rôle dans la
gestion des affaires publiques.
Mais le jour de leur entrée en scène dans de pareilles con
ditions devait encore éprouver de longs retardements. Après
une seconde éclipse occasionnée par les guerres de religion et
survenue pendant la régence de Catherine de Médicis et les
sinistres règnes de ses enfants, la royauté put de nouveau
reprendre avec un redoublement d’énergie sa marche ascen
dante. Henri IV, l’un des plus grands hommes qui aient
jamais revêtu un manteau royal, fit plus que de lui retrou
ver sa popularité perdue ; il en étendit les proportions, tandis
que Louis XIII, ou plutôt Richelieu, dans la première moitié
du dix-septième-siècle, et Louis XIV dans la seconde, firent
monter son pouvoir à un degré d’élévation d’où il ne pouvait
que péricliter.
Ce dernier, en effet, après le ministère cauteleux de
Mazarin et la régence tourmentée de sa mère, Anne d’Au
triche, s’empara dictatorialement de l’autorité souveraine.
Chacun se tut sous ce roi hautain et fort. Comme les petits et
les humbles, les plus grands seigneurs s’inclinèrent dans la
soumission et le respect. Louis XI avait taillé dans le vif
de leur puissance et y avait opéré de profondes blessures,
le roi Richelieu les avait inflexiblement réprimés par la hâche ou l’exil, Louis XIV les réduisit et les dompta. De son
règne date l’apogée dela monarchie absolue ou de droit di
vin. Ce fut l’exagération et la pléthore du principe d’autorité.
L’exagération de la bassesse signala le règne suivant. Le
régent d’abord, Louis XV ensuite, et avec eux la cour tout
entière, se livrèrent sans retenue et sans pudeur à des orgies
sans nom. Louis XIV avait été immoral, mais décent et con
tenu : eux furent cyniques. Les soupers du Palais Royal
demeureront célèbres dans les annales de la dépravation ; ils
n’y seront jamais dépassés. Le gentilhomme y troquait de
femme avec son égal, à l’éclat des flambeaux et au choc des
verres. Les grandes dames se laissaient faire, et ne deman
daient qu’à multiplier les échanges. Des prélats, revêtus de la
pourpre romaine, traînaient leur soutane dans cette boue et y
jouaient des rôles actifs.
Voilà pour le Palais-Royal.
Trianon s’éfforça d’atteindre à cette hauteur d’infâmie, et il
y parvint. Les intendantes de ce lupanar royal ont seules su
tout ce qu’elles ramassèrent ça et là de filles jeunes et belles,
••
— 12 —
quelquefois tout enfants, pour ranimer les sens blasés du
monarque impur que l’on a vu tomber de chute en chute jus
que dans les bras de la Dubarry.
A l’énormité de ces scandales se joignirent ou se perpétuè
rent des énormités d’un autre ordre. Les impôts demeuraient
inégalement répartis, la justice inégalement rendue ; les
lettres de cachet se multipliaient, non pour réprimer des rebel
les, mais pour satisfaire à de personnelles vengeances ; la
propriété elle-même était à découvert, et il se rencontra des
spéculateurs ignobles, parmi lesquels figuraitle roi, quinecraignirent pas d’accaparer les grains dans le but odieusement
intéressé de provoquer une hausse ; comme si la misère, trop
lente à se produire, avait eu besoin d’auxiliaires pour accom
plir plus sûrement ses lugubres ravages !
X
Le peuple souffrait dans sa foi, dans sa dignité, dans sa
faim. Il fit entendre de tels murmures qu’ils triomphèrent des
hésitations de la bourgeoisie. Pleine d’un enthousiasme long
temps contenu, éclairée, morale, animée passionnément du
rare désir d’être utile, elle trouva dans les plaintes légitimes
et indignées de ses frères plus malheureux comme la justi
fication anticipée de ce qu’elle allait tenter pour leur déli
vrance à ses risques et périls. Sentant sa force, et, en outre,
ayant enfin acquis la pleine conscience de son devoir, elle ne
différa, plus de se mettre bravement à l’œuvre ; car l’heure
était proche de la réparation, comme aussi, hélas ! des représailles.
Son labeur ne fut point stérile. Cela devait être. L’instru
ment dont elle se servit pour arriver à ses fins providentielles
avait été sanctifié par des mains divines. Celui qui l’employa
le premier, il y aura bientôt deux mille ans, se nommait Jésus
de Nazareth. Et après le fils du charpentier, des hommes
origine et de tendances bien diverses y ont eu successivement recours. Il n’y a pas jusqu’à Louis XIV lui-même, tout
despote qu’il fût, qui ne se soit fatalement montré révolution-
— 13 —
naire en favorisant l’industrie, le commerce et les lettres,
trois vigoureux agents de rénovation.
Et c’est pourquoi elle accomplit vite et bien de nécessaires
et grandes réformes.
Elle provoqua et obtint dans l’immortelle nuit du 4 août
1789 l’abolition des privilèges.
Elle s’empara de la question financière, et y rétablit l’ordre.
Elle fonda l’unité d’impôt, l’unité de législation, l’unité de
jurisprudence.
Elle reconnut le droit du pauvre au bénéfice de l’instruc
tion, et prit des mesures pour qu’il en jouît.
Elle émancipa la pensée.
En un mot, elle fit admettre et proclamer ce principe si
méconnu jusque-là et pourtant si vrai : que tous les hommes,
indistinctement, sont égaux.
Le programme de Turgot passait ainsi des régions de la
théorie dans le domainede la pratique. Là où ce grand minis
tre avait échoué, la Bourgoisie triomphait. Mais, par malheur,
son action prépondérante s’arrête à ce point. Imbue des doc
trines de Voltaire et de Montesquieu, de telles conquêtes lui
auraient provisoirement suffi. On les lui disputa. D’impru
dentes menaces, des résistances aussi téméraires qu’impuis
santes permirent aux adeptes du citoyen de Genève de s’em
parer de la situation.
Plus radicaux et plus osés, ils ne laissèrent pas que de
pousser à la république, sans se préoccuper des obstacles à vain
cre ni du sang qu’il fallait verser. Dès-lors, tout ce qu’il y a
d’exagéré ou de pervers dans tous les rangs de la société se
mêla du gouvernement, et y prit une part tragique. On dressa
l’échafaud en permanence. Le roi Louis XVI, homme inof
fensif et bon, qui n’avait jamais su ni concevoir, ni vouloir,
paya de son existence des torts qui ne lui étaient pas person
nels. D’autres têtes illustres tombèrent. lien tomba beaucoup.
Il y eut un moment, bientôt passé, quoiqu’il pèse encore d’un
injuste poids sur la popularité et l’expansion du libéralisme,
il y eut un moment où la populace affolée se rendit coupable
— 14 —
de lamentables atrocités. Elle voulut avoir, et elle eut, sasaintBarthélemy, comme la royauté avait eu la sienne , hideuses
toutes deux, mais la première, celle de Charles IX, moins
excusable et plus sanglante.
XI
Depuis cette époque mémorable et grande, dont les splen
dides clartés rachètent sans doute, mais ne font oublier ni
les sombres jours, ni les douloureux épisodes , plusieurs gou
vernements se sont succédé en France.
Celui de Napoléon Ier, qui ne respecta ni la dignité du ci
toyen, ni les droits de l’homme, qui fut à l’intérieur, autant
qu’il se peut, répressif et dominateur, mais auquel on doit
d’avoir consolidé les principes de la révolution, et répandu à
travers l’Europe l’idée si éminemment française de la rédemp
tion des peuples.
Celui de la Restauration, que l’étranger nous fit accepter,
mais envers lequel, malgré la honte de son origine et ses
fautes, il serait certainement équitable de se montrer moins
rigoureux, car la Restauration permit au pays de reprendre
haleine et lui octroya quelque liberté.
Celui de 1830, plus libéral et plus parfait, contre lequel
il serait difficile d’articuler un grief sérieux, si le roi juste et
sage qui en fut le chef s’était moinspréoccupé d’intérêts dynas
tiques, s’il avait eu un plus grand souci de l’honneur national,
et si, se souvenant davantage de son origine populaire, il
avait donné plus d’extension à la loi électorale.
Celui de 1848, qui satisfit à ce dernier besoin, mais en
outrepassant peut-être les bornes de ce qui était alors
raisonnablement pratiquable.
Enfin le gouvernement actuel, qui a consacré d’une ma
nière définitive le principe du suffrage universel et de la sou
veraineté nationale.
XII.
Il semble que, arrivée à ce terme, la Révolution n’ait
— 15 —
plus qu’à s’admirer dans son œuvre et à se reposer, comme
Dieu, dont elle est une émanation et un souffle. Mais, pour
quiconque voudra bien se livrer à un examen attentif, au lieu
de s’arrêter aux surfaces, et considérer d’un regard impartial
et froid le fond même de la situation présente, il sera aisé de
voir qu’il ne suffit pas de poser des principes, pour que leur
application s’ensuive, naturellement et de soi.
C’est, assurément, un immense progrès que le dogme,
hautement reconnu, de la souveraineté nationale. Cette con
quête marque l’aurore d’un changement radical dans les
futurs rapports des gouvernements et des peuples. Sous le
feu de ses vivifiants rayons, tous les vestiges encore debout
d’une organisation qui a dû s’effacer devant les besoins nou
veaux de la société moderne, après avoir eu sa phase utile,
sont destinés à se fondre dans une progression rapide. A une
date dont il serait peut-être plus facile de préciser l’échéance
que de s’y soustraire, les représentants de l’ordre public n’o
bligeront plus le pays , comme par le passé, au respect de
constitutions plus ou moins vicieuses; c’est, au contraire, le
pays qui les contiendra de maîtresse main dans l’obéissance et
la discipline, car, ou la logique même des choses nous échappe,
où il doit se faire que, essentiellement renouvelables, ils ne
soient plus un jour que les délégués fort dépendants de son
vouloir sans appel.
Toutefois, s’il nous est permis d’entrevoir les sommets éle
vés du haut desquels nos neveux découvriront sans doute de
nouvelles perspectives et de nouveaux horizons, il n’est point
probable qu’il nous soit donné d’y atteindre. Est-ce à dire
que tout espoir d’y parvenir nous soit interdit, et que, nous
laissant aller au sentiment de notre impuissance présumée., il
nous soit facultatif d’abandonner le progrès à son propre élan,
et de nous dispenser de lui venir en aide pour en précipiter
le développement?
Cherchez dans tous les milieux, en haut comme en bas,
dans la modeste habitation du pauvre comme dans les de
meures les plus splendides, même là, cherchez-y le cœur le
— 16 —
plus dépravé, cherchez-y l’intelligence la plus pervertie, et
je vous défie de trouver personne qui l’ose affirmer avec as
surance.
C’est que le travail et la lutte sont la double condition obli
gée de l’homme, et qu’il est de son devoir social de briser
toute barrière faisant obstacle au résultat qu’il poursuit : son
émancipation radicale. Hier, c’était avec le marteau démolis
seur et brutal de l’insurrection ; aujourd’hui, cela doit être
avec l’arme moins expéditive mais plus noble de la raison et
du droit.
C’est ainsi que chaque génération apporte à l’autre son
contingent de bienfaits effectifs ou d’efforts méritoires. Nous
devons à celle qui va suivre de lui apporter le nôtre.
XIII
A l’heure qu’il est, trois grandes choses manquent encore
au pays :
1° La liberté de se réunir, de parler et d’écrire ;
2° Une instruction publique suffisante ;
3° Des mœurs politiques.
Ces trois grandes choses sont, à un égal degré, nécessaires ;
elles se complètent l’une par l’autre, et la France ne sera plei
nement en possession d’elle-même que du moment de leur
existence simultanée.
On le comprend, le problème posé n’est pas de ceux que
l’on résout en un jour. L’instruction publique ne saurait
s’acquérir du soir au lendemain, et les mœurs politiques d’un
peuple ne s’obtiennent pas par décret. Il faut du temps et de
la liberté.
Donc, la liberté politique est le premier de nos besoins, de
même qu’il est le plus imprescriptible de nos droits. C’est
le moyen le plus efficace d’arriver promptement à l’améliora
tion morale et intellectuelle du citoyen. A proprement parler,
nous n’en connaissons pas d’autre. Continuer de le priver de
la faculté de se réunir et de discuter en commun de ses inté-
— 17 —
rêts, c’est vouloir sciemment le maintenir en un état sans fin
de minorité.
Si cette proposition est juste et fondée autant qu’elle nous
paraît l’être, ceux qui ne veulent pas en tenir compte et qui
pourraient le faire avec fruit sont bien coupables !
On y répond par des mots sonores ; on nous dit : N’êtesvous pas en pleine jouissance de la démocratie absolue par le
suffrage universel et le vote secret. Vos destinées sont entre
vos mains.
Vous savez bien que cela n’est pas. Si nous étions réellement
les maîtres, vous vous garderiez, sous des prétextes plus ou
moins futiles, de tous vos audacieux et blessants rappels à
la dépendance. Que plus de vingt personnes se réunissent
pour s’éclairer mutuellement sur les choses de la politique :
vous faites aussitôt intervenir vos gendarmes ! Qu’un journa
liste se permette une indocilité de plume, qu’il se laisse aller
à une protestation émue : vous l’avertissez d’abord, vous le
supprimez ensuite ! Et s’il en résulte la démonstration d’un
fait, ce n’est point, je le suppose, que nos destinées nous ap
partiennent, ni précisément que nous soyons libres.
Nous avons, tout au moins, le droit de l’être. Et ceux-là ont
assumé sur leur tête une responsabilité pesante, qui n’ont pas
craint d’attenter à la liberté, dans un moment de terreur pa
nique. Qu’ils n’aient eu en vue que l’ordre, dont ils voulaient
du reste avec patriotisme et raison, soit ! Mais si l’ordre est
une condition nécessaire de notre existence sociale, l’ordre sans
la liberté, qu’on ne l’oublie pas, c’est la mort morale. Au dou
ble point de vue, religieux et philosophique, ce qui, en effet,
distingue l’homme, ce qui constitue précisément sa supériorité
et sa grandeur, c’est son libre arbitre. Il ne lui est loisible ni
de supprimer ni d’amoindrir ce qu’il tient de Dieu.
XIV.
En possession de la liberté politique, dégagée de toute en
trave, le moyen de nous affranchir d’une tutelle quelquefois
— 18 —
pernicieuse et toujours humiliante, ne sera pas seulement
trouvé, il sera dans nos mains. Aussitôt le champ sur lequel
la loi du progrès nous commande impérativement d’avancer
prendra une base ferme et solide. C’est le moment attendu
par tous les hommes de sens, de loisir et de cœur, pour s’im
poser le noble mandat d’initier le plus grand nombre aux
obligations de la vie sociale. A l’instituteur communal de le
faire participer dans une mesure chaque jour plus large aux
bénéfices de l’instruction : à eux, de lui donner des mœurs
politiques.
Ce ne sera point un travail vulgaire ni de minime impor
tance, car, sous ce rapport, le gros de la nation n’a presque
tiré aucune lumière de l’expérience des siècles écoulés. Une
preuve entre beaucoup d’autres, c’est qu’il ne montre, dans
les élections, où il pourrait, cependant, s’être à lui-même si
utile, ni discernement ni volonté. Il a besoin de direction et
de conseils, il lui faut un guide, et son guide le plus écouté
parmi nos populations rurales, n’est autre, après le maire,
que le garde-champêtre. Or, le garde-champêtre, ce n’est plus,
comme autrefois, l’homme de la commune qui le paye ; c’est
le serviteur fort humble du maire qui le nomme. Le maire
lui-même, s’il veut être agréable et bien noté, ne s’occupera
que par aventure des intérêts du groupe qu’il administre. Sa
mission spéciale est autre. On entend qu’il ne soit, par desti
nation, qu’une sorte de petit sous-préfet, ayant charge de
diriger le suffrage universel pour le plus grand profit des
candidatures officielles.
Et c’est ainsi que nous avons vu, périodiquement, les hom
mes les plus honorables, les plus justement estimés, les plus
populaires, lutter avec désavantage contre l’action prépondé
rante de ces deux fonctionnaires. Pourquoi? La raison en est
simple : c’est que le maire, et son agent le garde-champêtre,
ont toute licence d’agir comme ils l’entendent pour se facili
ter le succès qu’ils poursuivent, tandis que les premiers se
trouvent à chaque pas contenus et enrayés.
C’est un spectacle affligeant et triste, auquel il nous sera
— 19 —
donné d’assister aussi longtemps que la sphère dans laquelle
se meuvent les idées du peuple demeurera obscurcie et res
treinte par une éducation politique incomplète. Mais, cette
lacune comblée, la situation changera de face. Devenu capa
ble d’observation personnelle et de jugement, il n’est pas
douteux qu’il ne pense et n’agisse en homme, c’est-à-dire que,
pénétré de son droit et soucieux de son devoir, il ne veuille
plus relever que de lui-même.
XV.
Son droit, et il le saura d’autant mieux qu’il sera plus
éclairé, a pour limite le devoir.
•Le devoir de chacun consiste à respecter le droit d’autrui
et à faire respecter le sien propre.
La vérité de ces aphorismes ne se démontre pas : elle s’in
dique et s’affirme. Néanmoins, qu’on nous permette un
exemple.
Nous définissons la propriété, du travail accumulé. C’est
le produit des sueurs de l’homme. Rien, en soi, de plus lé
gitime. Nul ne peut y porter la main sans commettre un acte
injuste. L’état lui-même ne le peut pas. S’il se permettait d’y
toucher, sous n’importe quel prétexte et quel qu’en fut le
mode, ou matériel, ou moral, il se rendrait coupable de for
faiture, et ceux qui, pouvant l’en empêcher, consentiraient à
le laisser faire, soit indifférence ou calcul, seraient les com
plices plus ou moins criminels d’un acte irrémissible de pur
brigandage.
Vous et moi savons cela. Il importe que la nation, à son
tour, le sache ; qu’elle voie clair dans ses propres affaires ;
qu’elle distingue nettement ce que l’intérêt général exige, ce
qu’il défend, et qu’elle intervienne dans tous les cas pour faire
prévaloir sa volonté souveraine.
La souveraineté nationale n’est encore qu’un mot. S’il n’est
possible qu’elle soit une chose que par l’instruction et la li
berté, il faut devenir libres, coûte que coûte, s’instruire et
marcher.
— 20 —
Les temps d’arrêt du progrès social sont de publics malheurs
que les peuples peuvent empêcher, et qu’il leur est, par
tout ce qu’il y a en eux de sentiments élevés, interdit de
souffrir.
Périgueux, imprimerie A. Boucherie et Ce.