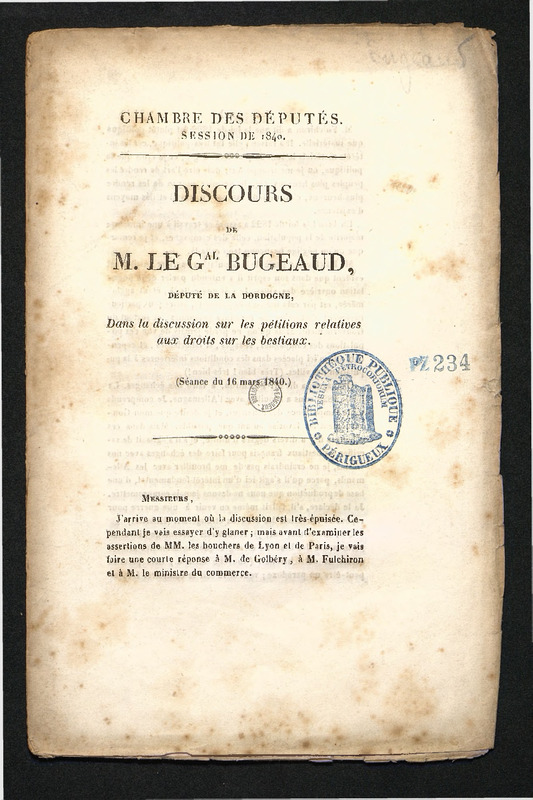-
extracted text
-
CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
SESSION DE 1840.
DISCOURS
DE
M. LE GAL BUGEAUD,
DÉPUTÉ DE LA DORDOGNE,
Dans la discussion sur les pétitions relatives
aux droits sur les bestiaux.
Messieurs ,
j’arrive au moment où la discussion est très-épuisce. Ce
pendant je vais essayer d'y glaner; mais avant d’examiner les
assertions de MM. les bouchers de Lyon et de Paris, je vais
faire une courte réponse à M. de Golbéry, à M. Fulchiron
et à M. le ministre du commerce.
�2 )
M. Fulchiron a dit que la loi de 1822 fut plutôt politique
que matérielle. Il a raison ; elle fut très-politique, car les in
térêts matériels le sont au plus haut degré, et je crois que la
politique, ou je me trompe fort, doit être l’art de rendre les
peuples plus heureux. Or, le premier moyen de les rendre
plus heureux, c’est de leur assurer du travail et des moyens
d’existence.
Eh bien ! la loi de 1822 a assuré ce travail à une immense
majorité de la population, celle des campagnes, et je remar
que qu’on néglige beaucoup trop celle-là.
M. Fulchiron a parlé de la population ouvrière; mais il est
évident que dans son esprit il a entendu parler de la popu
lation ouvrière des villes. Je sais que celle-là , étant agglo
mérée, est par cela même très-puissante, attire plus particu
lièrement l’attention de certaines personnes , et surtout du
Gouvernement. Mais qu’on ne perde jamais de vue ces po
pulations des campagnes, si sages , si laborieuses , et cepen
dant jusqu’ici placées dans des conditions inférieures à la po
pulation des villes. (Très-bien ! très-bien !)
On gagne, a dit M. Fulchiron, à faire des échanges. La
loi de 1822 nous a brouillés avec l’Allemagne. Je comprends
toute l’importance des échanges, et je désire que mon Gou
vernement les favorise autant que possible. Mais dans ces
échanges il y a divers degrés d’utilité, et s’il s’agissait de sa
crifier les bestiaux français pour faire des échanges avec nos
voisins, je ne craindrais pas de me brouiller avec les Alle
mands, parce qu’il s’agit ici d’un intérêt fondamental, d’une
base de production que nous ne devons jamais compromettre;
Je le déclare, s’il fallait même en venir à une guerre pour
repousser l’invasion des bestiaux étrangers... (Hilarité.)
Oui, Messieurs, oui, je redouterais davantage l’invasion
permanente des bestiaux étrangers que l’invasion des armées
russes et autrichiennes. (Nouvelle hilarité.) Cela paraîtra?
peut-être un paradoxe ; vous allez voir le contraire. L’inva-
�( 3’ )
*
sîon étrangère rie serait que passagère ; avec du courage, dé
la résolution, et surtout de l’union, nous en triompherioons
mais l’invasion permanente des bestiau étrangers dessé
cherait votre sol, elle tarirait la source de toutes lès pro
ductions, elle diminuerait la fertilité du territoire, et ré
duirait peut-être des trois quarts la valeur de ce grand
capital qui est assis sur le sol ; elle diminuerait la population
du royaume, et parlant sa force.
Vous le voyez, Messieurs, ce n’était donc pas un para
doxe.
Il y a bien long-tems, ajoute encore M. Fulchiron, que
Pagriculture nous promet des progrès. Cela est vrai ; ses
progrès sont lents; elle ne peut renouveler ses expérien
ces qu’une fois par an, c’est-à-dire avec les saisons. Elle
n’est pas comme les autres industries, qui peuvent renouve
ler leurs expériences jusqu’à huit et dix fois dans l’année.
(Marqués nombreuses d’approbation.) Les capitaux s’éloi
gnent de l’agriculture , parce que, jusqu’à présent, ses bénéfices ont été très-minimes. Oui, les capitaux la fuient ; et
pour qu’ils viennent à elle, il ne faut pas sans cesse dans vos
lois de douane l’appauvrir et l’entraver : il faut au contraire
la protéger. Alors les capitaux se présenteront, et elle fera de
grands progrès.
Ne faisons pas dire à la classe ouvrière, a dit ensuite M. Ful
chiron, que la propriété ne pense pas à' elle. Je ne croyais pas,
je l’avoue, qu'un homme sage et doux comme M. Fulchiron...
(On rit.) Je ne croyais pas que le très-paisible M. Fulchiron
pourrait mettre les propriétaires en opposition avec le peuple
des villes : c’est là une erreur malheureuse. Leurs intérêts
ne sont nullement divergens. Les habitans des villes, les babitans des campagnes et même les simples manœuvres sont
intéressés à ce que les propriétaires et les gros: fermiers fas
sent bien leurs affaires; car alors ils font travailler davantage
et peuvent donner de meilleurs salaires. Ils sont les chefs du
�(4)
travail, et au fond ils ne sont que les administrateurs de la
propriété au profit de tous ceux qui l'exploitent, et vivent
dessus par le moyen de leur travail.
Il arrive même souvent que le propriétaire et le fermier
se trouvent, par les produits, moins rétribués que s’ilsétaient
payés comme administrateurs en raison de leur talent.
D’ailleurs ces gros propriétaires sont-ils donc si nombreux
qu'on les présente toujours en opposition avec les intérêts
des populations ? La propriété est entièrement divisée chez
nous; nous avons 11 millions de cotes foncières, et le petit
propriétaire, le très-petit propriétaire, et même le simple
manœuvre, sont tout aussi intéressés à la question qui nous
occupe que les possesseurs de vastes propriétés. (Très-bien!)
Leurs intérêts sont parfaitement identiques; et je dirai
même, car c’est ici l’occasion, que les intérêts du peuple des
campagnes, qu’on cherche à opposer à ceux des habitons des
villes, sont entièrement les mêmes.
Je soutiens que pour que le peuple, pour lequel on s’inté
resse avec tant de justice , mange de la viande, il faut, non
pas que la viande soit très-chère, mais qu’elle soit à un trèsbon prix. Il ne peut pas en manger autrement.
Ainsi l’habitant des campagnes, qui autrefois ne mangeait
de la viande qu’aux trois ou quatre fêtes principales, en
mange aujourd’hui un peu plus souvent , parce qu’il vend
mieux. Cela est facile à comprendre: il en vend plus qu’il
n’en mange , il a donc intérêt à ce que la viande se vende
plus cher. Car s’il en vend 2,000 kilog. et qu’il n’en mange
que 50 kilog., il aimera mieux payer 1 sou plus cher chez
le boucher les 50 kilog. de sa consommation et vendre 1 :ou
de plus les 2,000 kilog. de viande sur pied qu’il conduit au
marché.
Quelques membres. C’est du bon sens !
M. le général Bugeaud. Quant à 1'habitant des villes, ce
qui lui importe, ce n’est pas de manger la viande un peu
__ : .■ . _
-<
�'
( 5 )
plus ou un peu moins cher : c’est d’avoir du travail, c'est là
l’important pour lui. Mais qui est-ce qui lui assure du tra
vail ? Ce sont les 24- millions d’agriculteurs. Si ceux-ci ne
font pas leurs affaires, ils consommeront infiniment moins
des produits des habitans des villes, et ceux-ci voyant dimi
nuer leur travail sont forcés de diminuer leur consomma
tion, bien que la viande soit à plus bas prix.
Savez-vous qui paie la plus-value de la viande? Ce sont
les riches qui ne travaillent pas dans les villes. Et si ce sont
ceux-là qui paient, vous conviendrez, vous qui êtes populai
res, que ce n’est pas un mal. (Approbation.)
Ce n’est donc pas l’ouvrier qui gagne à ce que la viande
soit à vil prix.
M. Dupin. Sans doute : il n’aurait pas de travail, s’il n’y
avait pas d’octroi.
M. le général Bugeaud. Le bon marché m’a toujours
paru une absurdité en économie politique ; l’important, c’est
d’avoir de quoi payer.
Sous la défunte république, qui, je l’espère, ne renaîtra
pas, la viande était à très-bas prix. M. Bontems, boucher,
qui existe encore , assure qu’à cette époque il l’a donnée à
2 sous, et cependant on en consommait fort peu. Savez-vous
pourquoi ? C’est qu’on n’avait pas de quoi payer.
J’ai déjà répondu à quelques-unes des observations que
M. le ministre nous a présentées. Mais M. le ministre croit
qu’il y a avantage à changer le mode de l’impôt. Sans doute
M. le ministre a entendu dire qu’il préférait l’impôt au poids.
Eh bien! je m’élève contre cette o, inion-là.
Messieurs, vous avez en France des départemens qui en
graissent, vous en avez d’autres qui élèvent le bétail, vous
en avez qui ont plus de petit bétail que de gros. Eh bien!
ceux-là ont un grand intérêt à ce que ce mode de percep
tion ne soit pas admis. Vous avez la Bretagne et d’autres
provinces qui élèvent du petit bétail.
�( 6 )
Si vous faites entrer le menu bétail de la Savoie, par
exemple, vous leur portez un grand préjudice ; et ce n’est
pas la grande propriété, mais la petite propriété particu
lièrement qui en souffrirait, car c’est elle qui, en général, a
le plus petit bétail.
Mais M. le ministre croit qu’en définitive il faudra arriver
graduellement à l’abaissement des droits.
Eh bien! voilà une opinion que je ne saurais partager; je
crois, au contraire, qu’il faut que ce droit soit à peu près
constamment prohibitif, précisément parce que j’ai dit tout à
l’heure que c’était une industrie fondamentale, une indus
trie sur laquelle reposent toutes les autres, une industrie qui
est le germe de tous les produits.
Le fumier, cette matière dégoûtante à l’œil et à l’odo
rat (On rit), est cependant la première, la plus grande
des richesses nationales. (Très-bien ! ) Comment se fait il
que Meneurs les économistes ne l’aient jamais prise en
considération ? Ils ont trouvé sans doute que c’était trop im
monde. Eh bien ! moi je crois que, la première, elle aurait
dû fixer leur attention ; car on ne saurait trop le redire ,
c’est de celle-là que dépendent toutes les autres. Voilà
pourquoi je pense qu’il ne faut pas abaisser nos droits , et
qu’il importe de les maintenir ce qu'ils sont, et de suivre
l’exemple de l’Angleterre, qui prétend nous donner des leçpns de libéralisme ep fait de commerce, et qui cependant
prohibe l’entrée des bestiaux étrangers.
Une voix. La viande y est meilleur marché qu’en France.
M. Bugeaüd. Qu’il me soit permis maintenant d’exami
ner quelques unes des assertions de Messieurs les bouchers.
Je ne m’arrêterai pas à cette assertion, que l’espèce bovine
a beaucoup dégénéré ; on y a déjà répondu. Il serait bien
étonnant, lorsque s’étendent partout les progrès d’une meil
leure nourriture, que les espèces eussent dégénéré. Les espèces
s’améliorent, et le nombre des bêtes s’accroît par l’augmen-
�( 7 )
talion et la meilleure qualité des alimens. Et pour en être,
bien persuadé, il suffit de voir avec quel soin on se procura
de beaux animaux, de belles races, depuis que la culture
des prairies artificielles et des racines s’est étendue. Ainsi,
c’est donc une erreur de dire que les espèces ont dégénéré;
c’est une erreur permise aux habilans des villes, qui ne sont
nullement familiarisés avec les pratiques de la campagne.
J’ai la même réponse à faire à celte autre assertion : On
n’engraisse pas aussi bien maintenant qu’autrefois. Cela n’est
pas exact : on nourrit mieux les bestiaux aujourd’hui, partant
on les engraisse au moins aussi bien , et même mieux. A
celte assertion qu’on n’engraisse pas aussi bien, et que le poids
des bestiaux a diminué, on peut encore répondre que depuis
la loi de 1822, un plus grand nombre de départemens con
courent à l’alimentation de Paris et des autres grandes villes.
Autrefois leurs bestiaux ne pouvaient pas y participer,
étant primés par la supériorité des bestiaux allemands; au
jourd’hui 12 ou 15 départemens, je crois, qui ne fournissaient
pas de bestiaux à Paris, en fournissent de moindre poids. De
là on a dit que l’espèce avait dégénéré. Non, Messieurs, cela
n’est pas exact: ainsi les bestiaux Périgourdins, les bestiaux
normands, les bestiaux du Limousin, n’ont pas dégénéré;
mais comme beaucoup de départemenssont venus en concur
rence, on amène des bestiaux d’un poids inférieur, et ils ont
contribué à établir la moyenne; et de là on a imaginé que l’es
pèce était appauvrie. C’est une erreur; même dans les dé
parlemens qui fournissent du petit bétail, il y a amélioration
dans l’espèce.
On a répondu aussi à ce qui avait été dit de la plus grande
consommation des vaches; mais peut-être n’y a-t-on pas ré
pondu suffisamment. Une des grandes causes de l'augmenta
tion de la consommation des vaches, c’est l’octroi. Les vaches
ne paient que 15 fr. d’entrée. Or, il y a beaucoup de vaches
aux environs de Paris qui pèsent autant que des bœufs, et
�( 8 )
comme le droit d’octroi est moindre, on fait entrer ces va
ches. Ensuite la consommation du lait s’est singulièrement
accrue, et j’observe en passant que celle plus grande con
sommation du lait a fait diminuer la consommation de la
viande; car quand on consomme plus d’une chose, on con
somme moins de l’autre, c’est évident. Les nourrisseurs ne
gardent les vaches qu’un an; ils ne renouvellent pas le lait;
dès qu’elles n’en produisent plus, il faut bien qu’ils les en
graissent et les vendent. Voilà pourquoi vous avez consom
mé l’année dernière 19,000 vaches, tandis qu’autrefois la
consommation n’était que de 7 ou 8,000. Eh bien, je crois
que cette consommation ira encore en augmentant, et ce n’est
pas un grand malheur ; la vache sur vos marchés ne se vend
qu’un sou de moins que le bœuf; et vous, hommes riches,
vous en mangez souvent sans vous en douter : c’est une trèsbonne viande quand elle est grasse. (On rit.)
La fourniture des hôpitaux de Paris est, dit-on, d'un prix
beaucoup plus élevé qu’elle ne l’était autrefois.
Je vais vous en dire la cause. Autrefois on n’exigeait pas
de très-bonne viande dans les hôpitaux. Plusieurs adjudica
taires avaient passé, pour ces fournitures, des marchés à un
prix assez bas, parce qu’ils voulaient frauder, parce qu’on
n’était pas très-difficile dans la réception des viandes. Sa
vez-vous, Messieurs, comment ils s’y prenaient pour frauder?
Ou faisait entrer les bêtes mortes dans des voitures à doubles
fonds, on les dépeçait, les bons morceaux étaient mis de côté,
la viande de moindre qualité était livrée à l’hôpital, et la.
viande choisie sortait de l’hôpital dans le double fond pour
être vendue très-cher en ville. Voilà pourquoi les basses
viandes pouvaient être données à bas prix aux hôpitaux.
On a voulu donner de meilleure viande aux malades , et
on a eu raison ; on a été plus difficile et plus clairvoyant
dans les réceptions. Voilà pourquoi le prix de fournitures a
été plus cher.
�(9)
Les bouchers de Paris vous ont dit : Le conseil-général de
la Seine a demandé l’abaissement du droit d’entrée sur les
bestiaux étrangers. Je suis fort touché de la sollicitude pa
ternelle du conseil-général de la Seine ; mais ce n’est pas à
l’agriculture à faire les frais de celte sollicitude. Il y a des
moyens qui sont à sa portée, dont il est le maître ; il doit
donc commencer par ceux-là ; et s’ils ne suffisent pas, nous
verrons après. Ainsi, vous avez un octroi énorme qui pèse
sur la viande de 20 centimes par kilogramme ; vous avez la
caisse de Poissy, les droits d’abattage et d’étal , et d’autres
droits encore. Que le conseil-général de la Seine réduise
d’abord ces droits, et alors il sera bien venu à demander une
diminution dans les droits d’entrée à la frontière.
Ce n’est pas que je blâme l’octroi. Je crois que l’octroi
ne pèse pas sur le peuple, car les dépenses municipales se
font pour le peuple, les hôpitaux ne sont pas faits pour les
gens riches assurément, et profitent au peuple. Les grands
travaux qui s’exécutent dans les villes, c’est encore le peu
ple qui gagne l’argent qu’on y dépense. Ainsi l’octroi est
très-favorable au peuple, et je ne le b âme point en principe ;
mais, s’il faut toucher à quelque chose, c’est à l’octroi d’a
bord, mais non pas aux droits d’entrée sur les bestiaux
étrangers. (Très-bien ! très-bien !)
Les bouchers de Paris prétendent que les droits énormes
sur les bestiaux étrangers ruinent l’agriculture qui les achète
fort cher à la production indigène, et que sans cela elle re
prendrait l’industrie de l’engraissement, négligé comme trop
peu productif.
Quant à la première objection, je ne conçois'pas la diffé
rence qu’il y a entre l’agriculture et la production indigène;
or, lorsqu’on s’achèterait un peu cher à soi-même , il n’y
aurait pas là un grand inconvénient. Quant à la seconde
assertion, quand ou dit en même teins que la vente est trop
chère et que l’engraissement est trop peu lucratif, il y a là
�une contradiction manifeste et une ignorance des choses que.
je ne veux pas relever dans toute sa rigueur, mais qui doit
vous frapper et vous faire voir que MM. les bouchers no
connaissent pas la matière. Ils entendent très bien le débit,
mais ils n’entendent pas la production. (On rit.)
La consommation , dit-on , a diminué , et cette denrée,
auxiliaire indispensable du pain, n’est plus à la portée des
classes inférieures.
Il est bien heureux pour les habitans des villes que la
viande soit un auxiliaire indispensable du pain. Malheureu
sement, les producteurs de viande ne sont pas dans le même
cas; c’est pour eux un auxiliaire, non pas indispensable, mais
extraordinaire pour trois ou quatre fêtes par an, pour Je
mariage de leurs filles, de leurs garçons, voilà tout.
Cependant, quand ils vendent bien leurs denrées au mar
ché, ils emportent legigot qu’ils mangent en famille. (On rit.)
Voilà pourquoi il est essentiel que la viande se vende bien ,
pour que le peuple en mange, car les 21 millions de culti
vateurs, M. Fulchiron en conviendra , sont aussi du peuple.
Mais le prix de la viande a-t-il subi la même progression
d’augmentation que les autres denrées? Non, Messieurs ; et
il serait aisé de vous le prouver, si je ne craignais de vous fatiguer. Cependant, nous n’avons été aidés en aucune manière
par la mécanique, qui n’a rendu que très-peu de services à
l’agriculture, et je ne la crois pas appelée à en rendre beau
coup d’autres. Le prix de la terre a haussé, l’impôt s'est
élevé de toutes manières, par les centimes additionnels, par
les centimes facultatifs, extraordinaires, etc.
Le prix de la main-d’œuvre a également haussé, et cepen
dant le prix de la viande ne s’est pas élevé dans une propor
tion extraordinaire ; je dirai même que, depuis 1838, il a
baissé : le bœuf a diminué de 6 cent.; le veau, de 9 cent.; le
porc , de 10 cent.; le mouton seul a augmenté de 3 cent. II
n’est donc pas exact de dire que la viande va toujours en eu-
�(11)
chérissant, et pourtant, dans celte période, une épizootie
vraiment désastreuse a pesé sur le bétail de presque toute la
France : un mal de pied est venu affecter les animaux de
toute nature. Les acheteurs n’achètent qu’en tremblant, car
ils laissent en route une grande partie du bétail. C’est ce qui
a produit un peu de rareté sur quelques marchés. On s’est
empressé de jeter les hauts cris sans examiner la cause de
cette rareté; mais, dans presque tous les marchés, vous avez
des bestiaux de renvoi, Et, d’ailleurs, faut-il changer nos lois
de douane toutes les fois qu’une cause passagère et qui dé
pend de la nature vient affecter le marché ? Ce serait in
sensé.
Si la consommation paraît avoir baissé dans la ville de Pa
ris, on en a dit tout à l’heure les causes ; mais elle s’est éle
vée dans les campagnes, et le département de la Seine, par
exemple , consomme infiniment plus de viande qu’autrefois.
Si Paris a vu diminuer un peu la consommation, cette dimi
nution n’est pas générale ; car la consommation s’est augmen
tée sur les vaches, sur les veaux et sur les moutons ; elle n’a
diminué que sur les bœufs, et elle a été remplacée par une
foule d’autres produits animaux ou végétaux. Mais , enfin ,
sj en dehors de Paris elle a augmenté, vous devez l’attribuer
en partie à l’octroi ; car l’ouvrier se place près des barrières
pour manger en dehors, et le dimanche, ainsi que le lundi,
il se rassasie pour toute la semaine de ces matières qui n’ont
pas pajé l’octroi. (On rit.) Voilà pourquoi la consommation
semble avoir baissé dans Paris. (Rumeurs diverses.)
Au reste, j’ai la certitude que les prix qui sont portés dans
les mercuriales sont exagérés. M. le ministre du commerce
peut s’en convaincre, en faisant examiner les livres des gros
marchands bouchers ; ils vendent de la viande à la cheville
au-dessous des mercuriales, et sans doute ils ne veulent pas
y perdre. Savez-vous pourquoi les prix sont faussés ? C’est
�( 1O )
une contradiction manifeste et une ignorance des choses que.
je ne veux pas relever dans toute sa rigueur, mais qui doit
vous frapper et vous faire voir que MM. les bouchers ne
connaissent pas la matière. Ils entendent très-bien le débit,
mais ils n’entendent pas la production. (On rit.)
La consommation , dit-on , a diminué , et cette denrée,
auxiliaire indispensable du pain, n’est plus à la portée des
classes inférieures.
Il est bien heureux pour les habitans des villes que la
viande soit un auxiliaire indispensable du pain. Malheureu
sement, les producteurs de viande ne sont pas dans le même
cas; c’est pour eux un auxiliaire, non pas indispensable, mais
extraordinaire pour trois ou quatre fêtes par an, pour Je
mariage de leurs filles, de leurs garçons, voilà tout.
Cependant, quand ils vendent bien leurs denrées au mar
ché, ils emportent legigot qu’ils mangent en famille. (On rit.)
Voilà pourquoi il est essentiel que la viande se vende bien ,
pour que le peuple en mange, car les 24 millions de culti
vateurs, M. Fulchiron en conviendra , sont aussi du peuple.
Mais le prix de la viande a-t-il subi la même progression
d’augmentation que les autres denrées? Non, Messieurs ; et
il serait aisé de vous le prouver, si je ne craignais de vous fatiguer. Cependant, nous n’avons été aidés en aucune manière
par la mécanique, qui n’a rendu que très-peu de services à
l’agriculture, et je ne la crois pas appelée à en rendre beau
coup d’autres. Le prix de la terre a haussé, l’impôt s’est
élevé de toutes manières, par les centimes additionnels, par
les centimes facultatifs, extraordinaires, etc.
Le prix de la main-d’œuvre a également haussé, et cepen
dant le prix de la viande ne s’est pas élevé dans une propor
tion extraordinaire ; je dirai même que, depuis 1838, il a
baissé : le bœuf a diminué de 6 cent.; le veau, de 9 cent.; le
porc , de 10 cent.; le mouton seul a augmenté de 3 cent. Il
n'est donc pas exact de dire que la viande va toujours en en
�(11)
chérissant, et pourtant, dans cette période, une épizootie
vraiment désastreuse a pesé sur le bétail de presque toute la
France : un mal de pied est venu affecter les animaux de
toute nature. Les acheteurs n’achètent qu’en tremblant, car
ils laissent en route une grande partie du bétail. C’est ce qui
a produit un peu de rareté sur quelques marchés. On s’est
empressé de jeter les hauts cris sans examiner la cause de
cette rareté; mais, dans presque tous les marchés, vous avez
des bestiaux de renvoi. Et, d’ailleurs, faut-il changer nos lois
de douane toutes les fois qu’une cause passagère et qui dé
pend de la nature vient affecter le marché ? Ce serait in
sensé.
Si la consommation paraît avoir baissé dans la ville de Pa
ris, on en a dit tout à l’heure les causes ; mais elle s’est éle
vée dans les campagnes, et le département de la Seine, par
exemple , consomme infiniment plus de viande qu’autrefois.
Si Paris a vu diminuer un peu la consommation, cette dimi
nution n’est pas générale ; car la consommation s’est augmen
tée sur les vaches, sur les veaux et sur les moulons ; elle n’a
diminué que sur les bœufs, et elle a été remplacée par une
foule d’autres produits animaux ou végétaux. Mais , enfin ,
si en dehors de Paris elle a augmenté, vous devez l'attribuer
en partie à l’octroi ; car l’ouvrier se place près des barrières
pour manger en dehors, et le dimanche, ainsi que le lundi,
il se rassasie pour toute la semaine de ces matières qui n’ont
pas payé l’octroi. (On rit.) Voilà pourquoi la consommation
semble avoir baissé dans Paris. (Rumeurs diverses.)
Au reste, j’ai la certitude que les prix qui sont portés dans
les mercuriales sont exagérés. M. le ministre du commerce
peut s’en convaincre, en faisant examiner les livres des gros
marchands bouchers; ils vendent de la viande à la cheville
au-dessous des mercuriales, et sans doute ils ne veulent pas
y perdre. Savez-vous pourquoi les prix sont faussés ? C’est
v..
�( 12 )
Que l’agriculture n’intervient pas dans la fixation de la mer
curiale.
Je prie M. le ministre de remarquer que les règlemens sur
la boucherie ne sont pas exécutés, c’es!-à dire qu’ils sont
exécutés dans ce qui est contraire à l’agriculture, mais qu’ils
ne le sont nullement dans ce qui pourrait blesser les bou
chers, et cela, parce que l’agriculture n’est pas représentée
dans les marchés. Il serait très-important qu’elle le fût pour
régler la mercuriale et assurer l’exécution de tous les règle
mens tombés en désuétude.
Il serait également urgent qu’on défendît le commerce à
la cheville : les règlemens défendent ce commerce. Tous
les bouchers doivent s’approvisionner directement aux mar
chés de Sceaux et de Poissy ; cela ne s’exécute plus. Il
n’y a qu’un certain nombre de bouchers qui achètent pour
les autres , et ils règlent souvent le cours à leur volonté,
parce qu’ils n’y a pas assez de concurrence.
Il y aurait encore une amélioration à apporter : ce serait
de permettre aux éleveurs, aux herbagers, lorsque leurs
bestiaux ont été renvoyés deux fois du marché, de les abat
tre et de les débiter. Ce qui a été rebuté deux fois reste à la
charge des marchands; ils ne peuvent le vendre, et cela les
ruine. (Assentiment.)
Vous voyez que l’agriculture, qui garde le silence, a pour
tant des réclamations très-légitimes à faire, et je prie M. le
ministre du commerce de vouloir bien s’occuper au plus tôt
de la police des marchés et de la boucherie.
J’arrive aux assertions de MM. les bouchers de Lyon. Ils
disent que la nouvelle destination donnée aux terres par des
cultures plus lucratives que celle des fourrages et des raci
nes a diminué le nombre des bestiaux de manière à ce que
le prix s’est élevé à 75 centimes le demi-kilogramme.
�( 13 )
Je crois que cela est exagéré. Mais, enfin, si certaines pro
ductions sont plus lucratives, s’il est plus avantageux de
cultiver la garance, le colza, le tabac, la vigne même,
que d’élever du bétail, faut-il, pour cela, que les popu
lations des départemens du centre et de l’ouest, qui ne
peuvent pas produire autre chose que des bestiaux et des
grains, voient leurs productions invendues et avilies dans
leur prix? Faut-il que le bétail étranger vienne faire une
concurrence que nous ne pouvons supporter parce que les
conditions de productions sont toutes plus avantageuses
chez nos voisins, ainsi qu’il me serait facile de le démon
trer si je ne craignais d’arrêter trop longtems l'attention de
la chambre? C’est précisément parce que vous avez des cul
tures plus lucratives que vous pouvez et que vous devez
payer la viande nationale un peu plus cher. Au reste, je re
marque que ce ne sont ni les producteurs ni les consomma
teurs des départemens de l’est qui réclament; ce sont les
bouchers, c’est-à-dire la classe la moins intéressée à l’abais
sement du prix.
Messieurs, la France est une grande agglomération de
provinces diverses, unies pour s’entr’aider et se partager les
charges et les bénéfices de l’association. Voyons, si ces char
ges et ces bénéfices sont également partagés :
Les départemens du centre et de l’ouest paient des impôts
qui ne se dépensent jamais sur leur territoire : la dépense se
fait dans les départemens île l’est et du nord, où se trouvent
les grandes garnisons, où sont les places de guerre et le plus
grand nombre de routes royales et de canaux.
Cela est si vrai que, dans presque tous ces départemens,
il est plus dépensé pour les besoins de l’Etat que ces mêmes
départemens ne paient d’impôts.
Je ne me rappelle pas précisément les chiffres ; mais je
crois pouvoir affirmer que, dans le département du Bas-Rhin,
�( 14 )
par exemple, où l'on paie 8 millions d’impôts, il est dépensé
pour les garnisons, l’entretien des places de guerre, plus de
12 millions.
Prenez un des départemens producteurs de bétail, et vous
verrez qu’il ne s’y dépense pas plus de la dixième partie de
l’impôt qu’on y paie.
Voilà, Messieurs, des inégalités qui sont assez choquantes.
Comme vous le voyez, les charges et les bénéfices ne sont
pas également répartis. Cependant nous ne nous en plaignons
pas. Des nécessités publiques exigent que les places de guerre
et les garnisons soient en plus grand nombre à nos frontières.
Nous n’en murmurons pas; mais nous disons : « Laissez-nous
vendre notre bétail; si nos impôts se dépensent chez vous, du
moins ne nous ruinez pas, afin que nous puissions les payer.
Quand nos frontières seront menacées, quand il’ faudra re
pousser l’invasion de l’étranger, vous trouverez fort bien que
nos enfans aillent vous aider. Eh bien ! favorisez donc læ
multiplication de ces enfans en ne ruinant pas les pères. «
Messieurs, les pétitionnaires ont soulevé, sans s’en douter
peut-être, la plus grande des questions d’économie publique.
Leurs demandes imprudentes ne tendent à rien moins qu’à
dessécher le sol, et, partant, à réduire la population, à ar
rêter tous les progrès, à rétrograder vers la barbarie.
Messieurs, croyez-le bien, à cette question se rattachent
tous les progrès matériels, moraux et politiques. Vous ne
pouvez faire un pas en avant si l’agriculture est stationnaire,
et celle-ci ne peut progresser sans l’augmentation du bétail
et des engrais qu’il produit. Or, Messieurs, on ne produit
avec abondance que ce qui se vend bien : faites baisser le
prit par l’abaissement des droits, ef à l’instant même vous
verrez diminuer la production animale. Toutefois, malgré
l’importance de celle production fondamentale et mère de
toutes les autres, nous ne demandons à être protégés que
�?
( 15 )
C'omme toutes les autres industries. Si l’on abaisse les bar
rières devant les bestiaux étrangers, il faut que toutes les
barrières soient abaissées. Alors nous serons dans l’âge d’or
des économistes : nous aurons tout à bon marché; nous ne
travaillerons pas, car nous ne pourrions pas vendre nos pro
duits; comme les Arabes, nous chasserons, nous aimerons...
(Rires et bruit), pourvu que Messieurs les économistes nous
enseignent les moyens de payer sans produire.
Rappelez-vous toujours, Messieurs, qu’un pays sans bétail
est un pays misérable, livré à l’étranger, d’abord quant à la
richesse, et bientôt quant à la force.
De toutes paris. Très-bien ! très-bien ! Aux voix ! aux
voix !
M. le président. La parole est à M. S,hauenburg.
M. Carl, rapporteur. Je la demande aussi.
M. le général Bügeaud, à sa place. J’ai cru inutile de
dire que je m’opposais aux conclusions de la commission.
Une voix. Cela s’entend de reste. (On rit.)
M. le général Bugeaud. Je demande l’ordre du jour.
PSîbud rKûïiïr'
!
Cf LA VILLE.
1 ?E Périgueux
(Extrait du Moniteur du 17 mars 1840.)
Imprimerie de Mme Ve Agasse , rue des Poitevins, n° 6.
�4
�