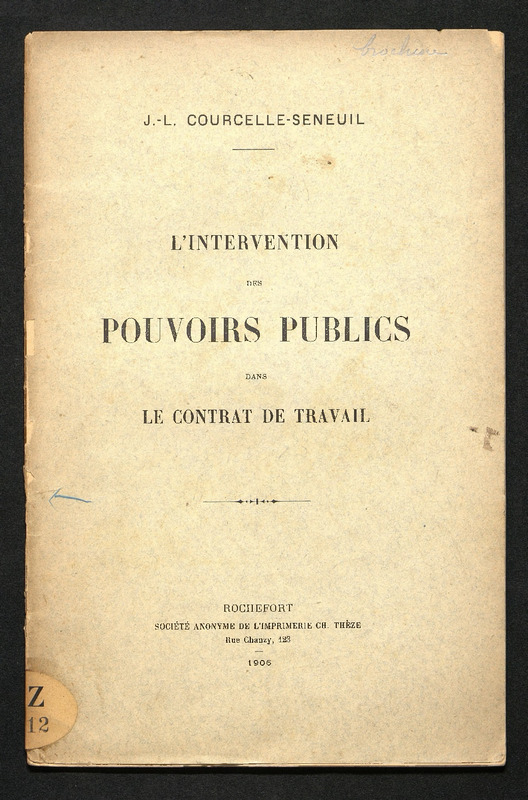FRB243226101PZ-412.pdf
Médias
Fait partie de L' intervention des pouvoirs publics dans le contrat de travail
- extracted text
-
J.-L. COU RCELLE-SEN EU I L
L’INTERVENTION
DES
POUVOIRS PUBLICS
DANS
LE CONTRAT DE TRAVAIL
ROCHEFORT
SOCIÉTÉ ANONYME DE L’IMPRIMERIE CH. THÈZE
Rue Chanzy, 123
l 906
J.-L. COURCELLE-SENEUIL
L’INTERVENTION
DES
POUVOIRS PUBLICS
LE CONTRAT DE TRAVAIL
J C£ l A y | u e |
l jg PÉ^IG-UEUx
J
♦
—--
ROCIÏËÉORT
SOCIÉTÉ ANONYME DE L’IMPRIMERIE CH. THÈZE
Rue Chanzy, 123
1 906
412
L’INTERVENTION DES POUVOIRS PUBLICS
DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL
I.
Si nous considérons la condition du genre humain sur la
planète, nous voyons qu’il ne peut vivre que par des efforts
soutenus, par son travail propre : il a charge de diriger son
industrie et de courir tous les risques qui y sont attachés. Ces
risques, on ne peut les prévoir qu’au fur et à mesure de l’expé
rience acquise, mais chacun et tous y sont exposés. On ne peut
s’y soustraire que dans une mesure étroite, par des contrats
comme celui de prestation de travail, qui met le risque à la
charge de l’entrepreneur. Mais il n’y a pas d’entrepreneur pour
passer un contrat semblable avec le genre humain, personne ne
pense et me prévoit pour lui : personne ne vient lui offrir un
salaire pour prix de son travail musculaire seulement. Chercher
un travail qui lui fournisse sa subsistance, est la condition du
genre humain et doit être par conséquent la condition de chaque
homme : celui qui voudrait rejeter sur autrui une part de la
charge commune, réclamerait un privilège incompatible avec le
principe fondamental de l’égalité des droits, de l’égalité juri
dique ; si l’on accédait à sa demande, il serait exempt, aux
dépens d’autrui, d’une charge que la nature impose à tous.
Avec le régime de la liberté et de l’égalité des droits, la con
dition du citoyen est identique à celle du genre humain sur la
planète. Si cette condition du genre humain semble dure, il faut
songer qu’elle est établie et déterminée par la loi de nature à
laquelle le vote, même unanime, de tous les hommes ne peut
rien changer ; qu’on l’appelle loi d’airain, qu’on proteste et
s’élève contre elle, elle est. Avec la liberté et l’égalité des droits,
chaque individu peut améliorer sa condition par son travail
isolé ou combiné avec celui de ses semblables au moyen d’arran
gements volontaires ; il ne peut l’améliorer d’une autre manière
— 4 —-
qu’en prenant le fruit du travail d’autrui, et alors il usurpe : la
liberté et l’égalité des droits cessent d’exister. Le gouvernement
n’est constitué que pour assurer, au profit de tous et contre
tous, le respect de ces principes desquels découlent toutes les
autres libertés, où nous voyons le droit rationnel suprême.
Sous le régime de la liberté du travail et de l’égalité devant
la loi, la formation de la propriété par l’échange des services et
l’échange des produits du travail fonctionne le mieux lorsque les
hommes sont à peu près également instruits de leurs intérêts,
également indépendants des premiers besoins, ce qui n’est pas
exact et ne peut jamais être absolument vrai. Les individus
comprennent d’une manière très inégale leurs intérêts ; ils sont
très inégalement indépendants des premiers besoins ; ils sont
surtout très inégalement prévoyants. De là se produisent entre
eux des différences nombreuses et presqu’infinies. Nous voyons
souvent le faible, c’est-à-dire le malade, l’inintelligent, le pauvre,
à côté de l’actif, de l’intelligent, du vigoureux, du riche.
Même dans la population la plus éclairée, la plus homogène,
il existe et il existera toujours de nombreuses et considérables
inégalités de ce genre. L’équité et surtout la charité ne s’accom
modent pas de la concurrence vitale, très sévère pour les faibles
et les imprévoyants. Les faibles ne sont pas nécessairement
coupables et le fussent-ils quelque peu, ils ont encore droit à
une certaine indulgence de la part des mœurs et de l’opinion,
sinon de la part du législateur.
Aussi haut que l’on remonte dans l’étude des temps histo
riques, on trouve que des pauvres et des indigents y ont existé
par masses considérables. La misère n’est donc pas un fait par
ticulier aux sociétés modernes, et lorsqu’on l’impute aux déve
loppements récents de l’industrie manufacturière ou à la concur
rence et à l’organisation moderne du travail, on commet une
injustice.
Cependant, chaque fois que le travail est moins demandé
dans quelque branche d’industrie que ce soit, ce sont les ouvriers
les plus médiocres, les plus inhabiles, les plus faibles en un mot,
qui sont privés de travail et qui tombent dans la misère.
L’universalité des salariés ne possède qu’une connaissance
très imparfaite de sa situation, de ses vrais intérêts, c’est-à-dire
les causes de hausse et de baisse des salaires dans toute l’indus-
— 5 —
•
trie et dans chaque branche, et n’a qu’un sentiment incomplet
des devoirs de prévoyance qui résultent pour eux du régime
économique sous lequel ils vivent. De là une cause puissante de
misère.
D’ailleurs, il faut le reconnaître, le sort du simple salarié est
fort rude, car les revenus de toute société humaine varient,
tantôt sous l’influence des causes humaines et sociales, tantôt
sous l’influence des causes physiques, et toute diminution des
revenus tend à réduire les salaires. La diminution des revenus
la plus grave, l’insuffisance des récoltes, pèse d’un poids énorme
sur cette partie de la population qui vit exclusivement du travail
de ses bras, parce que la disette diminue les capitaux libres,
entre les mains des capitalistes, diminue par suite le travail
demandé et diminue les salaires, alors que les aliments tendent
à s’élever beaucoup. Les chemins de fer, les bateaux à vapeur,
les télégraphes ont permis au commerce moderne d’atténuer
considérablement l’action des disettes dans notre époque actuelle,
mais chaque hiver permet de vérifier le bien fondé des observa
tions ci-dessus.
En admettant que l’ouvrier salarié soit animé d’un esprit
d’épargne énergique, il lui faut une rare patience pour former
un capital que la cherté des vivres et les maladies tendent sans
cesse à détruire. Il n’est pas étonnant qu’un certain nombre
d’hommes fléchissent sous le poids d’une telle épreuve. Et ceux
qui fléchissent sont perdus sans retour, car si l’imprévoyance
engendre la misère, la misère à son tour entretient et augmente
l’imprévoyance. La transition qui s’opère de l’état d’espérance et
de progrès à l’état de désespoir et d’affaissement marque en
quelque sorte le point minimum de la vie sous l’empire de la
concurrence vitale, c’est le point où disparaissent à la fois la vie
morale et la liberté. On descend facilement à la misère et par
mille avenues, mais il est difficile et presque impossible d’en
sortir.
La bienfaisance publique et privée recueille les individus ou
les familles que leur faiblesse aurait voué à la mort et pourvoit
à leur entretien. Mais un grave danger surgit, en s’habituant
à vivre d’aumône, l’homme qui était faible déjà dans la lutte dès
la concurrence, devient plus faible encore, chez lui tout senti
ment de responsabilité et d’énergie morale disparait.
— 6 —
Les secours et les aumônes étant seulement des palliatifs
dangereux pour venir en aide aux salariés menacés par la misère,
il faut recourir à l’instruction morale élémentaire, à l’instruction
primaire gratuite, chercher par tous les moyens possibles d’ame
ner cette partie de la population à considérer comme un besoin
absolu et de première nécessité la possession d’un petit capital.
Dans les cas de mauvaise récolte, de chômage, de maladie, son
petit capital s’interposerait entre elle et les besoins extrêmes ;
plus économe, plus prévoyante, elle userait de toutes les insti
tutions qui tendent à remplacer les risques par des sacrifices
périodiques et continus, de manière à soustraire davantage les
familles aux coups imprévus de la fortune.
Pour les capitalistes petits ou grands, leur intérêt privé
coïncide ici avec l’intérêt général qui est de voir placer chaque
jour des capitaux plus considérables dans de nouvelles entre
prises industrielles bien conçues, bien gérées, offrant des béné
fices aux gens économes et du travail à ceux qui en manquent,
ce qui fait de suite augmenter les salaires, en dehors de toute
intervention législative ou syndicale.
II.
Après avoir examiné la situation faite par la nature des
choses aux êtres humains dépourvus de force physique, d’intel
ligence, de prévoyance, d’énergie, etc., il convient d’examiner
maintenant cette foule humaine plus ou moins forte, robuste et
énergique, intelligente et instruite, etc., qui fait vivre les pau
vres eux-mêmes tout en fournissant les moyens d’existence à
des millions de familles en état de durer et de prospérer.
La vie est un mouvement continu, où le travail industriel
est tantôt plus, tantôt moins actif, tantôt plus, tantôt moins
intelligent. Dans un temps donné l’état industriel et l’état de
richesse semblent en équilibre, et sur ces états chacun règle ses
habitudes. Survient une perturbation générale (l’exemple des
mauvaises récoltes est le plus facile à vérifier), il faut que la
société consacre une somme de travail plus considérable à se
procurer des aliments et qu’elle diminue ses dépenses dans d’au
très branches où elle faisait travailler. D’où moins de travail
pour un certain nombre de salariés hors de l’agriculture. Avec
— 7 —
la prolongation de cette perturbation il se répand parmi les tra
vailleurs salariés un malaise, un véritable mécontentement, les
contrats de travail ne peuvent plus être loyalement exécutés, de
nombreuses faillites obligent l’industrie à employer plus de
capitaux pour faire les mêmes opérations, la propriété privée est
attaquée par des tentatives de violence qui réduisent le crédit et
obligent le Gouvernement à augmenter la police, les tribunaux,
etc. Une partie de l’industrie voit réduire sa clientèle, les usines
qu’elle emploie perdent leurs débouchés, le prix des marchan
dises augmente et chaque jour aussi augmente le nombre des
ouvriers
réduits au chômage ou à changer d’industrie. Cette
*
crise, pour revenir à l’équilibre normal, suivra invariablement
la série des péripéties bien connues : élévation du prix des objets
fabriqués, chaque consommateur réduira ses consommations,
les salaires industriels diminueront de prix, les plus pauvres
seront les plus durement frappés.
Tous les obstacles naturels ou artificiels qui viennent jeter le
trouble dans l’industrie libre, ont toujours cette même répercus
sion néfaste, calamiteuse.
A vrai dire, les obstacles naturels sont peu nombreux : la
distance et l’ignorance.
La distance ajoute des frais de transport au prix de revient
des marchandises.
L’ignorance cache à des parties entières de la population
leurs véritables intérêts et les éloigne du concours qui est ouvert
devant elles. C’est l’ignorance qui porte les industriels à produire
sans mesure, sans s’informer si le produit que l’on veut obtenir
est demandé, qui les conduit sur un marché sans débouchés, qui
les empêche d’offrir des produits ou des services sur un marché
où ils trouveraient un débouché assuré. L’ignorance conduit les
ouvriers salariés à faire des grèves, croyant pouvoir obliger les
entrepreneurs à augmenter artificiellement les salaires. L’igno
rance voit établir par les lois des obstacles artificiels, tels que
des monopoles, des règlements sur le contrat de travail, elle
voit fixer de même le taux de l’intérêt, le prix du pain et de la
viande, etc., sans protester contre cette intervention de la loi
dans un domaine qui ne devrait pas lui appartenir en des pays
d’hommes libres, intelligents et responsables de leurs actes.
L’ignorance est, en somme, la cause première et la mère de tous
— 8 —
les obstacles artificiels qui s’opposent au libre jeu de la concur
rence. Nous ne citons que pour mémoire les obstacles dus aux
différences de nationalité, de religion, de législation, de langage,
de mœurs qui existent parmi les hommes, les obstacles dus à
l’impôt nécessaire, inévitable pour payer les services communs
à tous.
Les obstacles que rencontre la liberté du travail et de l’in
dustrie ont un efiet commun, c’est d’empêcher le niveau général
des salaires des services de s’étendre dans tous les sens, d’éta
blir des inégalités en écartant du concours universel certaines
personnes, certains besoins.
Les obstacles ont pour résultat qu’avec une somme de travail
donnée, l’acheteur ne puisse satisfaire qu’une somme moins
considérable de besoins. Ils nuisent à la communauté, même
alors que certains individus en tirent avantage.
Les règlements sur le contrat de travail ont, en plus, cette
spécialité de rendre le travail général plus difficile et moins
fécond.
On peut dire à juste titre de tous les obstacles artificiels
qu’ils sont une violation de la propriété la plus respectable de
toutes, la propriété de son travail, la mère de toutes les proprié
tés de l’homme. Lorsqu’une disposition d’autorité vient dire à
certains individus qu’ils ne pourront librement concourir sur le
marché général des services, c’est une exception fâcheuse. Lors
que cette exception vient s’établir à la place de la liberté du
travail, elle est aussi préjudiciable à l’intérêt public qu’une spo
liation violente, qu’une expropriation sans indemnité.
Les effets moraux des obstacles artificiels sont pires que leurs
elfets matériels ; ils découragent tout esprit d’invention et de
perfectionnement, ils empêchent de sentir le stimulant de la
concurrence et opposent des difficultés à toute tentative d’amé
lioration. Ces difficultés naissant des lois et des hommes, ren
dent le peuple ennemi des institutions et des lois, divisent la
société en diverses classes, établissent entre ces classes des
oppositions d’intérêts, ce qui est la voie la plus sûre pour éloi
gner l’esprit public des idées de travail et de progrès indus
triels.
On se soumet sans murmurer aux obstacles qui naissent de
la nature même des chose ; on n’a que de la répugnance et de la
— 9 —
haine pour ceux qu’établissent le caprice, la ruse, l’avidité et la
rapacité de l’homme.
Il est évident que l’humanité tend de plus en plus à restrein
dre l’effet des obstacles naturels et à diminuer le nombre des
obstacles artificiels. Partout on sent que l’ignorance est un mal
auquel on cherche à remédier, partout on travaille à améliorer
les moÿens de.communications, à effacer les différences de natio
nalités et de langues, on s’efforce partout de rendre l’impôt
moins nécessaire et moins lourd, et par la simple impulsion du
besoin d’obtenir les services à bon marché, la plupart des mono
poles, règlements et tarifs ont été abolis ou sont devenus odieux.
De deux nations soumises à peu près au même régime indus
triel fondé sur la propriété individuelle et sur la concurrence,
celle qui multipliera le plus les obstacles artificiels et qui luttera
le moins centre les obstacles naturels sera bientôt inférieure à
l’autre. Dans celle où l’industrie sera le plus libre, les richesses
et la population augmenteront le plus rapidement, et l’esprit
d’invention, de progrès et de travail, ce grand moteur de toute
industrie s’y montrera plus puissant que dans la première nation
considérée.
La liberté est une condition de progrès et les obstacles une
condition de décadence. La restauration d’un système d’obstacles
artificiels, au bout de quelques années, amène l’inquiétude, la
défiance, le sentiment d’une injustice que l’on subit, le travail
industriel se décourage, les ruines s’amoncellent, la population
cesse de croître ou décroît.
III.
Les contrats, en général, naissent de la volonté libre des
individus et prennent mille formes, suivant la situation et les
besoins des contractants, qui s’engagent pour un temps plus ou
moins long dans telles ou telles conditions, à donner, à faire ou
à ne pas faire quelque chose.
Il est nécessaire à la sûreté des transactions et au progrès de
cette confiance réciproque des hommes les uns pour les autres,
qui est l’âme de la vie sociale, que la loi définisse exactement les
limites dans lesquelles les contrats peuvent être consentis, les
conditions générales auxquels ils seront valides, ainsi que celles
- 10 sous lesquelles leur existence et leur caractère doivent être
prouvés en cas de contestation.
La loi française met quatre conditions à la validité des con
trats, savoir le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité
de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engage
ment, une cause licite dans l’obligation. La loi détermine aussi
quelles sont les personnes incapables de contracter. En dehors
de ces règles nécessaires, il est utile que la liberté des contrats,
complément naturel de la propriété individuelle, soit entière ou
du moins que toute exception soit justifiée par des considéra
tions particulières d’un très grand poids. L’article 1134 du Gode
civil dit expressément : « Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Le contrat de prestation de travail est celui par lequel une
partie s’oblige à fournir les services de son travail à une autre
partie qui les accepte aux conditions déterminées entre elles.
Chaque fois qu’un individu s’engage envers un autre à lui
prêter ses services en échange d’une rémunération, il existe
entre ces deux individus un contrat de prestation de travail, quel
que soit, d’ailleurs, le genre de service qui en fait l’objet. Qu’il
s’agisse de l’avocat et de son client, du médecin et de son malade,
du commissionnaire et du marchand, de l’architecte et du pro
priétaire, de l’ouvrier et du fabricant, du domestique et de son
maître, il n’y a de différence que dans la nature des services
rendus par ces divers individus : il n’en existe aucune dans la
natür'è du contrat qui les lie.
Tout, contrat étant fondé sur l’indépendance et sur l’égalité
civile des deux contractants, ne constitue jamais que de simples
obligations établies par la volonté libre des contractants et qui
doivent être respectées par eux.
Dans les cas les plus nombreux, le contrat de prestation du
travail établit des relations de commandement d’une part, de
dépendance de l’autre, lorsque l’ouvrier s’engage à la journée, le
commis au mois et le domestique à l’année. Toutefois, même
dans le cas extrême du domestique, ce n’est qu’une dépendance
limitée par l’usage et temporaire ; à la fin du contrat, chacun des
contractants se trouve libre d’obligations.
La loi et l’usage peuvent établir utilement certaines règles
spéciales pour les contrats de travail, mais il est bon que ces
- 11 règles soient aussi simples et aussi peu nombreuses que pos
sible. C’est ainsi que, dans l’intérêt même de la conservation de
la liberté du contrat de prestation du travail, lés lois ont décidé
que « nul ne pourrait être forcé de faire » et que toute obligation
de faire non accomplie se résoudrait en une demande de dom
mages-intérêts. Celui qui ne possède rien ou presque rien, dont
on aurait pu .abuser par un contrat de trop longue durée, ne
contracte qu’une obligation morale sans sanction actuelle et
effective, alors que celui qui contracte avec lui est toujours pas
sible d’une sanction en dommages-intérêts. D’où l’acheteur du
travail d’autrui, conduit par son propre intérêt, abrège le plus
possible les temps des engagements. Sous ce régime, la durée
des contrats de travail s’est réduite au jour et à l’heure, main
tenant celui qui vend son travail sous l’empire de la liberté,
dans la nécessité de prévoir constamment et de pourvoir à ses
besoins. La règle que « nul ne peut être forcé de faire » main
tient le vendeur et l’acheteur de travail dans une indépendance
réciproque, pénible, mais salutaire.
Ces quelques règles suffisent à guider la justice pour veiller
à l’exécution des contrats. Légiférer davantage expose à de gra
ves inconvénients. Il paraît inutile de rendre plus difficiles, plus
compliqués, les rapports existants entre les habitants d’une
même contrée, de s’efforcer de les parquer, qu’ils le veuillent ou
non, en classes ayant des lois et des devoirs différents, de les
empêcher de conclure des contrats utiles et honnêtes qui échap
peraient aux classifications arriérées et incompétentes des règl
0UE
E A y ff. ; £ '
ments officiels.
^S^âCUEUX'
On attaque avec une grande violence les contrat:
tion de travail, sous prétexte que la situation des deux contrac
tants n’est pas égale, comme si cette situation était égale dans
aucun contrat, comme si, dans la société collectiviste, la'situa
tion de l’ouvrier ayant encouru la disgrâce des meneurs dicta
toriaux devait être préférable.
Si l’ouvrier ne pouvait contracter, il serait mineur, il faudrait
lui donner un tuteur et cesser de parler d’égalité devant la loi,
ce qui est la base de la société moderne.
Il faudrait surtout lui retirer le droit de vote, qui ne saurait
être attribué qu’à un adulte majeur et responsable de ses actes.
Si l’ouvrier est majeur, on peut admettre les associations
— 12 —
coopératives ouvrières de toute nature, bien que le succès ne
puisse que rarement couronner les entreprises de ce genre, qui,
généralement, méconnaissent la valeur des capitaux importants
et les avantages d’une direction stimulée par l’intérêt personnel
devant l’aiguillon de la concurrence. On peut admettre les asso
dations commerciales du travail, composées d’hommes libres,
responsables, associant leurs efforts, leur temps, afin d’augmenter
les bénéfices de leurs travaux.
Mais il est impossible d’admettre des associations d’hommes
non libres, contraints et forcés, organisant la guerre à l’état per
manent au milieu de la société moderne, des groupements ayant
pour but de s’emparer des richesses accumulées par le travail,
l’épargne et l’héritage entre les mains de personnes auxquelles
on ne peut reprocher ni fraudes, ni violences.
Les patrons d’une même industrie peuvent croire que les
ouvriers seront contraints, bon gré mal gré, d’accepter un salaire
très bas, si tous les patrons refusent de payer à l’ouvrier plus
qu’une certaine somme. Les ouvriers, de leur côté, peuvent
croire qu’ils ont intérêt à se lier entre eux pour exiger un salaire
supérieur à celui qui leur est offert et que, par une coalition
énergiquement maintenue, ils parviendront à l’imposer.
On se fait évidemment illusion de part et d’autre ; sous l’em
pire de la liberté, les salaires sont déterminés uniquement par
la loi qui régit l’échange des produits du travail.
Supposez qu’une coalition de patrons abaisse les salaires ou
les empêche de s’élever dans une branche d’industrie : d’une
part, les ouvriers de cette branche seront refoulés dans les autres
branches d’industrie ou poussés à l’émigration, ou du moins
leur nombre n’augmentera pas ; d’autre part, toutes les entre
prises de cette branche d’industrie donnant des profits, il s’en
établira de nouvelles doht la concurrence tendra, d’un côté à
abaisser les prix, de l’autre à élever les salaires, la majorité des
entrepreneurs ayant un intérêt à payer un salaire plus élevé
pour obtenir les ouvriers devenus plus rares dans une branche
d’industrie qui donne des profits.
Supposez maintenant qu’une coalition d’ouvriers porte les
— 13
•
salaires au-dessus de leur taux naturel, soit en les élevant, soit
en les empêchant de s’abaisser. La demande du travail dimi
nuera, chaque entrepreneur, obligé d’élever les prix du produit,
fabriquera moins, certains entrepreneurs cesseront de fabriquer.
Une partie seulement des ouvriers sera employée. Que deviendra
l’autre partie? Emigrera-t-elle, lorsqu’elle pourrait, en abaissant
un peu ses prétentions, obtenir un salaire moyen? Si elle émi
gre, ne viendra-t-il des autres corps d’état ou du dehors des
ouvriers pour offrir un travail rémunéré au-dessous du taux
naturel ?
En fait, les coalitions sont impuissantes Contre la loi natu
relle qui régit en souveraine l’industrie.
Il est possible qu’à un moment donné, les entrepreneurs
trouvent les salaires trop élevés et qu’à un autre les ouvriers les
trouvent trop bas. Dans le premier cas, il n’y a de remède que
dans l’alternative de réduction du nombre des entreprises ou
d’augmentation du nombre des ouvriers ; dans le second, le
remède est dans l’alternative de réduction du nombre des ouvriers
ou d’augmentation du nombre des entreprises. Toutes les tenta
tives que l’on peut faire pour échapper à ces deux alternatives
ne sauraient aboutir qu’à des déceptions.
Si les patrons et les ouvriers connaissaient mieux les consé
quences de leurs actes, ni les uns ni les autres ne feraient de
coalitions pour abaisser ou élever artificiellement le taux des
salaires. Chacun saurait que les mouvements de hausse ou de
baisse imprimés aux. salaires, par les oscillations du prix des
produits, seront d’autant moins violents, d’autant moins dou
loureux pour le groupe auquel il appartient, que chaque individu
prendra plus vite et séparément le parti qui convient le mieux à
ses intérêts. Les coalitions n’empêchent pas ces mouvements,
mais les rendent plus brusques et plus douloureux par les
secousses qu’elles impriment au prix courant et par la perte de
forces productives à laquelle elles donnent lieu. Lors d’une grève,
même victorieuse, la plus grande partie des pertes reste toujours,
en définitive, à la charge des entrepreneurs et des ouvriers.
Puisque le châtiment de ceux qui se coalisent pour faire
hausser ou baisser les salaires est inévitable et direct, il est au
moins inutile que l’autorité publique intervienne pour régle
menter les coalitions. L’autorité en cette matière n’a qu’une
— 14 —
mission utile, celle de maintenir la paix publique et de défendre
la liberté de chacun, d’empêcher que ceux qui s’écarteraient des
prescriptions d’un comité de coalition fussent violentés par des
moyens que punit la loi commune chez tous les peuples civilisés,
tels que coups, outrages et menaces d’une certaine nature. En
dehors de cette mission gui rentre dans ses attributions nor
males, l’autorité ne saurait intervenir que dans les coalitions,
sans causer plus de mal que de bien. L’intervention de l’autorité
dans les rapports d’atelier présente, d’ailleurs, les inconvénients
de rendre ces rapports plus aigres, plus difficiles, d’écarter les
discussions et les transactions à l’amiable, de nuire d’une manière
permanente à la bonne intelligence des entrepreneurs et des
ouvriers, de manière de causer au pays une perte de puissance
productive plus grande que celle qui résulterait des coalitions
libres.
Tous les expédients proposés pour élever artificiellement les
salaires dans toute l’industrie tendent à remplacer la liberté du
travail par l’autorité régissant le travail, parce qu’il faut absolu
ment que l’homme observe librement les lois établies par la
nature, ou soit forcé de les observer par autrui ou périsse pour
ne les avoir pas observées. Il n’est pas de puissance humaine qui
ait la faculté de soustraire l’individu à cette triple alternative.
La liberté est en même temps le régime le plus fécond quant
à la société considérée collectivement, le plus conforme aux légi
times susceptibilités de la dignité personnelle et le moins vio
lent, celui dans lequel les avertissements devancent le plus la
sanction nécessaire. On sait d’avance que le taux des salaires est
réglé par les rapports qui existent, l’art industriel étant donné,
entre la somme des capitaux employés aux entreprises, et le
nombre des ouvriers. Il ne peut hausser que par des progrès de
l'art industriel, par l’augmentation des capitaux placés dans les
entreprises industrielles ou par une réduction du nombre des
ouvriers. Il importe que ceux-ci le sachent bien et agissent en
conséquence.
V.
L’intervention du pouvoir législatif dans l’organisation du
travail s’est manifestée de la manière la plus grave par la pro-
— 15 —
mulgation de la loi des 21-22 mars 1884 relative à la création des
syndicats professionnels.
Cette loi abrogea la loi du 14 janvier 1791 qui déclarait la
liberté du travail une des bases fondamentales de la Constitution
française.
Elle abrogea l’article 416 du Code pénal punissant tous
ouvriers, patrons et entrepreneurs d’ouvrages qui, à l’aide
d’amendes, défenses, prescriptions, interdictions prononcées par
suite d’un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice
de l’industrie et du travail.
Cette loi rendit licites les actes que l’article 416 punissait.
Certaines associations, appelées syndicats professionnels, se
trouvent, par suite, dispensées de certaines dispositions pénales
auxquelles restent soumises les autres associations et certains
faits constituant des délits pour le commun des Français ne
seront pas des délits lorsqu’ils émaneront des syndicats profes
sionnels.
Cette loi n’est pas motivée par quelque grand intérêt public,
elle ne vise que des intérêts privés : l’étude et la défense de
leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agri
coles (article 3).
Contre qui ces intérêts ont-ils besoin d’être défendus ? Ce
n’est pas contre des actes de violence ou de fraude que la force
publique réprimerait en appliquant les dispositions du Code
pénal. Il s’agit donc de défendre ces intérêts contre des actes qui
seraient accomplis dans l’exercice du droit commun, actes que
la loi ne déclare pas illégitimes, ni ne réprime, mais dont elle
abandonne la répression aux syndicats professionnels chargés
d’écraser par une organisation militaire en quelque sorte, l’action
d’individus agissant librement dans la sphère des attributions
que la loi leur a conférées et reconnues, en vertu du principe de
la liberté du travail.
Ce dernier principe se rattache étroitement à l’obligation pour
chaque citoyen de vivre de son travail et à la propriété privée
telle que la Révolution l’a comprise et définie.
Les syndicats professionnels peuvent s’attribuer en fait juri
diction sur tous les individus engagés dans la même profession.
Chaque ouvrier pourra être tenu de travailler, non plus dans
l’atelier qui lui convient et à des conditions qu’il aura librement
— 16 —
débattues, mais à des conditions déterminées par les directeurs
du syndicat de sa profession, et seulement dans les ateliers où
ils l’auront autorisé à travailler. Dans ce cas, il n’est plus libre
de conclure un contrat duquel dépend, qu’il ait ou n’ait pas des
moyens d’existence, le pain du jour et du lendemain ! Ainsi
encore les directeurs du syndicat pourront décider qu’on lèvera
un impôt sous le nom de cotisation et qu’aucun entrepreneur
n’emploiera des ouvriers qui se seraient refusés à payer cet
impôt, que l’ouvrier ayant accepté du travail à d’autres condi
tions que celles fixées par le syndicat, sera puni d’une amende
ou exclu de la profession, qu’il sera même exclu, s’il a travaillé
chez un patron interdit ou proscrit par le syndicat, etc.
Voilà donc un gouvernement constitué qui lève par contrainte
un impôt, qui commande, qui défend, établit des règlements,
juge et condamne, et cela à côté des législateurs et des magis
trats de droit commun. Il ne manque à ce gouvernement que de
disposer de la force publique. L’histoire des Unions anglaises
nous apprend qu’il peut s’en passer.
Il est vrai que les articles du Gode pénal qui punissent les
crimes contre les personnes restent en vigueur même contre les
directeurs des syndicats.
De même l’article 7 permet au contribuable de se retirer de
l’association. Cette faculté garantie au simple ouvrier peut rester
écrite, mais sans effet. L’expérience prouve que maintes fois des
minorités audacieuses et sans scrupules ont dominé des majo
rités considérables. Cette loi semble supposer que les privilégiés
devant laquelle s’abaisse la loi pénale ne peuvent jamais abuser
et sont en quelque sorte impeccables. Aucune précaution n’a été
prise pour que les syndicats se constituent suivant les mêmes
règles et qu’ils soient animés de quelque esprit de justice ; rien
ne garantit que les syndicats aient quelque chose de profession
nel, puisqu’on peut réunir aux gens d’une profession ceux des
métiers similaires ou connexes (article 2) et que ces syndicats
pourront former des unions pour la défense de leurs intérêts
économiques, industriels, commerciaux et agricoles (article 5).
Contre qui sera dirigée cette défense? La loi ne le dit pas.
On dirait qu’il n’y avait plus de gouvernement et qu’on fai
sait appel aux intérêts privés pour s’empresser d’en constituer
un et de l’établir sous la forme d’une féodalité de nouvelle espèce.
— 17 —
On substitue à la concurrence libre des individus sous la pro
tection des lois, une guerre sans loi dans laquelle les syndicats
doivent dominer et opprimer les travailleurs isolés. Le Gouver
nement, dépouillé du droit d’autoriser les syndicats, est aussi
dépouillé du droit de les surveiller. Les syndicats peuvent se
constituer à perpétuité et pour tel temps qu’ils jugeront conve
nable ; ils peuvent observer leurs statuts ou les violer sans que
le Gouvernement ait rien à y voir. Ils peuvent se liquider comme
il leur plaira en cas de dissolution. Le Gouvernement ne contrôle
pas leur gestion financière. Ils peuvent employer (on ne dit pas
à quel usage) les sommes provenant des cotisations. Ils pourront
sans doute aussi détourner les fonds de ces caisses et les appli
quer à solder des grèves ; ils ont le droit d’acquérir, de posséder,
d’ester en justice, etc. Ainsi, des associations fondées sans con
trôle de l’autorité publique et en dehors de toute surveillance,
ont des facultés qui sont refusées, à juste titre, aux établisse
ments publics et aux établissements d’utilité publique. On a
reconstruit pour elles le droit du moyen âge, si glorieusement
renversé par la Révolution.
VI.
L’institution des syndicats entraîna pour conséquences,
d'abord l’intervention de leurs Unions ou Confédérations chaque
fois que le Gouvernement aurait à innover dans la police de l’in
dustrie ou dans la politique commerciale, et toujours ces Unions
interviendront avec la plus grande énergie contre la liberté, puis
ensuite l’organisation des grandes grèves. Dans ce dernier cas,
au nom de quel principe le Gouvernement pourra-t-il protéger la
liberté des dissidents opprimés ?
Sans doute, les hommes éclairés savent que ni les grèves, ni
même les actes de l’autorité publique ne peuvent déterminer le
montant des salaires ; mais il y a tant d’hommes entre les ouvriers
et dans toutes les parties de la société qui, certainement, igno
rent cette vérité simple ! Les inclinations des syndicats doivent
les porter vers la grève, et, de fait, depuis la promulgation de la
loi de 1884, l’industrie française est plus exposée aux grèves,
alors que l’administration est plus désarmée. A peine celle-ci
pourrait-elle intervenir pour réprimer des crimes positifs et
I
I
— 18 —
patents. Elle n’ose plus faire respecter l’inviolabilité du domicile
et appliquer avec énergie l’article 184 du Code pénal.
Sous le régime de la liberté du travail, le cours des salaires
est réglé par une loi naturelle, irrésistible, fondée sur les incli
nations primitives de l’homme. Le concours libre, à conditions
égales entre tous ceux qui participent à l’industrie, est la condi
tion la meilleure pour qu’une société obtienne en tout temps les
divers produits de l’industrie au meilleur marché possible et
puisse soutenir avec le plus d’avantages possibles la concurrence
vitale. Nous ne saurions trop le répéter, la liberté du travail est
le régime le plus fécond, c’est aussi le plus juste. On dit bien
souvent que ce régime est injuste pour les ouvriers obligés d’ac
cepter le salaire qui leur est offert par un entrepreneur qui peut
attendre. Rien n’est moins exact que cette assertion. Si l’ouvrier
ne peut suspendre son travail parce qu’il a besoin de vivre, le
patron ne peut suspendre le sien parce qu’il a besoin de ne pas
se ruiner.
Si les entrepreneurs pouvaient réduire les salaires à leur gré,
jamais ceux-ci ne se seraient élevés au-delà de la somme stricte
ment nécessaire à la subsistance de l’ouvrier. Or, les salaires se
sont élevés, et l’élévation la plus considérable a eu lieu dans
l’agriculture, c’est-à-dire dans la branche d’industrie dont les
ouvriers se sont le moins concertés pour lutter.
Une profession qui veut imposer l’élévation des salaires n’a
qu’un moyen d’éluder l’action de la loi naturelle, c’est d’exclure
les ouvriers recevant un salaire moindre, quittant leur métier
pour offrir leurs services dans cette profession. Il y a là un acte
d’oppression commis par ceux qui gagnent plus contre ceux qui
gagnent moins, en attendant que l’élévation du prix de revient
ne permette plus à l’entrepreneur de soutenir la concurrence des
entrepreneurs étrangers.
Les Unions de métier sont hostiles aux ouvriers supérieurs
en valeur technique ou morale, à toutes les inventions du travail
aux pièces, au marchandage, aux machines et outils qui abrègent
le travail.
Si toutes les tentatives pour réglementer l’industrie nuisent
au progrès, elles lui nuisent davantage par l’abaissement moral
de toul le personnel qui s’habitue à chercher l’amélioration de
son sort, non plus dans son effort propre, mais dans des combi-
— 19 —
naisons artificielles qui tendent toujours à l’élimination, à l’op
pression des plus faibles, tels que manœuvres, femmes et appren
tis, dont la masse refoulée injustement tend à tomber à la charge
de la charité publique. Cette masse peut dire à juste titre que
ceux qui ne lui ont pas laissé la liberté de gagner sa vie par son
travail doivent pourvoir à ses besoins.
Il est évident que la loi de 1884 doit être revisée et le plus
promptement possible sera le meilleur. Les syndicats ne peuvent
avoir la personne civile qu’avec la surveillance de l’administra
tion sous conditions définies.
Il y a lieu de définir avec précision le caractère et les attribu
tions des syndicats, et d’en décrire les conditions comme la loi
de 1867 a décrit la forme des sociétés commerciales, dire com
ment ils se formeront, à quelles conditions on pourra en deve
nir administrateur, quelles seront les responsabilités, comment
seront punies les infractions, etc.
En définitive, les syndicats professionnels existent, ils peu
vent être utiles aussi bien aux patrons qu’aux ouvriers, pour
recueillir et donner des renseignements sur les conditions de
travail,
de salaire, etc., des diverses régions, des divers pays,
«
des diverses industries, pour conseiller aux uns et aux autres
les meilleures mesures à prendre en commun, à enseigner à cha
cun ses droits et ses devoirs, ses réels intérêts. Mais la juridic
tion, le pouvoir réglementaire et de coercition n’appartiennent
qu’aux magistrats investis de la puissance publique. Ces défauts
ont fait dire, en 1884, que le projet de loi, présenté sans doute
avec les meilleures intentions, était contraire à la liberté, con
traire à l’égalité, destructif de la bonne organisation des pou
voirs, féodal en un mot, dans la plus mauvaise acception du
terme. Sur ce chapitre des coalitions, les ouvriers anglais com
mencent à être bien renseignés. Le quatorzième Congrès annuel
de la Nationale Free Labour Association, organisation ouvrière
anti-socialiste, s’est réunie, le 29 octobre 1906, à Londres. L’as
sociation compte 600,000 membres. Elle se déclare opposée à la
politique des Trades Unions et des tendances socialistes de ses
chefs. Cette association des jaunes se flatte d’avoir terminé,
depuis sa fondation, 546 grèves sans fondement. Il est vrai que
les syndicats, voyant la lutte difficile depuis l’entrée en jeu de la
Free Labour Association, se sont adressés au Parlement pour
— 20 —
obtenir législativement le droit d’opprimer les travailleurs indé
pendants.
VII.
La loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents
dont les ouvriers sont victimes dans leur travail intervient dans
les rapports entre patrons et salariés en imposant au chef d’in
dustrie l’obligation de payer une indemnité à l’ouvrier victime
d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Elle
impose au patron l’obligation d’être l’assureur de son personnel,
avec faculté de se réassurer, mais sans pouvoir faire subir de
retenues aux salaires pour payer les primes.
Les charges patronales sont devenues très lourdes, mais, en
fin de compte, qui paye les primes ? Quand le patron peut les
faire payer à ses clients, il ne manque pas de le faire, c’est ainsi
qu’on a vu s’élever les prix de séries des diverses industries du
bâtiment. Quant le patron ne peut relever les prix, à cause de la
concurrence étrangère, il réduit les salaires de ses ouvriers ou,
ce qui revient au même, il résiste formellement à toute demande
d’augmentation.
L’ouvrier victime d’un accident, dans le cas d’infirmités gra
ves, reçoit une indemnité qui l’empêche de tomber dans la plus
noire misère, comme cela se produisait autrefois. Il n’est plus
obligé de faire la preuve que l’accident a été produit par une
faute du patron ou de l’un de ses préposés. Il doit seulement
faire la preuve de la relation entre l’accident et les blessures ou
la maladie dont il se plaint.
Le but poursuivi était d’amener l’apaisement social ; il fit
imposer à notre industrie une charge annuelle supérieure à
60 millions. Mais, à l’application, la loi se révéla comme une
véritable loi d’irritation sociale.
Les retenues des frais opérées sur les premiers arrérages de
la rente obtenue parla victime laissaient celle-ci sans ressource
pour vivre.
Les lois du 22 mars 1902 et du 31 mars 1905 intervinrent et
firent des ouvriers de véritables privilégiés en leur accordant
l’assistance judiciaire pour la défense de leurs droits devant les
tribunaux. Cette faveur se retourne contre les ouvriers. Pour
défendre ses intérêts contre le représentant de l’assurance, l’ou-
- 21 -
vrier a besoin d’un agent d’affaires, d’un avocat, d’un avoué,
d’un médecin-expert. C’est dans le moment où la maladie du
chef de famille provoque une gène dans son ménage qu’il lui
faut songer à donner des honoraires à ses défenseurs. Doréna
vant, chaque ouvrier ou employé devra verser une prime
annuelle dans les caisses d’une assurance, pour en recevoir, le
cas échéant, les moyens de soutenir son procès avec chances de
gain.
Pour établir la loi de 1898, il fallut passer outre au principe
de droit français que « nul ne doit être puni s’il n’a commis de
faute. » Le patron fut déclaré coupable et responsable de tout
accident et il dut payer tout dommage éprouvé. Pour éclaircir
cette loi, il fallut 3 lois nouvelles en 1899, 1 en 1902, 1 en 1905,
1 en 1906, 16 décrets, 24 arrêtés ministériels, 10 circulaires et
nombre d’avis du Comité consultatif institué au ministère. Et
cette loi s’est révélée une mine à procès !
Jamais il n’y eut autant de procès.
Autrefois, il y avait peu de procès, car la victime était plus
ou moins secourue par son patron, aujourd’hui ce dernier s’est
découragé, car la législation est devenue des plus rigoureuses
pour lui. Maintenant, sous l’impulsion des agents d’affaires,
beaucoup d’ouvriers ne veulent plus d’accommodement. Ils veu
lent plaider quand même, poursuivre, espérant qu’à tout hasard
on établira une faute du patron et qu’alors ils obtiendront audelà de ce que la loi leur garantit. Sous cette influence, le tarif
des assurances a augmenté, et cette charge, pour les petits
patrons, n’est plus insignifiante.
Ces lois de 1884, 1898, etc., procèdent de cet esprit de pater
nalisme qui conduit à faire des ouvriers de l’industrie de véri
tables privilégiés chaque jour plus semblables aux militaires et
chez lesquels on arrive à éteindre tout sentiment de responsa
bilité, de prévoyance, d’initiative individuelle.
Si la loi de 1898 a eu, en partie, les résultats prévus, indem
nités forfaitaires assurées aux travailleurs, elle a produit d’au
tres effets néfastes, spécialement la multiplication constante du
nombre des accidents.
Les accidents simulés et les accidents insignifiants font aug
menter chaque jour le nombre des ouvriers qui tentent d’abuser
de la loi. Ces accidents finiront par imposer aux industriels des
— 22 —
charges aussi lourdes que les accidents graves et inciteront de
plus en plus les ouvriers à la simulation et à la paresse.
Des agences racolent les blessés aux portes des mairies, des
justices de paix, des médecins des assurances, des hôpitaux, les
amènent à se faire appliquer des traitements médicaux coûteux,
convenant ou non au genre d’infirmité, afin de présenter à l’as
sureur une note corsée.
La production injustifiée de certificats d’incapacité perma
nente sans même préciser la nature de l’infirmité, fait mettre
sans relâche toute la machine judiciaire en mouvement, d’où
enquêtes et tentatives de conciliation. Là interviennent les agents
d’affaires qui, sous la menace de procès, organisent un véritable
chantage contre les chefs d’entreprises. Le nombre des procès
mis sans aucun prétexte à la charge des industriels est très con
sidérable ; à Paris, il atteint le tiers des affaires jugées.
L'ancienne législation faisait un sort déplorable à l’ouvrier
victime d’accident ; on a bien fait de retourner la présomption,
mais on a exagéré en tenant d’avance le patron pour coupable et
responsable. Il en est résulté, sans diminution des procès, une
grande augmentation des accidents simulés ou exagérés et de
véritables iniquités comme l’attribution forcée d’indemnités dans
le cas où le blessé n’a pas été victime, ou ne l’a été que de fautes
dont il devrait supporter la peine. On s’est accoutumé à consi
dérer le patron comme une tête de turc sur laquelle on pourrait
toujours frapper sans inconvénient, de même que l’on s’habitue
à considérer le capital comme pouvant être indéfiniment attaqué
au profit du travail. Le résultat est de plus en plus le développe
ment de sentiments de jalousie, de malveillance ou de haines
funestes à la prospérité générale, et l’appauvrissement des tra
vailleurs eux-mêmes, par suite de cette série de répercussions
qui font toujours retomber l’effet des mesures injustes sur ceux
qui s’en croient les bénéficiaires.
On a démontré, une fois de plus, l’impuissance et le danger
de la perpétuelle intervention de l’Etat et de la substitution des
formules au libre jeu des discussions et à l’appréciation particu
lière des cas particuliers.
Maintenant, pour sauver l’ouvrier du péril de l’agent d’affai
res, il faudrait que les syndicats soient ramenés par la loi à ce
qu’ils devraient être, ce pourquoi ils ont été créés, des centres
- 23 —
d’informations, de véritables conseils judiciaires, pour aider et
conseiller les victimes des accidents.
VIII.
Le repos hebdomadaire est une chose désirable en soi, mais
encore faut-il pouvoir s’en payer les frais, et ce n’est malheu
reusement pas une loi humaine qui en fournira les moyens aux
pauvres gens, chargés de famille', que chaque jour de chômage
enfonce de plus en plus dans la misère.
La loi sur le repos hebdomadaire a voulu décréter l’unifor
mité et tout le monde sait à quelles difficultés elle a donné nais
sance. Pourquoi ne pas laisser à chaque industrie organiser les
jours de repos suivant les besoins de sa propre existence ? A
vouloir faire des réglementations rigides et autoritaires sur tout,
on arrive forcément à des impossibilités notoires.
Maintenant, rien n’est plus à l’ordre du jour que l’interven
tion dans le contrat de travail lui-même, et un projet de loi a été
déposé en juillet 1906. L’Allemagne et la Belgique ayant établi
des dispositions légales développées sur ce contrat, leur exemple
ne doit-il pas entraîner l’univers ?
Tout en voulant bien admettre que le contrat fait la loi des
parties, les protagonistes de la réglementation trouvent que la
loi doit faire parler, malgré eux, les contractants et les enserrer
dans des dispositions légales interprétatives, impératives ou
prohibitives dont les parties ne puissent déroger.
Ne faut-il pas mettre sur le pied d’égalité l’employeur qui
court tous les risques et l’employé qui est assuré de toucher son
salaire régulièrement? Tous les deux sont obligés de travailler
tous les jours, afin de pourvoir à l’entretien d’eux-mêmes et de
leurs familles, mais l’employeur possédant des capitaux ayant à
craindre la ruine et la misère, mais l’ouvrier sans capitaux,
obligé d’accepter le salaire fixé par l’entrepreneur, comment les
rendre égaux ?
Sans doute, la loi rendra les familles ouvrières plus riches,
plus économes et placera sur leurs épaules une grande partie des
risques de l’employeur, sans doute elle débarrassera celui-ci de
la plus grande partie des capitaux que lui et les siens auront eu
l’imprudence d’accumuler ? Hors de cette transformation radi-
- 24
cale, il est difficile de concevoir l’égalité entre ces deux ordres
de travailleurs.
Pour établir la future loi, il faut rechercher les abus les plus
graves et les plus fréquents qui, sans doute, n’étaient pas répri
més sous les lois actuelles ? Voici ces abus : le patron ne posera
plus les conditions du travail dans son atelier (montant du
salaire, date et lieu de paiement) ; le règlement d’atelier ne pourra
être mis en vigueur qu’après avoir provoqué les observations
des ouvriers ; la loi fixera le taux des cautionnements, amendes,
etc. ; si l’ouvrier est admis à la participation des bénéfices, il
devra pouvoir vérifier les comptes du patron ; le salaire ne sera
jamais payé en nature, ni remis aux ouvriers dans les caba
rets, etc.
Les novateurs ne s’aperçoivent pas que le règlement d’atelier
est une question d’ordre intérieur qui échappe absolument à la
législation, et qu’à réglementer d’autorité le contrat de travail
on va tout droit à la prétention de réglementer les salaires.
En réalité, les principes actuels posés par le Gode civil sont
amplement suffisants. C’est aux particuliers à s’arranger entre
eux.
Mais le désir de la réglementation à outrance sévit avec
fureur. Dans la dernière session de la Chambre des députés, il a
été déposé, sous la signature de 54 députés socialistes unifiés,
une demi-douzaine de propositions ayant pour objet quelques
interventions de plus dans les rapports des ouvriers avec les
patrons et l’expropriation de ceux-ci.
La grande industrie ne peut s’établir partout. Une exploita
tion minière est tenue de s’installer là où sont les gisements,
fût-ce dans une région déserte. Auprès des bâtiments industriels
s’élèvent des habitations ouvrières, les objets de consommation
sont rassemblés dans des magasins ou économats.
Dans certains cas, il s’est produit des abus, des patrons ayant
tenu l’ouvrier par le manque d’argent et porté les plus graves
atteintes à sa liberté. Il est facile de porter remède à ces abus,
soit par le concert des ouvriers, soit par la loi.
A côté des économats défectueux, il en est d’autres, et c’est
la grande majorité, qui rendent de réels services à de très nom
breux ouvriers. L’exposé des motifs indique le remplacement de
ces économats par des sociétés coopératives de consommation, à
25
l’administration desquelles les patrons devront rester étrangers.
Il s’agit probablement de donner au syndicat, en faisant de lui
le maître de la société coopérative, l’influence que l’économat
patronal ne lui permet pas de prendre. En cas de conflit, la
société coopérative pourra couper les vivres à ceux qui ne vou
dront pas obéir au mot d’ordre, tandis qu’avec les subsides
alloués aux chômeurs par d’autres syndicats, elle pourra faire
durer la grève plus longtemps qu’avec le crédit forcément limité
des petits commerçants ?
Une proposition réclame l’abrogation des articles 414 et 415
du Gode pénal, qui punissent quiconque, à l’aide de violences,
voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené
ou maintenu, tenté d’amené ou de maintenir une cessation con
certée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des
salaires, ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie du
travail. Ces articles, applicables aux patrons et aux ouvriers,
dans la pratique sont journellement appliqués aux ouvriers et
nullement aux patrons. Il est vrai que ceux-ci n’ont pas l’habi
tude d’imposer la cessation de travail à leurs confrères par la
violence ou la menace, tandis qu’il n’y a pas de grève où les
chômeurs ne prodiguent les horions et l’appellation de fainéants
à l’égard des ouvriers qui ne veulent pas suspendre le travail.
Cette proposition demande que le droit de grève soit rendu
possible aux ouvriers par la reconnaissance du droit de « mani
festation collective », c’est-à-dire, sans doute, le droit de persua
der les récalcitrants par la violence, le bris des machines et la
destruction de l’outillage ?
Une proposition veut édicter que tout patron qui, à la suite
d’un différend avec son personnel, arrêterait brusquement le
travail, tout en ayant des commandes, ou en refuserait la reprise
aux conditions antérieures au conflit, devra en informer le maire
de la localité dans les vingt-quatre heures. A son défaut, la
déclaration sera faite par le syndic ou par une délégation d’ou
vriers. La corporation établit, dans un rapport, les conditions
d’exploitation de l’industrie abandonnée, sous forme d’associa
tion coopérative des ouvriers qui y étaient employés. Une com
mission de quatre ouvriers et de cinq conseillers municipaux
statue le sixième jour sur son rapport ; son jugement est sans
appel et la prise de possession aura lieu quarante-huit heures
— 26 —
après. La proposition laisse aux capitalistes le soin de créer
l’usine, de l’outiller et de l’achalander. Quand il y aura des com
mandes à exécuter, on fait naître un incident, l’on va devant la
commission, et, deux jours après, les propriétaires sont expulsés.
L’association entre en possession de l’usine, des matériaux, de
l’achalandage, exécute les commandes et en reçoit le prix.
La question délicate est de savoir si le jour où ce régime
serait en vigueur, beaucoup de capitalistes s’engageraient dans
les affaires industrielles ? Il se pourrait bien qu’armés du droit
que veut leur conférer la proposition, les ouvriers ne voient
l’arrêt de l’industrie commencer par les priver de leurs salaires.
Une fois de plus se trouverait justifiée l’opinion des socia
listes que les lois votées en faveur des ouvriers restent le plus
souvent sans effet, quand elles ne se retournent pas contre ceuxlà mômes qu’elles devaient protéger.
IX.
La question des retraites ouvrières va entrer dans la période
conduisant à la réalisation du projet de loi voté par la Chambre
des députés et discuté par le Sénat.
On peut se demander pourquoi il va falloir payer des retraites
aux ouvriers de l’industrie plutôt qu’à ceux des champs, du com
merce, des lettres, des sciences, des arts, des sciences ?
Quoi qu’il en soit, les protagonistes des retraites ouvrières
déclarent qu’il faudra prélever 1 % sur les salaires des ouvriers
de la grande industrie, les mieux partagés de tous les travail
leurs. Quel est le montant des salaires ? On n’en sait rien. On
prélèvera ensuite 1 % sur les patrons qui l’ajouteront à leurs
factures et le feront payer aux consommateurs, c’est-à-dire aux
ouvriers qui n’auront pas de retraites. Puis l’Etat prélèvera
encore 1 % sur les contribuables, qui prendront ainsi sur leurs
salaires pour n’avoir pas de retraites et en procurer à leurs frères
de la grande industrie.
Il ne faut pas, du jour au lendemain, décréter l’obligation, il
est préférable de procéder par étapes en commençant, bien
entendu, par les plus puissants électeurs.
Il est bon que l’ensemble des contribuables participent dans
une mesure modérée à ces retraites. En d’autres termes, il
— 27 —
est bon que ceux qui n’auront pas de retraites en paient aux
autres.
Quelques novateurs rejettent l’obligation et se contentent de
la liberté subsidiée par l’Etat. Dans ce système, l’Etat donnerait
des subventions aux mutualités, et celles-ci assureraient des
retraites à leurs membres. La mutualité pourrait accepter l’aide
de l’Etat,, puisqu’elle lui en donnerait l’équivalent par les écono
mies qu’elle lui procurerait sur l'assistance publique. Mais alors,
les ouvriers des dernières étapes à retraiter, qui côtoyaient déjà
la misère, surimposés, tomberont sans tarder à la charge de
l’assistance publique ou privée. Voilà comme la liberté subsidiée
fera des économies à l’assistance publique.
La loi du 14 juillet 1905 sur l’assistance aux vieillards, infir
mes et incurables ne recevra son application qu’à partir du
1er janvier 1907 ; vers le môme temps, apparaîtra la loi des
retraites ouvrières.
Cette loi sera remplie de telles contradictions, qu’elle sera
presque inapplicable, et certaines de ses dispositions feront dou
ble emploi avec celles de la loi sur l’assistance aux vieillards.
La question a été posée : la loi du 14 juillet 1905 ne devraitelle pas absorber la loi sur les retraites ouvrières, dont elle n’a
pas les multiples inconvénients ? On est, en effet, dans le domaine
de l’assistance chaque fois que, pour ses besoins, il faut avoir
recours à la bourse d’autrui.
Les projets de retraites ouvrières sont contraires à la liberté
(contributions obligatoires des patrons et des ouvriers), à la
justice et à l’égalité (divisant les citoyens en deux classes, les
retraités et les autres), au progrès intellectuel et moral du peu
ple (supprimant l’initiative individuelle et l’effort dans la pré
voyance), au développement de la richesse publique (privant
l’agriculture et l’industrie des énormes capitaux que les caisses
d’Etat centraliseront). La loi donnera des retraites importantes
aux salaires élevés : pour les salaires très bas, la retenue sera la
ruine et ne donnera qu’une retraite dérisoire.
Au fond de tout ce gigantesque débat autour du contrat de
travail, ce qui est en question, c’est la vie à bon marché, le grand
désir, l’idéal de tout le monde, des riches, des moyens comme
des pauvres.
La vie à bon marché, désirable à tous les points de vue, le
28
devient particulièrement à celui des travailleurs manuels, qui
ne peuvent se procurer tout ce qui serait nécessaire pour eux et
pour leurs familles.
Comment réaliser la vie à bon marché ?
<( Que les patrons augmentent le salaire de leurs ouvriers, et
ceux-ci, ayant plus d’argent, achèteront davantage. »
Or, le salaire des ouvriers entre pour une part importante
dans le prix de revient. Si l’on augmente le salaire, il faudra
augmenter le prix de vente. Les ouvriers paieront les marchan
dises plus cher et leur situation ne sera pas changée.
« C’est sur les bénéfices des fabricants, sur la plus-value que
Karl Marx donne aux marchandises, que sera prise l’augmenta
tion des salaires ? »
Les bénéfices des fabricants ne sont pas tels qu’ils puissent
supporter une réduction égale à une augmentation des salaires
convenable pour améliorer la situation des ouvriers. Il y a beau
coup de fabricants pour chaque espèce de produit, ils sont en
concurrence entre eux et n’ont qu’un moyen pour triompher,
c’est de vendre à bon marché. Leurs bénéfices sont réduits juste
au point où, sans s’être entendus, ils pensent tous ne pouvoir
aller.
Sur l’ensemble de ces patrons, un cinquième s’enrichit, trois
cinquièmes végètent, un cinquième fait faillite. Comment ces
quatre cinquièmes peuvent-ils donner des bénéfices? Sans doute
il y a des industriels qui font de grosses fortunes, mais la répar
tition de ces fortunes entre tous les ouvriers employés représen
terait pour chacun et par jour quelques centimes à peine. En
s’efforçant d’améliorer artificiellement le sort des ouvriers, on
va directement à l’encontre de leurs intérêts. En essayant de
leur donner une retraite pour la vieillesse, on les privera de leur
pain quotidien en acculant le patron à la ruine ou tout au moins
en l’incitant à développer l’usage des machines.
Les centaines de millions détournés, chaque année, pour les
retraites ouvrières, viendront superposer leur poids à celui des
milliards de l’impôt pour accabler les plus pauvres et les plus à
plaindre des travailleurs manuels.
Les perfectionnements des arts industriels et commerciaux,
la sécurité des entrepreneurs, des capitalistes et des ouvriers,
avec la liberté du travail et des contrats, sont des moyens effi-
- 29 —
caces pour obtenir immédiatement la vie à bon marché, alors
que les règlements tendant au collectivisme et aux travaux for
cés, sous la férule de l’autorité, préparent la ruine, la misère et
la guerre pour tous les citoyens.
Au lieu de réglementer à outrance, il suffit de laisser agir les
lois de la nature, à condition qu’il n’y ait ni violence, ni fraude,
ni monopole, ni protection, pour que la concurrence entre les
producteurs et les commerçants engendre la vie à bon marché.
X.
Toutes les propositions faites pour diminuer l’inégalité des
conditions sociales auront pour effet de la déplacer ou de l’aug
menter, et, dans les deux cas, de diminuer le revenu annuel de
la population française dans laquelle on les introduit, en dimi
nuant l’énergie et la moralité, en môme temps que le bien-être
des individus et leur force collective. Ces réglementations divi
seront la nation en deux groupes dont les dissidences iront en
s’accentuant. Lorsque la démocratie se laisse entraîner dans les
luttes interminables entre les riches et les pauvres, la fin inévi
table de ces dissensions se trouve dans la tyrannie. Les exemples
des républiques grecques, italiennes et françaises en sont la
preuve topique.
Le pouvoir politique est né du besoin de donner une solution
pacifique aux contestations privées, du besoin de justice qui est
le besoin principal et primordial des sociétés. La possession du
pouvoir politique, par laquelle on obtient richesses et honneurs,
a toujours tenté l’ambition des hommes. 11 ne faut pas s’étonner
qu’elle ait été l’objet d’ardentes convoitises qui ont agité et
troublé la société depuis l’origine et ne semblent pas devoir
finir. Obligés de coordonner avec nos semblables nos idées, nos
efforts, et d’avoir avec eux des arrangements plus ou moins
durables, nous avons été conduits à déléguer le pouvoir de con
traindre et de punir à certains individus chargés de faire obser
ver certaines règles ou lois établies. Ce pouvoir politique n’a
jamais pu sacrifier ou négliger au-delà d’un certain point les
intérêts collectifs et les opinions de la masse des sujets sans
périr presqu’aussitôt. Le pouvoir politique est transféré violem
ment par les révolutions. Celles-ci déplacent le gouvernement,
— 30 —
en changeant quelquefois la forme, toujours le personnel ; elles
imposent aux peuples de grands sacrifices et troublent leurs
idées pour un temps plus ou moins long : ce sont les symptô
mes de véritables maladies sociales. Il faut toujours chercher à
éviter une révolution et à la remplacer par l’action efficace de
l’opinion publique, d’où émane le pouvoir politique. C’est par
l’opinion que se forment les coutumes, les moeurs, les notions
de bien et de mal. Les coutumes se transforment par des réfor
mes successives, par l’accumulation d’un nombre infini d’efforts
individuels. Mais, depuis longtemps, les réformes tendent direc
tement à l’égalité des droits dans des sociétés humaines, où
l’inégalité des conditions, l’augmentation du nombre des hom
mes, les besoins toujours croissants des individus, sont les
causes principales, inévitables et toujours actives du progrès
social. Ces trois causes agissant constamment, il a toujours été
fort difficile d’établir un arrangement stable. Lorsque cet arran
gement a été trouvé et établi par le système des castes ou par
le fonctionnarisme à outrance, il a affaibli le groupe qui l’avait
accepté et l’a livré aux groupes souvent inférieurs à beaucoup
d’égards, qui avaient conservé une plus grande énergie.
C’est donc à la démocratie elle-même qu’il faut s’adresser
pour corriger les défauts de la démocratie.
Il faut lui rappeler que les hommes, placés devant la nature
pour obtenir les objets qu’ils désirent et dont ils ont besoin,
n’ont d’autres moyens que le travail de leur intelligence, de leur
volonté et de leur corps : l’invention, l’épargne, l’effort muscu
laire. Telle est la condition du genre humain sur notre planète,
la condition commune des hommes.
L’idéal de justice serait atteint, si chacun des individus ou
chacune des familles dont le genre humain se compose se trou
vait dans les mêmes conditions que celui-ci, ni plus ni moins.
Celui qui prétendrait obtenir des conditions meilleures, ne pour
rait y parvenir qu’aux dépens de ses semblables, en s’appropriant
le produit de leurs inventions, les capitaux épargnés par eux ou
conquis par leur travail. Il ne serait pas placé dans des condi
tions égales pour tous : il serait un privilégié.
Il ne dépend d’aucune puissance humaine d’éliminer la
chance ; le mérite d’un homme ne peut jamais être apprécié
exactement par un autre. Conférer au Gouvernement le pouvoir
— 31 —
de redresser d’une façon quelconque ce qu’on appelle les injus
tices, les inégalités de la liberté, c’est lui conférer le pouvoir de
commettre les plus grossières erreurs et les injustices les plus
criantes. Il faut éviter de tomber dans l’erreur de Karl Marx,
l’oubli du travail intellectuel et moral qui invente sans cesse
s’applique à prévoir et soutient toutes les industries dont les
hommes vivent. Sous le régime de la liberté du travail et des
contrats, chacun par son travail et par l’échange peut acquérir
indéfiniment des richesses sans nuire à personne. Ce sont les
innombrables économies des onze millions de travailleurs de
tous ordres qui forment l’immense majorité des richesses accu
mulées de la France, et, au milieu, surgit un très petit nombre
de grandes fortunes.
Toutes les industries, agricoles ou autres, dont tous les hom
mes vivent, ne peuvent fonctionner qu’avec l’aide des capitaux
des gens économes. Compromettre la sécurité de ces capitaux
entraînera fatalement la ruine des entrepreneurs et des ouvriers
en écrasant surtout les plus pauvres. Si ces capitaux peuvent se
développer presque indéfiniment par le travail de tous, pour
l’établissement de la vie à bon marché, c’est à la condition d’avoir
des propriétaires chargés de leur conservation et de leur bon
emploi, ce qui ne s’obtient qu’avec la propriété individuelle. Le
vulgaire mesure le bonheur d’un homme aux richesses qu’il
possède, et, pour lui, le bonheur commun signifie richesses
communes. Cette interprétation fut celle de Babeuf, de nom
breux communistes ou collectivistes de 1848 et d’aujourd’hui. Il
faut se rappeler qu’avant de déposséder de leurs biens, meubles
et immeubles, les onze millions de propriétaires français, géné
ralement valides, adultes et responsables, il faudra peut-être
obtenir leur consentement ? Le métier de « dévalisé par persua
sion » n’a qu’un temps. Lorsqu’il s’agit de faire une faute irré
parable, il y a un moment où le sentiment de la conservation de
soi-même ramène les peuples dans la voie de la raison et de
l’équité.
Les idées de gouvernement et de droit semblent s’affaiblir et
s’effacer. On ne sent plus la présence d’un principe, d’un terrain
solide sur lequel la société puisse se reposer et se développer en
sécurité. Cependant, ce principe existe et ne sera pas effacé :
c’est l’égalité juridique des citoyens et la liberté du travail. En
- 32 dehors, il n’y a que désordres, luttes incessantes, révolutions et
insécurité. Afin de se rapprocher de cet idéal, il faut restreindre
autant qu’on le peut le domaine de la loi et des règlements, pour
étendre d’autant celui de la morale et de la liberté. Des lois
mûrement étudiées, en très petit nombre, des opinions morales
librement, mais soigneusement cultivées et très fermes, voilà les
besoins les plus urgents de la société moderne. Cet idéal, encore
bien éloigné de l’intelligence du grand nombre de nos contem
porains, ne peut s’appliquer qu’après une longue suite d’années
de propagande. Les multitudes ne modifient guère leurs senti
ments et leurs pensées que sous la pression des événements et
de la douleur.
Deux versants opposés partagent l’existence du genre humain :
d’une part, le régime d’autorité venant de la guerre, d’autre part,
le régime nouveau fondé sur l’égalité juridique et la liberté du
travail, tendant à un état général de paix, et il y aboutira, c’est
le régime de l’avenir.
Il assurera l’amoindrissement graduel des maux que les hom
mes se font les uns aux autres. Il y faudra peut-être des siècles
et des siècles, car on ne domptera ni facilement ni en peu de
temps l’esprit d’injustice et de rapacité qui veille sans cesse
dans l’esprit humain. Mais l’avenir appartiendra aux peuples qui
se rapprocheront de l’idéal, tandis que ceux qui persisteront à
regarder en arrière précipiteront leur décadence et périront.
Novembre 1906.
i Xfl3flQlcl3d if
3 ~1 ~i IA ’v "1 J 0
• qiio ih tenais
Rochetort. — Société anonyme de l’Imprimerie Ch. Thèze