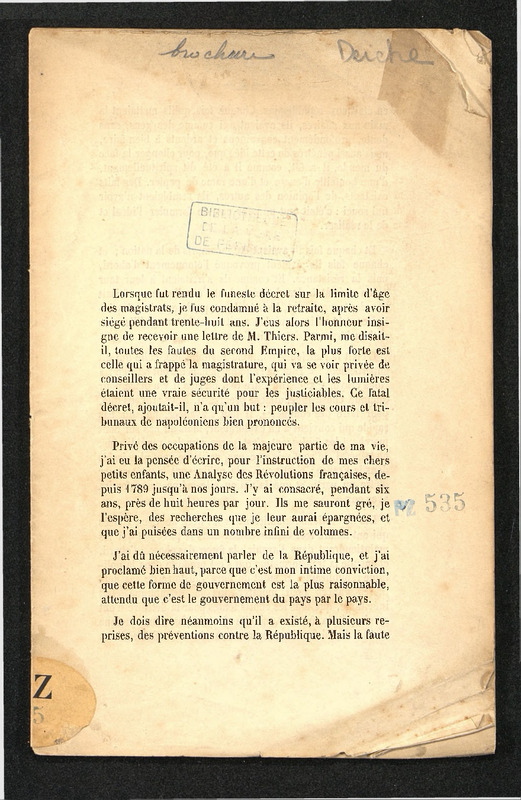FRB243226101PZ-535.pdf
Médias
Fait partie de Deiche
- extracted text
-
Lorsque fut rendu le funeste décret sur la limite d’âge
des magistrats, je fus condamné à la retraite, après avoir
siégé pendant trente-huit ans. J’eus alors l’honneur insi
gne de recevoir une lettre de M. Thiers. Parmi, me disaitil, toutes les fautes du second Empire, la plus forte est
celle qui a frappé la magistrature, qui va se voir privée de
conseillers et de juges dont l’expérience et les lumières
étaient une vraie sécurité pour les justiciables. Ce fatal
décret, ajoutait-il, n’a qu’un but : peupler les cours et tri
bunaux de napoléoniens bien prononcés.
Privé des occupations de la majeure partie de ma vie,
j’ai eu la pensée d’écrire, pour l’instruction de mes chers
petits enfants, une Analyse des Révolutions françaises, de
puis 1789 jusqu’à nos jours. J’y ai consacré, pendant six
ans, près de huit heures par jour. Ils me sauront gré, je
l’espère, des recherches que je leur aurai épargnées, et
que j’ai puisées dans un nombre infini de volumes.
J’ai dû nécessairement parler de la République, et j’ai
proclamé bien haut, parce que c’est mon intime conviction,
que cette forme de gouvernement est la plus raisonnable,
attendu que c’est le gouvernement du pays par le pays.
Je dois dire néanmoins qu’il a existé, à plusieurs re
prises, des préventions contre la République. Mais la faute
■
Pz S3£
— 2 —
en était aux républicains. Chaque fois qu’ils mettaient la
main aux affaires, ils avaient agi comme des gens, sans
doute, profondément convaincus et ardents à bien faire,
mais aussi pénétrés de cette idée que, pour changer la face
du monde, il suffit, comme il a été dit spirituellement,
d’une bouteille d’encre et d’une rame de papier. Des faits
existants, de l’opinion des autres, ils semblaient n’avoir
nul souci : c’était tout un pour eux de formuler l’idéal et
de le réaliser.
Et chaque fois ils avaient été incompris de la nation ; et
chaque fois ils avaient provoqué l’étonnement d’abord,
puis la résistance. Et comme ils s’irritaient à leur tour
qu’on résistât à des desseins dont l’excellence ne faisait
pas doute pour eux, bientôt ils se perdaient dans la vio
lence, et la nation, qui les avait au début accueillis avec
enthousiasme, se détachait d’eux.
C’était là l’ancienne politique républicaine, celle qui dit
superbement : « Tout de suite ou jamais ! Tout ou rien ! »
Nous croyons, nous, qu’entre tout ou rien il y a place pour
quelque chose indéfiniment progressif. Nous croyons que,
pour faire des conquêtes, il faut s’avancer, non du pas
rapide qui convient à un explorateur, mais du pas sûr dont
marchent les foules ; et c’est parce que les républicains,
en général, se sont mis à ce pas, qu’ils ne sont plus isolés
dans la France ; c’est pour cela qu’ils vont bientôt cesser
d’être un parti, et que la nation elle-même se confondra
avec eux.
Les institutions républicaines sont nées de deux causes
qui ont assuré leur établissement dans le passé, et qui les
maintiendront dans l’avenir : la force des choses d’abord,
et ensuite la transformation qui s’est produite dans la poli
tique républicaine. Il suffit de faire l'histoire de ces der
nières années pour montrer que la République était
inévitable, que tous les efforts tentés pour la détruire n’ont
servi qu’à la fortifier, qu’elle s’est imposée en quelque
sorte à ses adversaires comme une nécessité. Entre elle et
K-i.
— 3 —
la dictature, il n’y avait plus de milieu. Le pays pourrait-il
hésiter dans son choix ? Il aurait hésité cependant, si les
républicains n’avaient pas opéré sur eux-mêmes une
réforme sans laquelle la fondation de la République fût
restée impossible. Ils ont aujourd’hui un bien beau rôle à
jouer, s’ils savent s’y maintenir définitivement. À mesure
qu’ils deviennent plus sages et plus modérés, leurs adver
saires, s’emparant de leurs anciens procédés, se lancent
dans la politique de casse-cou, qui est le signe de l’impuis
sance et le commencement du désespoir.
On voit, en effet, les monarchistes de toutes les couleurs,
prétendus conservateurs, voter pour les représentants de
la politique la plus révolutionnaire, afin d’arriver au bien
par l’excès du mal. Cette méthode, qui n’est autre que le
pessimisme, n’est pas nouvelle ; mais elle fait en ce mo
ment beaucoup de prosélytes dans les rangs des adver
saires de la République. Nous entendions, il y a peu de
jours, un homme convaincu la résumer dans un mot
charmant :
« Ce qu’il faudrait, s’écriait-t-il, pour rétablir la sécurité
» publique, ce serait un bouleversement général. » Pauvres
gens! est-ce qu’ils ne sentent pas qu’au milieu de ce boule
versement, des républicains exaltés, poussés à bout,
pourraient être tentés de renouveler les excès criminels
de 93?
Quel est le parti qui serait à même d'arrêter ces
horreurs ?
Les légitimistes ? leurs chefs sont dévoués et convaincus ;
mais c’est une armée sans soldats.
On peut en dire autant des orléanistes.
Restent les napoléoniens ; mais, pour cela, il faudrait
commencer par s’emparer du pouvoir. Or, sans compter,
bien entendu, les républicains qui lutteraient avec la der
nière vigueur, légitimistes et orléanistes peuvent bien
— 4
s’unir aux partisans de l’Empire pour le renversement de
la République, mais non pour le retour de Napoléon IV.
S’il arrivait pourtant qu’à force de manœuvres crimi
nelles, d’audace inouïe, l’Empire revint, sa première
nécessité, nécessité impérieuse, serait de chercher à re
prendre Strasbourg et Metz. Voilà donc la guerre déclarée.
Comment le fils consentirait-il à régner sur la France sans
l’Alsace et la Lorraine dont l’avaient privée la témérité et
l’incurie du père? S’il consentait à vivre sans gloire aux
Tuileries, s’il continuait à gorger, comme par le passé, ses
partisans d’honneurs et de richesses, le pays humilié 11e
pourrait supporter longtemps une pareille honte ; et malgré
les poursuites de toute nature contre les adversaires de
l’Empire, la guerre civile ne tarderait pas à éclater, et,
bientôt après, une nouvelle révolution.
Que faut-il pour n’être pas exposé à de nouveaux et
terribles orages ? Que la nation se persuade bien qu’il n’y
a de possible que la République, c’est-à-dire le gouverne
ment du pays par le pays, accessible pour tous. Cette opi
nion tend à se confirmer ; mais il est encore bon nombre
de personnes qui ne s’y rallient pas franchement, par
crainte, disent-elles, de la mauvaise queue que traîne
après lui le parti républicain. Convenons de bonne foi qu’il
en est aucun qui en soit exempt. Quant à celle qu’on re
proche à la République, elle est infiniment moins à crain
dre qu’on se plaît à le proclamer. Il est, en effet, une
vérité consolente, c’est que les honnêtes gens sont en
infinie majorité dans notre belle et chère France. Que tous
ceux qui doivent la chérir de tout cœur, qui ont intérêt à
l’ordre et à la tranquillité, s’entendent, et les perturbateurs
du repos public seront bientôt réduits à une impuissance
absolue.
Je dois ajouter que ce qui peut nous rassurer, c’est
qu’après cinq ans de tâtonnements, d’entreprises contra
dictoires, d’efforts impuissants et d’attente vaine, on a
enfin donné au pays des institutions régulières, on a fait
— 5 —
la République. Sans chercher à savoir par quelle suite
d’événements la constitution qui nous régit est devenue
une nécessité, on est bien obligé de reconnaître qu’il était
impossible d’en établir une autre lorsque celle-ci est
sortie des votes d’une assemblée qui n’avait rien épargné
pour fonder la monarchie. Le sentiment populaire ne s’y
est point trompé ; il a compris très vite que le devoir et
l’intérêt de tous étaient de se rallier au seul gouvernement
définitif qui eut encore des chances de solidité et de
durée. De là le mouvement qui s’est formé dans les
différentes classes de la société, et qui gagne chaque jour
en force aussi bien qu’en étendue. Après la première
hésitation, les départements les plus connus pour leur
attachement à la Monarchie ont accepté, comme les autres,
la forme républicaine. Ainsi, nous venons de voir une
circonscription électorale de Bretagne choisir son député
parmi le groupe des libéraux les plus résolument et les
plus sincèrement dévoués à la République.
En allant vers les candidats qui promettent de travailler
avec une entière franchise à la consolidation de la
République, le suffrage universel n’obéit pas à un de ces
entraînements aveugles qu’on lui a reprochés bien des
fois. L’instinct du pays s’accorde, sur ce point, avec le
dessein réfléchi du parti libéral modéré, c’est-à-dire de la
fraction la plus éclairée, la plus laborieuse, et en même
temps, — ce qui aussi a son importance, — la plus riche
de la nation. Les grandes forces sociales de l’intelligence,
du travail et de la fortune sont mises au service de la
République. Qu’on jette les yeux sur les hommes qui
s’efforcent d’affermir les institutions nouvelles , on y
trouvera, à côté des républicains de la veille, devenus
plus sages par la pratique des affaires et le sentiment de
la responsabilité, cette classe nombreuse d’administrateurs,
de professeurs, d’hommes de lettres, de savants, d’avocats,
de militaires, de commerçants, d’industriels, etc., qui
n’ayant pas de préjugés dans la question de forme de
gouvernement, est prête à soutenir tout pouvoir capable
— 6
d’assurer au pays une existence prospère sous des lois
sages. L’histoire de ces dernières années nous a fait
assister à la conversion lente, mais constante des monar
chistes constitutionnels en républicains conservateurs.
Lorsque M. Thiers, avec une merveilleuse perspicacité
que les événements ont justifiée d’une manière si éclatante,
a reconnu que le système monarchique , auquel il avait
consacré la plus grande partie de sa glorieuse carrière,
avait été irrémédiablement compromis parmi nous, d’où
sont venus les collaborateurs qui l’ont aidé à préparer
l’avénement de la République ? Qu’étaient-ce que les
ministres qui se sont associés à son œuvre, MM. de
Rémusat, Dufaure, Casimir Périer , Léon Say , etc.?
Qu’étaient ce que les députés qui l’ont soutenu dans l’Assem
blée; que les publicistes qui l’ont appuyé dans la presse; que
les hommes qui l’ont applaudi dans le pays ? Si l’on citait les
noms, on serait frappé de rencontrer, sur cette liste des
républicains du lendemain, presque tous les grands servi
teurs de la monarchie constitutionnelle, — ou leurs des
cendants. Placés entre la légitimité, l’empire et la Répu
blique modérée, les véritables libéraux, ceux qui mettent
au-dessus de leurs préférences ou de leurs ambitions par
ticulières l’intérêt de la nation, devaient-ils, pouvaient-ils
hésiter ? Pouvaient-ils, sans commettre une faute contre la
logique, aussi bien que contre le patriotisme, remonter
au-delà de 1830, ou redescendre jusqu’en 1852? Aussi les
avons-nous vus tour à tour, les uns avec la promptitude
que donnent la netteté de l’esprit et la décision du carac
tère , les autres avec la lenteur qu’inspirent aux cœurs
hésitants les regrets du passé, venir prendre rang dans la
majorité républicaine. Les élections générales ont hâté
l’évolution, en prouvant aux retardataires qu'il fallait aller
plus vite s’ils voulaient suivre la marche du suffrage uni
versel. Depuis la réunion des nouvelles chambres, et
malgré les efforts des partis vaincus pour effrayer le corps
électoral, sur les conséquences de ses votes, le flot n’a pas
cessé de grossir dans le pays, et c’est presque toujours
-7 —
des anciens monarchistes constitutionnels qui sont venus
en précipiter le cours.
Tout semblerait donc devoir assurer la consolidation de
la République. Mais il est infiniment essentiel que les
républicains de toutes les couleurs ne perdent pas une
seule minute de vue que la carrière du Président, toute
remplie d’efforts militaires, n’a pas été consacrée au culte
et à l’étude des combinaisons de la politique et des équili
bres parlementaires, et que, par conséquent, il est plus
que tout autre chef d’Ètat peut-être, enclin à laisser sur
prendre sa bonne foi, et à apposer sa signature au bas de
doctrines et de théories dont des conseillers d’un gouver
nement occulte connaissent bien mieux que lui les effets
sensibles et toutes les difficultés.
Que tous les partisans du nouvel ordre de choses, — je
ne saurais assez le répéter, — se gardent bien d’oublier
que le président, peu, ou même pas républicain, s’est
prêté aux intrigues du trop habile de Broglie, intrigues
funestes qui amenèrent la chute de M. Thiers de la prési
dence, le 24 mai 1873. Il est juste de dire que ce pa
triote par excellence, si illustre à tant de titres, voulait
un peu trop régenter la Chambre, et qu’il avait le tort de
menacer à chaque instant de sa démission. Contre son
attente, il fut enfin pris au mot, et remplacé par le maré
chal Mac-Mahon, célèbre par la victoire de Magenta, vic
toire dont l’éclat a été prodigieusement éclipsé par la
désastreuse défaite de Sedan.
Tels étaient les avertissements que, dans ma prévoyance
patriotique, je me permettais, déjà depuis plusieurs mois,
de donner, dans mon Analyse des Révolutions françaises, à
des gens qui en savent infiniment plus que moi. Je crains
fort, pour la tranquillité du pays, d’avoir été trop bon
prophète.
Nous voyons, en effet, dans le Journal officiel, la révo
cation du ministère Jules Simon, et les décrets constituant
— 8 —
le nouveau cabinet. Deux noms suffiraient pour caractériser
le ministère : celui de M. le duc de Broglie, nommé
président du Conseil, avec le portefeuille de la justice, et
celui de M. deFourtou, qui redevient ministre de l’intérieur.
Ils représentent tous les deux l’hostilité contre les insti
tutions républicaines ; de plus, M. de Fourtou semble
destiné, par ses opinions et par son passé, à exercer, aux
élections futures, une pression dans le sens bonapartiste.
Deux membres du ministère Buffet, renversé par les élec
tions générales de 1876, rentrent aux affaires : M. Caillaux,
du centre droit, qui devient ministre des finances, et M. de
Meaux, de la droite, qui reçoit le portefeuille de l’agri
culture et du commerce. Enfin, deux sénateurs entrent
pour la première fois aux affaires : M. Paris, comme
ministre des travaux publics ; M. Brunet, comme ministre
de l’instruction publique, des beaux-arts et des cultes.
M. Brunet, ancien magistrat, entré dans la vie politique
aux dernières élections générales, est, comme on le sait,
un bonapartiste. Quant à M. Paris, il fut, on se le rappelle,
rapporteur de la commission des Trente, et déclara, en
cette qualité, lors de la discussion sur la révision, « que la
forme même du gouvernement pourrait être l’objet d’une
révision. » Deux seulement des membres du ministère
Jules Simon font partie du cabinet de Broglie : M. le général
Berthaut, ministre de la guerre, qui est, en outre, chargé
de l’intérim de la marine, jusqu’à nomination du successeur
de l’amiral Fourichon, etM. le duc Decazes.
Le bonapartisme, la droite et le centre droit sont, comme
on le voit, seuls représentés dans le cabinet. Ajoutons que
deux députés seulement figurent sur la liste des ministres :
M. le duc Decazes etM. de Fourtou.
La Chambre des députés devait, comme on le pense
bien, être justement alarmée de ce véritable gouvernement
de combat, formé sous les mêmes inspirations, dans les
mêmes vues, et presque avec les mêmes hommes qu’au
24 mai 1873. Réunie, le 13 mai, M. Gambetta prononce un
— 9 —
discours où se révèlent les plus brillantes qualités oratoires
du leader de la gauche. On passe à l’ordre du jour,
ainsi conçu :
« La Chambre,
» Considérant qu’il lui importe, dans la crise actuelle,
» et pour remplir le mandat qu’elle a reçu du pays, de
» rappeler que la prépondérance du pouvoir parlementaire,
» s’exerçant par la responsabilité ministérielle, est la
» première condition du gouvernement du pays par le
» pays que les lois constitutionnelles ont eu pour base
» d’établir,
» Déclare que la confiance de la majorité ne saurait être
» acquise qu’à un cabinet libre de son action et résolu à
» gouverner suivant les principes républicains, qui peuvent
» seuls garantir l’ordre et la prospérité au dedans, et la
» paix au dehors,
» Et passe à l’ordre du jour. »
Cet ordre du jour est adopté par 347 voix contre 144 ; et
nous avons la douleur de dire que notre département n’a
nommé, ce que nous ne savions déjà que trop, que deux
représentants républicains, Garrigat, Montagut. Avis aux
électeurs.
Quelle a été la conduite du ministère? Sachant trèsbien qu’il ne tiendrait pas devant la Chambre l’espace
d’une séaïice, il a prorogé le Parlement. Mais la prorogation
ne peut durer qu’un mois, d’après la Constitution, car
enfin il y a encore, et malgré tout, la Constitution ; il est
vrai que la prorogation est possible deux fois, mais deux
fois seulement ; et alors c’est la dissolution qu’il faut
prononcer.
Mais cela c’est l’avenir et un avenir qui sera la revanche
retentissante du présent. Le présent, c’est le triomphe de
— 10 —
la coalition de droite ; mais tout donne la certitude que ce
triomphe sera de courte durée. A l’intérieur, nous ne
sommes pas inquiets : il y aura bientôt des élections muni
cipales, des élections de conseillers généraux, enfin des
élections générales qui se feront dans trois mois, d’après
la Constitution. La France libérale a attendu cinq ans, elle
est de force à attendre cinq mois. Il y a, paraît-il, encore
des gens assez aveugles ou assez infatués pour s’imaginer
que la France, appuyée sur une constitution républicaine
dont elle est seule maîtresse, à peine sortie des élections
du 20 février où elle s’est reconnue et retrempée, prête à
les refaire contre M. de Broglie, comme elle les a faites
contre M. Buffet ; que cette France clairvoyante, patiente,
résolue, irait d’un seul coup et comme par enchantement,
de la République libérale à la réaction monarchique. Nous
renonçons à, comprendre de pareilles illusions, mais nous
sommes bien forcés de constater qu’elles existent, et
même qu’elles gouvernent.
On ne nous parlera plus sans doute de règles constitu
tionnelles observées, de prérogative présidentielle régu
lièrement exercée, de traditions parlementaires respectées.
Le ministère qu’on nous inflige est juste le contraire de
celui que les vœux de la majorité nationale et parlemen
taire pouvaient légitimement réclamer. Le chef de l’Etat
forme un cabinet qu’il sait fort bien n’avoir pas de majo
rité , et qu’il prend exclusivement partout ailleurs que
dans la majorité ; il installe, sous la République, un minis
tère dont aucun membre n’est républicain ; et tout ceci
se passe au moment où l’Europe assiste anxieuse au
développement d’une guerre dont nul ne peut annoncer
la fin, poser les limites, prévoir l’issue. C’est à l’heure où
nous devions nous recueillir dans la sagesse, la concorde
et la paix, qu’on va nous jeter dans la confusion des luttes
électorales et des troubles civils.
D’où peut provenir une conduite aussi insensée, on
pourrait même dire aussi criminelle? Il faut déclarer, en
— 11 —
toute vérité, et sans haine contre la religion, que ceci
est l’œuvre du parti ultramontain, impatient de prendre
contre la chambre des députés une revanche de l’ordre du
jour du 4 mai sur l’interpellation Leblond , relative à
certains écrits de quelques évêques.
Ceci me remet en mémoire les sages paroles d’un prêtre,
aussi pieux qu’éclairé , qu’il m’avait été donné de voir
fréquemment, et qui m’honorait de son amitié. Qu’il est à
regretter, mon cher Deiche, me disait-il souvent, que des
ministres d’un Dieu de paix et de concorde se mêlent avec
passion à toutes ces questions politiques qui divisent les
hommes, et qui engendrent presque toujours l’indifférence
entre eux, et même la haine ? Oh ! qu’ils seraient réellement
plus puissants , et qu’ils rendraient de plus grands
services à la religion du Christ qui a toujours prêché que
son règne n’était pas de ce monde , en s’occupant
exclusivement des affaires spirituelles ! Il a, depuis, rendu
sa belle âme à Dieu, ce saint homme qui, s’il n’a pas fait
de moi un fervent catholique, n’a pas peu contribué à
confirmer mes sentiments religieux. Oh ! qu’il souffrirait
de voir le parti clérical attirer peut-être la guerre sur
notre malheureux pays !
Qu’on ne s’y trompe pas ; l’Allemagne nous guette. Les
cinq milliards qu’elle nous avait imposés, croyant ainsi
nous écraser complètement, ont été consacrés par elle à de
nouveaux et terribles armements. Il lui en faut d’autres ;
et, pour cela, rien ne lui coûtera. Cette intention résulte
d’un article de la Gazette de Strasbourg (officielle). Que
tous les Français, quelque soit leur couleur, le méditent
profondément :
« La démission de Jules Simon est un pas de plus
» dans la voie où s’est engagé le parti ultramontain en
» France, un pas qui rapproche ce parti du but qu’il
» s’est proposé, et qui est de pousser le président de la
» République à la dissolution de la Chambre. Pour nous,
» et pour l’Italie, qui est notre amie, la tournure que
— 12 —
» prennent les choses nous invite à faire les réflexions les
» plus sérieuses.
» Dans ces circonstances, l’Allemagne ne saurait rester
» indifférente ; il faut qu’elle montre la plus grande
» vigilance. Le renvoi du ministère Jules Simon est une
» provocation qui est destinée contre toute autre chose
» encore que la majorité libérale de la Chambre fran» çaise, et dont les conséquences pourront s’étendre bien
» au delà des frontières de la France. »
Que tous les Français, nous ne saurions trop le répéter,
réfléchissent sur cet article, qui est on ne peut plus
significatif.
Que le président de la République surtout se livre aux
plus profondes méditations sur ce passage de la presse
officielle de Strasbourg. Il ne peut manquer d’être bien
convaincu que l’Allemagne souhaite ardemment de voir la
France engagée dans une guerre quelconque, soit qu’elle
la déclare elle-même, soit que, grâce aux suggestions du
trop fameux Bismark, elle nous soit déclarée par toute autre
nation, l’Italie, par exemple, à qui on cherchera à persuader
que l’ultramontanisme français en veut à son existence.
Que le Président de la République se garde surtout de
se laisser séduire par les flatteries intéressées des Broglie
et Fourtou qui lui ont, dit-on, persuadé que la majorité des
députés n’est venue à la Chambre que parce quelle s’est
appuyée de son nom.
Qu’il se garde bien de suivre l’avis de conseillers perfi
des et aveugles qui le poussent à découvrir sa personnalité,
en laissant la nation juge entre lui et les représentants
qu’elle a nommés le 20 février dernier. Comme nous
l’avons déjà dit, on ne conçoit pas qu’il y ait des gens
assez aveugles ou assez infatués pour s’imaginer que la
France, appuyée sur une Constitution républicaine dont
elle est seule maîtresse, à peine sortie des élections du
20 février, où elle s’est reconnue et retrempée, prête à les
— 13 —
refaire contre M. de Broglie comme elle les a faites contre
M. Buffet; que cette France clairvoyante, patiente, résolue,
ira d’un seul coup, et comme par enchantement de la
République libérale à la nation monarchique. Que le Pré
sident soit bien convaincu que les ouvriers des villes, et
même les paysans, indignés des menées ultramontaines,
lui préféreront, malgré l’éclat de son nom, les 347, qui
seront renommés comme le furent, en 1830, les 225.
Que Dieu veuille bien pénétrer de cette vérité le maré
chal Mac-Mahon, si soucieux jusqu’ici de son renom d’hon
nêteté. S’il donne, au contraire, suite à son espèce de coup
d’Etat, à cette sorte de coup de sang auquel on le dit
malheureusement sujet; que les élections soient désormais
notre préoccupation majeure : nous aurons bientôt devant
nous les Broglie et les Fourtou, jouant leur va-tout, et
dont l’unique mission sera d’effacer le vote du 20 février ;
c’est elle qu’il s’agit de neutraliser par la parole, par la
plume, par l’effort soutenu, énergique, patient, dont la
France a déjà donné le spectacle et recueilli les fruits ;
que le pays sache rester lui-même , qu’il soit aujourd’hui,
comme il y a quatre ans, ferme dans la sagesse et la
modération, qu’il repousse les mauvais conseils de la
passion et de la colère, que cette fois encore il veuille,
il sache attendre, et avant que cette année ne s’écoule,
la politique républicaine, libérale, pacifique et vraiment
conservatrice aura repris sa place et retrouvé ses droits.
Je sais bien que bon nombre de personnes redoutent les
prochaines élections générales. Est-il sûr qu’elles soient
aussi effrayantes qu’on affecte de le dire ? Non, cela n’est
pas sûr. Il y a toujours une grande différence entre
des élections générales et des élections partielles.
Dans les élections partielles, quand on est mécontent
du pouvoir ou de l’Assemblée, on choisit les candidats qui
leur sont le plus désagréables; on prend ses candidats
dans les extrêmes ; on les prend dans les couleurs les plus
14 —
criantes, pour que ceux à qui on les adresse les voient
mieux ; ce sont des votes de colère et de défi. C’est ce qui
a eu lieu dernièrement à Avignon et à Bordeaux. Dans les
élections générales, c’est autre chose ; on songe, après
tout, que de la future Assemblée dépend la fortune publi
que et privée ; qu’il dépend de maintenir la paix ou de
voter la guerre, guerre étrangère ou civile, d’enrichir ou
de ruiner le pays ; qu’il ne s’agit pas ici d’un caprice à se
passer, mais d’un mariage qui peut être bon, s’il est bon,
et, s’il est mauvais, très-mauvais ; malgré ses passions, à
moins d’être un forcené, on réfléchit.
Aussi est-on constamment étonné, quand on sort d’une
élection générale, qu’elle soit ce qu’elle est, qu’elle représente une certaine moyenne de sagesse qui s’est dégagée
des excès contraires. Prenons les Assemblées créées de
puis 1848, depuis les temps orageux du suffrage universel,
il n’y en a pas une qui ait pu paraître un instrument de
bouleversement général.
Sans être absolument tranquille sur la prochaine Assem
blée, je suis bien loin d’avoir les terreurs anticipées de
beaucoup de personnes. Les hommes prudents, et qui
veulent, avant tout, le repos du pays, ont une conduite
évidemment tracée : prendre, sans être républicains bien
prononcés, leur parti du suffrage universel et de la Répu
blique et tâcher que le suffrage universel nous donne une
République vraiment conservatrice.
DEICHE.
Périgueux. — Imprimerie J. Bounet, Cours Tourny, 15.