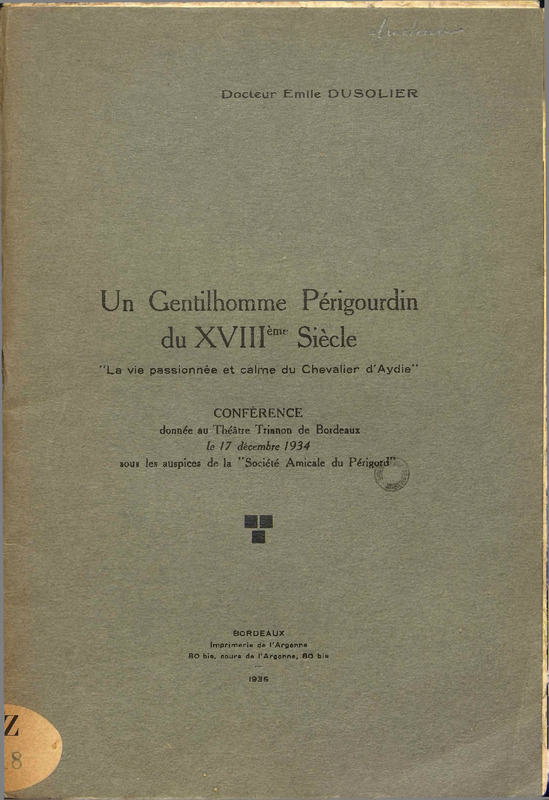-
extracted text
-
Docteur Emile DUSOLIER
Un Gentilhomme Périgourdin
du XVIIIeme Siècle
"La vie passionnée et calme du Chevalier d'Aydie”
CONFÉRENCE
donnée au Théâtre Trianon de Bordeaux
le 17 décembre 1934
sous les auspices de la “Société Amicale du Périgord”
BORDEAUX
Imprimerie de PArgonne
80 bis. cours de PArgonne, 80 bis
1935
Z
��Un gentilhomme Périgourdin
du XVIIIe siècle
“La vie passionnée et calme du Chevalier d’Aydie”
�■
I
�r
Docteur Emile DUSOLIER
Un Gentilhomme Périgourdin
du XVII Ièm' Siècle
"La vie passionnée et calme du Chevalier d'Aydie"
CONFERENCE
donnée au Théâtre Trianon de Bordeaux
le 17 décembre 1934
«oui les auspices de la "Société Amicale du Périgord”
BORDEAUX
Imprimerie de l'Argonne
8O bis, cours de l'Argonne, 39 bi*
19$$
��Mesdames,
Messieurs,
La Maison d’Àydiie, qui accéda à la seigneurie de Ribé
rac vers la fin du xve siècle, ne manqua pas de notables re
présentants. On y relève deux chambellans, l’un de Louis XI
et l'autre de Charles VIII, plusieurs maréchaux de camp et,
enfin, ce François d’Aydie qui périt tragiquement, le 25 avril
1578, dans ce duel, demeuré fameux, entre mignons du roi
Henri III et ceux du duc d’Anjou, son frère, rencontre dont
Brantôme nous a rapporté la relation dans son Discours sur
les duels et dont vous pouvez lire encore le récit à peine ro
mancé dans la Dame de Monsoreau, d’Alexandre Dumas.
Cependant, si vous ouvrez le dictionnaire de Larousse, vous
ne verrez, mentionné à l’article d’Aydie, qu’un seul nom et
ce nom n’est celui d’aucun de ces personnages, c’est celui de
Blaise-Marie d’Aydie, dit le chevalier d’Aydie.
Et, pourtant, ce n’est ni par les armes, ni par l’éloquence,
ni par d’insignes services rendus à son roi que le chevalier
d’Aydie a laissé son nom à l’histoire. C’est même par un dé
tour assez inattendu qu’il a passé à la postérité : par ses
amours avec une jeune Circassienne élevée en France, du
nom de Haydée ou de Aïssé, comme l’usage a prévalu de la
nommer.
A vrai dire, le chevalier d’Aydie n’était pas de la bran
che aînée. Il n’était qu’un cousin éloigné du comte de Ribé
rac. Il était de la branche de Vaugoubert et était né au
château de Vaugoubert, paroisse de Quinsac, au-delà de
Brantôme, tout près de cette même Dronne qui traversait
quelques huit lieues plus bas, les possessions du comte de
�-2Ribérac. Il était le quatrième des neuf enfants d’Armand
d’Aydie, comte de Vaugoubert et de Marie de Saint-Aulaire,
de la famille de Saint-Aulaire, dont le berceau était le châ
teau de Fontenille, près de Saint-Méard-de-Dronne.
Qui était donc le chevalier d’Aydie au moment où j’ou
vre devant vous le livre de sa vie, c’est-à-dire vers 1720, lors
qu’il atteint sa 28° année ?
Il était clerc tonsuré du diocèse de Périgueux, chevalier
de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem et lieutenant des ar
mées du roi où il devait devenir brigadier à partir de 1740.
Tels étaient ses titres officiels, mais il en possédait encore
un autre qui, pour n’être pas marqué sur parchemin, les
dépassait cependant tous. C’était un fort joli homme, qualité
qui n’a jamais nui à personne mais qui le servit, lui, prodi
gieusement et qui lui valut d’être nommé le beau d’Aydi*
par ses contemporains. Et quand je vous aurai dit qu'aux
charmes de sa personne il ajoutait ceux d’un esprit tellement
cultivé qu’il connut l’amitàé des principales célébrités de son
temps, entre autres Voltaire et Montesquieu, vous pourrez
mesurer de quelle séduction était notre héros.
Le chevalier d’Aydie avait su comprendre de bonne heure
qu’il ne tirerait qu’un faible parti de ces dons au pays natal.
11 était, au demeurant, comme tout cadet périgourdin, à peu
près sans fortune. Aussi n’avait-il pas hésité à prendre son
essor vers Paris. Il avait compris que là seulement il pour
rait donner sa mesure. Son frère aîné qui l’y avait précédé,
et .son cousin germain, le comte de Rions, celui-là même qui
fut l’amant ou le mari secret, comme on a dit par un aimable
euphémisme, de cette bouillante duchesse de Berry, fille du
Régent, ne demandaient qu’à le pousser. C’était là de sé
rieuses protections que notre cadet utilisa au mieux et il est
certain qu’il avait déjà acquis une certaine réputation dans
ce monde de libertins qu’on nommait les « roués » quand il
rencontra Mlle Aïssé.
Aïssé, comme je l’ai déjà dit, était d’origine circassienne.
En 1699, Charles de Ferriol, baron d’Argental et de SaintFerriol, étant ambassadeur de France à Constantinople, l’a
vait achetée pour 1-500 livres sur le marché d’esclaves de
cette ville, alors qu’elle était âgée de 4 ou 5 ans. Elle prove
nait, assurait-on, d’un famille princière d’un village que des
bandes armées avaient ravagé et incendié après avoir égorgé
les habitants. Emu par tant de détresse ou séduit par le char
me déjà captivant de cette petite fille, l’ambassadeur l’em
mena en France lors de son premier voyage et il en confia
l’éducation aux soins de sa belle-sœur, Mme de Ferriol, née
�3
de Tencin, sœur de la célèbre chanoinesse. Et l’ambassadeur
rejoignit son poste.
Elévée au couvent des nouvelles catholiques, la petite
esclave de Constantinople se révéla, un beau jour, une mer
veille de grâce et de beauté. Et ce fut précisément le temps
que choiisit M. de Ferriol pour rentrer définitivement en
France. Sans doute avait-il dû se faire tenir au courant des
progrès de sa protégée et de la transformation que la nature
avait opérée en elle. Mais il ne devait point s’attendre, pro
bablement, à une telle évolution dont il demeura ébloui quand
Aïssé parut devant lud.
Tant de charmes n’auraient dû éveiller dans son cœur
qu’une sorte d’orgueil paternel et de satisfaction désintéres
sée. Il en fut autrement.
Je sais bien que, sinon la vieillesse, du moins un âge
mûr avancé peut connaître les orages du cœur et le tumulte
des passions tardives. Je n’en veux pour preuve qu’un illus
tre exemple. Rappelez-vous Chateaubriand et l’Occitanienne.
Mais, du moins, celui-ci ne franchit-il pas les bornes d’une
affection platonique et quand il sentit le danger eut le cou
rage de s’éloigner.
Ah ! comme l’on voudrait, pour sa mémoire, que M. de Fer
riol en eût agi ainsi vis-à-vis d’Aïssé ! Mais il était d’une
autre époque et d’une autre culture et il n’était pas de ceux
qui peuvent goûter toute l’amère volupté d’un renoncement.
C’était un homme rude, hautain, violent, qui avait des
colères terribles avoisinant la démence et qui fut, une fois
même, enfermé comme fou, habitué à commander et à tout
voir plier devant lui, qu’une résistance rencontrée mettait
en fureur.
La pauvre Aïssé fut donc sa maîtresse et, s’il n’usa pas
de force à son endroit — et, encore, qu’en sait-on ? — il sut
la contraindre à céder à son désir et ne dut point se mettre
en peine pour lui rappeler sa qualité d’esclave, ce qui est une
forme de viol à peine moins odieuse que l’autre.
Aïssé garda pour elle ce douloureux secret. La vie conti
nua. Elle alla dans le monde et fut même présentée à la
Cour, où elle avait ses entrées en qualité de fille adoptive
d'un ambassadeur. Elle attira l’attention du Régent, mais
déclina ses offres, si fastueuses qu’elles fussent. Elle resta fi
dèle à son tyran qu’elle soigna jusqu’à sa mort qui arriva
le 23 octobre 1722.
Avant de mourir, l’ancien ambassadeur avait assuré par
un testament, fait 18 mois plus tôt, l’avenir d’Aïssé, en lui
léguant, en plus de 30.000 livres d’argent comptant, une rente
�.4 -
viagère de 4.000 francs dont les héritiers ou les évènements
la dépossédèrent, d’ailleurs, peu à peu.
C’est en 1720 ou 1721 que Mlle Aïssé rencontra le che
valier d’Aydie dans le salon de Mme du Deffand. Elle pou
vait avoir en ce temps 26 à 27 ans. C'était alors, au dire des
contemporains, une personne délicieuse avec, cependant, dans
le visage, une expression de mélancolie des plus touchantes.
« Elle avait assez souffert pour ne souffrir plus, dit Mi
chelet. Elle était résignée et douce, enjouée même; elle avait
une figure ouverte, aimable, où l’esprit rayonnait. Ses beaux
yeux d’Orient avec sa grâce toute française, c’était un con
traste piquant une chose singulière, unique, dont beaucoup
étaient fous. Et avec cela on eût pu entrevoir combien la pau
vre créature était tonisée. Elle avait des bras maigres et pau
vres. Son sein semblait celui d’une petite vierge de quinze
ans. On la sentait très neuve, presqu’une enfant par certains
côtés. »
Le chevalier d’Aydie fut complètement emballé comme
nous dirions aujourd’hui. Il ne devait point ignorer qu’elle
avait refusé les hommages du Régent. Quelle gloire pour lui
de réussir où le Régent avait échoué ! Grisé par sa réputation
d’homme à lionnes fortunes, il ne dut point douter, une seule
minute, du succès. Cependant son échec fut complet.
Il y a une dizaine d’années que j’ai publié sur les amours
du chevalier d’Aydie et de Mlle Aïssé une courte plaquette.
C’est vous dire que j’ai médité sur cette aventure. Et pour
qu’Aïssé ait cédé, plus tard, après avoir si superbement
décliné les offres du chevalier, il faut qu’un fait nouveau se
soit passé entre les deux dates. Je me suis demandé lequel
et sans pouvoir en fournir une preuve qu’aucun texte ne per
met d’administrer, j’imagine que le chevalier dut lui promet
tre le mariage.
Que ne le prit-elle au mot ? Mais comment eut-elle accepté
une pareille offre ? Le vieil ambassadeur n’était pas encore
mort et s’ouvrir à lui de tels projets n’était-ce pas faire cas
ser un testament d’où dépendait tout son avenir. Tant qu’il
vécut, Aïssé redouta sa jalousie. Oh ! l’ambassad-eur la te
nait bien.
Le chevalier, de son côté, ne dut pas lui cacher que, che
valier de Malte, il n’avait guère d’autres revenus que ceux
de ses coirimanderies et les dotations de son état qui impo
sait le célibat à ses adhérents. Bref, un mariage les eut mis
à peu près l’un et l'autre sur la paille. Mais comment Aïssé
eut-elle résisté à ce qu’elle prit pour une preuve de si magni
fique amour ?
�—5 —
Une fille leur naquit. Les complaisances dévouées qui
avaient entouré la grossesse d’Aïssé lui demeurèrent fidèles
lors de sa délivrance. L’enfant fut nommée Célinie Leblond
et au moment de sa naissance ne fut pas plus reconnue par
son père que par sa mère.
Mais il semble que, dès ce moment, le chevalier se montre
moins empressé. Sans doute, il reste tendre et affectueux pour
Aïssé, mais c’est, bien plus par devoir que par entraînement
du cœur. On le voit entreprendre de longs voyages en Péri
gord, où rien d’important ne l’attire positivement, y passer
des six mois d’affilée. On ne me convaincra jamais que ce
sont là d’insignes preuves d'amour.
Quant à Aïssé, du jour où naquit sa fille, elle commença
à gravir le calvaire que seule fit cesser sa mort. C’était une
âme profondément vertueuse et, d’avoir appartenu à l’am
bassadeur, encore que nul ne pût lui reprocher son déshon
neur, Aïssé souffnit abominablement. Un instant, elle pensa
que l'amour du chevalier la régénérait. Elle n’était donc pas
la créature amoindrie que ses scrupules lui représentaient,
puisqu’un honnête homme, et de noblesse, ne la trouvait pas
indigne de son nom. Mais elle crut devoir répondre par une
générosité semblable à celle du chevalier en refusant une
union dont elle redoutant qu’il se repentît un jour.
Cependant, le chevalier, à mesure que sa passion s’atté
nuait, sachant combien Aïssé était sensible à cette proposi
tion, où elle voyait une marque de si profond amour, lui en
renouvelait périodiquement l’expression.
Aïssé avait une amie, Mme Calandrini, Parisienne d’ori
gine et de culte protestant, Mme Calandrini, fille de M. Pélissary, trésorier général de la marine, s’était liée avec Mlle Aïs
sé du temps où son mari était résident de Genève à la cour
de France. Les mœurs de la Régence, en choquant les senti
ments religieux de Mme Calandrini, lui avaient, du même
coup, par le contraste qu’elles formaient avec le caractère
d’Aïssé, rendu cette dernière infiniment sympathique. Aïssé
lui voua jusqu’à sa mort une ardente amitié et les lettres
qu’elle lui écrivit constituent une documentation inapprécia
ble sur ses amours.
Or, un jour que le chevalier s’était montré probablement
plus pathétique dans son offre de mariage — car il partait,
le lendemain, pour cinq mois en Périgord et il s’agissait de
consoler le cœur douloureux d’Aïssé que cette absence meur
trissait — Aïssé l'écrit à son amie. La lettre est du mois
d’août 1727. Il y avait maintenant sept ans qu’ils se connais
saient. Voici cette lettre :
�« Le Chevalier est parti pour le Périgord, où il eompte
être cinq mois. Vous serez bien étonnée, Madame, quand vous
saurez qu’il m'a offert de m’épouser; il s’expliqua hier, très
clairement, devant une dame de mes amies. C’est la passion
la plus singulière du monde. Cet homme ne me voit qu’une
fois tous les trois mois. Je ne fais rien pour lui plaire. J’ai
trop de délicatesse pour me prévaloir de l’ascendant que j’ai
sur son cœur et, quelque 'bonheur que ce fût pour moi de l’é
pouser, je dois aimer le chevalier pour lui-même. Jugez, Ma
dame, comme sa démarche serait regardée dans le monde
s’il épousait une inconnue qui n’a d’autres ressources que la
famille de Monsieur de Ferriol. Non, j’aime trop sa gloire et
j’ai, en même temps trop de hauteur pour lui laisser faire
cette sottise. Quelle confusion pour moi d’apercevoir tous les
discours que l’on tiendrait ! Pourrais-je me flatter qu’il pen
sât toujours de même à mon égard ? Il se repentirait assuré
ment d’avoir suivi sa folle passion et moi je ne pourrais sur
vivre à la douleur d’avoir fait son malheur et de n’en être
plus aimée. Il me tint les propos du monde les plus tendres,
les plus fous, les plus extravagants... Il me dit que si je vou
lais l’épouser, j’en étais la maîtresse, mais qu’autrement, il
croyait que nous pourrions bien, quand même nous serions
sans conséquence l’un et l’autre, passer le reste de nos jours
ensemble; qu’il m’assurerait une grande partie de son bien,
qu’il était mécontent de ses parents, à l'exception de son frère
à qui il donnerait honnêtement pour qu’il fût content. Et,
pour me faciliter d’accepter sa proposition, il me dit que nous
ferions cession au dernier vivant de nos biens. Je badinai
beaucoup sur mes vieux cotillons quii sont tout l’héritage que
je pouvais assurer. Notre conversation finit par des plaisan
teries. »
Cette lettre est bien plus que charmante. Elle est parti
culièrement émouvante et si j’en ai cité un si long passage,
c’est pour ces raisons et, aussi, pour donner un échantillon
du style de Mlle Aïssé.
Cependant, puisque notre héroïne se refusait à devenir la
femme du chevalier, il fallait bien qu’elle s’avouât qu’elle
en restait la maîtresse. Oh ! cela n’avait pas,en général.beau
coup d’importance parmi les grands au xvine siècle. Elle eût
pu s’autoriser de plus d’un exemple et vivre en paix-avec sa
conscience. Or, pour la conscience d’Aïssé, cela avait une si
grande importance qu’elle en mourut.
Les catastrophes du sentiment ne nous tuent pas, sans
doute; l’ambition déçue, la ruine, le désespoir, à eux seuls,
sont impuissants à triompher de notre vie, mais ces catas
�trophes utilisent merveilleusement nos tares. Un médecin
vous dira — et il aura raison — que Mlle Aïssé mourut de
tuberculose pulmonaire, mais un historien de sa vie peut très
bien prétendre que ce sont ses scrupules qui la tuèrent et,
lui, non plus, n’aura pas tort.
Toute la correspondance de Mlle Aïssé avec Mme Calandrini, traite de ses malaises d’abord, de sa maladie ensuite,
mais, aussi, des tortures de son âme et si on assiste, lettre
par lettre, à l’évolution de l’implacable phtisie qui devait
l’emporter, on voit aussi le progrès de ses dévorantes an
goisses.
Le 10 juin 1728, elle écrit : «Le devoir, l’amour, l’inquié
tude et l’amitié combattent sans cesse mon esprit et mon
cœur. Je suis dans une cruelle agitation. Mon corps succom
be, car je suis accablée de vapeurs et de tristesses, et s’il
arrive malheur à cet homme, je sens que je ne pourrai pas
supporter cet horrible chagrin. »
Une autre fois, elle dira : « Vous me demandez des nou
velles de mon cœur ; il est parfaitement content, Madame, à
une chose près que des difficultés insurmontables empêchent.
Hélas ! je suis telle que vous m’avez laissée, bourrelée de
cette idée que vous savez. »
En 1729, elle écrira encore : « Hélas ! madame, je me rap
pelle sans cesse notre conversation dans votre cabinet. Je
fais des efforts qui me tuent. Tout ce que je peux vous pro
mettre, c’est de ne rien épargner pour que l’une des deux
choses arrive; mais, Madame, il m’en coûtera peut-être la
vie. »
Vous avez bien compris, n’est-ce pas ? que l’alternative
dans laquelle elle se débat et dont Madame Calandrini lui
fait une nécessité, c’est de rompre avec le chevalier ou de
régulariser sa liaison.
Que faisait le chevalier pendant ce temps ? Il était tou
jours le même. Du moins, il avait l’habileté et, on peut le
dire, la générosité de le persuader à sa maîtresse. D’ailleurs,
ses visites à Aïssé étaient fort espacées. Rappelez-vous les
termes de la lettre que je vous lisais il n’y a qu’un moment :
« C’est la passion la plus singulière du monde. Cet homme ne
me voit que tous les trois mois... »
Bien singulière, en vérité, cette passion ! Si singulière
qu’on se prend à douter, maintenant, de la sincérité du che
valier. Aïssé, elle-même, eut, un jour, un doute, oh ! bien fu
gitif, mais qui suffit pour justifier de tels soupçons ; « Je ne
puis exprimer la joiie qu’il a eue de mon retour, écrit-elle à
Mme Calandrini. Tout ce que la vivacité d’une passion vio
�lente peut faire et dire, il l’a dit et fait. Si c’est jeu, c’est bien
joué ! » Et, une autre fois, n'écrira-t-elle pas dans une crise
de lassitude ces paroles désenchantées : « Tout n’est qu’apparence chez les hommes. Le masque tombe à la plus petite
occasion. La probité n’est qu’un nom dont ils se parent. Ils
paraissent justes et ce n’est que pour condamner la conduite
des autres : de la douceur qui n’est qu’aigreur, de la généro
sité qui n’est que prodigalité, de la tendresse qui n’est que
faiblesse ! »
De la tendresse qui n’est que faiblesse ! Quelle profonde
vision du cœur de son amant ! L’amour du chevalier en était
descendu à ce degré. C’est encore beaucoup qu’il s’y soit
arrêté, me direz-vous, peut-être. C’est vrai. Mais, si je me suis
étendu sur ce refroidissement progressif du chevalier c’est
qu’une littérature trop indulgente a précisément voulu voir
dans cette liaison un modèle d’amour comme il ne s’en était
rencontré, je suppose, qu’en des temps quasi-légendaires com
me entre Roméo et Juliette ou même entre Tristan et Iseult.
Certes, le chevalier d’Aydie fut un honnête homme. Les
malheurs d’Aïssé l’avaient évidemment touché et, mieux que
quiconque, il connut ce qu’avait dû infliger à sa pauvre amie
de détresse morale l’acte odieux de l’ambassadeur. Le sa
chant, il eut le mérite de comprendre qu’Aïssé ne survivrait
pas à un abandon de sa part, ni même à un fléchissement
apparent de son amour. Et c’est bien pour cela qu’il ne dis
continua jamais de la bercer des paroles qui la charmaient.
De la tendresse qui n’est que de la faiblesse ! Qui sait ?
peut-être même que de la pitié ! Car Aïssé s’en allait à grands
pas vers sa fin. La maladie, surtout une maladie lente et
consomptive, est une terrible ravageuse de l’amour.
Et, pourtant, le chevalier, par scs offres réitérées de ma
riage, avait tellement comblé le cœur d’Aïssé que, se croyant
toujours aimée et même désirée, elle pensa que, pour se ré
concilier avec Dieu, qu’elle imaginait avoir singulièrement
offensé, elle devait lui demander de renoncer à elle et de ne
lui donner plus qu’une pure amitié.
Le chevalier lui répondit par une lettre. Et cette réponse
Aïssé la trouva si belle qu’elle ne put résister au plaisir de
la communiquer à Mme Calandrini. C’est grâce à cette com
munication que le texte nous en est parvenu. Je ne vous en
cite que l’essentiel :
« Votre lettre, ma chère Aïssé, me touche bien plus qu’elle
ne me fâche; elle a un air de vérité et une odeur de vertu à
laquelle on ne résiste pas. Je ne me plains de rien puisque
vous me promettez de m’aimer toujours. J’avoue que je ne
�suis pas dans les principes où vous êtes, mais, Dieu merci,
je suis encore plus éloigné de l’esprit de prosélytisme et je
trouve juste que chacun se conduise suivant les lumières
de sa conscience... Je vous verrai, demain, dit-il plus bas, et
ce sera moi-même qui vous remettrai cette lettre. J’ai mieux
aimé vous écrire que vous parler parce que je sens que je
ne pourrais traiter avec vous la matière sans pernre conte
nance... »
Cette lettre est insérée dans l’avant-dernière lettre qu’Aïs
sé écrivit à Mme Calandrini. Elle est de 1733 et Aïssé mourut
le 13 mars de cette même année.
Eh ! bien, on me dira ce qu’on voudra, mais je n’ai pas
pu encore m’habituer à trouver splendide cette lettre que le
chevalier d’Aydie écrivit, mettons six semaines avant la mort
d’Aïssé, à sa malheureuse amie. J’y voudrais autre chose,
tout à fait autre chose et, surtout, je sais bien ce que je n’y
voudrais pas. Et ce que je n’y voudrais pas, c’est une phrase
comme celle-ci : « Je suis encore plus éloigné de l’esprit de
prosélytisme et je trouve très juste que chacun se conduise
suivant les lumières de sa conscience ». Cela, voyez-vous,
c’est tout ce que l’on voudra, sauf un cri désespéré, sauf un
sanglot déchirant qui signe la douleur devant la séparation
imminente,, comme on se serait attendu à en trouver. C’est
tout, sauf le viatique auquel l’âme brisée d’Aïssé avait droit.
Mais non. Le chevalier ne se met plus en peine. Il est las de
toute cette aventure. Il aligne des phrases où ne tressaille
aucune émotion. Il trouve tout naturel, Dieu me pardonne,
de sermonner.
Et que l’on ne vienne pas me dire que cette manière d’é
crire était celle du temps, que toute correspondance, même
celle qui eût dû être la plus tendre, avait quelque chose de
réservé tendant à la froideur. C’est à d’autres qu’il faut le
raconter. Voyez plutôt de quelle encre il se sert quand il s’a
dresse au bailli de Froullay, le plus cher de ses amis en mê
me temps que son supérieur dans l’ordre de Malte :
« Ayez soin de votre santé pour l’amour de vous et pour
l’amour de moi. Je ne voudrais ni ne pourrais vivre sans
vous...
« Je vous embrasse, mon cher ami, et me redonne tous les
jours à vous, quoique j’y sois entièrement depuis longtemps...
« Votre amitié, mon cher bailli... fait tout mon bonheur
et toute la gloire où je prétends... »
Ne trouvez-vous pas que cela donne un tout autre son ?
Remarquez, d’ailleurs, que le chevalier avait quelque ex
cuse à n’être plus cet amant passionné. A Dieu ne plaise que
�je paraisse le noircir ! Sa maîtresse touchait à l’agonie et les
dernières lettres de Mlle Aïssé à Mme Calandrini sont toutes
remplies de la description des progrès de son mal :
« .T’ai été très (incommodée d’un très gros rhume qui m’a
fait garder le lit ». (Paris 1730).
« Il faut, dira-t-elle encore en janvier 1732, que je vous
parle de mon faible corps; il est bien faible; je ne puis me
remettre de ma furieuse maladie. Je ne reprends point le
sommeil. J’ai été 37 heures sans fermer les paupières... »
Et ceci pour ses tortures morales : « On dit que je suis
mieux, non que je trouve du soulagement. Je crache des hor
reurs et je ne dors que par art. Je suis tous les jours plus
maigre et plus faible... Je me trouve anéantie... Pour les dou
leurs de l’âme, elles sont cruelles. Je ne puis vous dire com
bien me coûte le sacrifice que je fais; il me tue » .(Paris 1732.
Et, enfin, ceci qui est son glas :
«Ma santé est toujours la même et la saison est très peu
propre pour attendre des succès des remèdes. Vous me de
mandez si je suis changée. Je le suis très fort. Je n’ai que la
peau et les os ». (Paris 1733).
Aïssé mourut le 13 mars 1733.
Et, maintenant, devant une telle fin et après l’aveu de
la victime que son sacrifice la tue, n’est-on pas en droit de
se demander si l’amitié de Mme Calandrini ne fut pas plus
néfaste qu’utile à Mlle Aïssé, en suscitant dans l’aine de sa
jeune amie cette sorte de culte du remords et cette soif de
renoncement ? Calviniste rigide, Mme Calandrini fut-elle la
confidente que méritait cette pauvre petite Aïssé tourmentée,
harcelée de scrupules; fut-elle le confesseur sagace et misé
ricordieux qu’appelait cette âme désemparée ? Demeure-t-elle
pour nous digne de l’enthousiasme humble et par là si tou
chant que lui voua Aïssé ? Tl est permis d’en douter, surtout
quand par ailleurs on connaît le personnage.
Bien que je déborde un peu mon sujet, accordez-moi
de vous en esquisser une rapide silhouette.
Elle s’appelait Julie de son prénom et, étant jeune fille,
avait su inspirer des vers à un poète, aujourd’hui bien ou
blié, qui n’en fut pas moins de l’Académie française, Etienne
Pavillon; vers, dont, mon Dieu ! elle se fût peut-être bien pas
sée et dont voici les premiers :
Je le sais, ma chère Julie,
Tu chantes comme une poulie
Et ne danses pas finement...
On voit qu’ils n’étaient guère faits pour la mettre en va
leur. Nous dirions aujourd’hui qu’ils étaient plutôt rosses.
�- 11 Elle épousa M. Calandrini qui, en réalité, s’appelait Calandrin, mais elle s’avisa que d’ajouter un i à son nom faisait
plus aristocratique. Elle en eut une fille unique, d’une rare
beauté, qu'elle obligea à épouser un M. Rieu, vieux, horrible
ment laid et, par surcroît, pas toujours trop aimable, mais
si riche de par le système de Law que, non seulement la vaiselle, ce qui s’entend assez, non seulement les couverts, les
flambeaux et les bougeoirs ce qui s’admet encore, mais jus
qu’aux vases de nuit, tout était en or, dans sa maison. La
chûte du système amena l’écroulement de la. fortune de
M. Rieu et, du même coup, une colère contre son gendre de
la part de Mme Calandrini, impossible à décrire. Pour faire
court, elle voulait à toute force que sa fille divorçât. Elle la
pressait tellement que celle-ci, à la fin exaspérée, lui fit cette
réponse : « Ecoutez, ma mère, vous m’avez donné M. Rieu
quand je ne le voulais nullement. Maintenant, je suis sa fem
me, j’ai de lui deux enfants; il est pauvre et malheureux, je
ne le quitterai pas ».
★★★
Le chevalier d’Aydie, pendant les vingt-huit années qu’il
survécut à son amie, semble avoir très bien supporté sa dou
leur. Les morts, de tous temps, sont allés vite. S’il parlait
quelquefois ou même souvent d’elle, nous sommes destinés
à l’ignorer. Ce qui est certain c’est qu’en aucune pièce de la
correspondance qu’il a laissée, on ne trouve la moindre al
lusion ou si peu que rien, à celle dont il avait parfumé la
vie et qui l’avait aimé « jusqu’à s’en mourir», pour employer
une si jolie expression de Maeterlinck.
Elle méritait mieux. Si elle est, surtout, restée pour
la postérité intéressante par ses malheurs et son amour,
Mlle Aïssé a le droit de retenir l’attention par le charme
qu’elle tenait des qualités de son esprit. Ses lettres à Mme Ca
landrini, même ôté tout ce qui a trait au chevalier, n’en
constitueraient pas moins un livre fort précieux encore et
qu’on lirait avec un plaisir marqué.
L’ambassadeur de Constantinople avait bien fait les cho
ses. La petite esclave circassienne était, évidemment, très in
telligente; mais son éducation soignée avait porté des fruits
remarquables.
De sa correspondance on peut conjecturer ce que devait
être sa conversation. Il serait trop long d’énumérer tout ce
qu’il y a de délicieux dans ses lettres, mais je m’en voudrais
de ne pas vous livrer le réoit de ses amours avec le petit duc
de Gesvres, quand elle avait huit ans et lui onze. Il lui vint en
�esprit que c’était un péché — déjà ses scrupules — et qu’elle
en devait confession à son directeur.
« J’étais dévote et j’allais à confesse. Je dis d’abord tous
mes petits péchés; enfin il fallut dire le gros péché. J’eus de
la peine à m’y résoudre, mais en fille bien éduquée je ne vou
lus rien cacher. Je dis que j’aimais un jeune homme. Mon
directeur parut étonné; il me demanda quel âge il avait; je
dis qu’il avait onze ans; il me dit s’il m’aimait et me l’avait
dit; je dis que non. Il continua ses questions : Comment l’ai
mez-vous ? me dit-il, — Comme moi-même, je lui répondis.
— Mais, me répondit-il, l’aimez-vous autant que Dieu? Je
me fâchai et je trouvai fort mauvais qu’il m’en soupçon
nât. Il se mit à rire et me dit qu’il n’y avait point de
pénitence pour un tel péché, que je n’avais qu’à continuer
d’être toujours bien sage. »
Elle abonde en anecdotes, spirituelles toujours, malicieu
ses parfois, jamais méchantes. Elle donne des opinions fort
justes sur les livres qu’elle lit, les spectacles auxquels elle as
siste. Elle a le goût du bibelot et prend plaisir à longuement
combiner l’ameublement de sa chambre.
N’en voilà-t-il pas assez pour composer de Mlle Aïssé
avec tout ce que l’on sait déjà de sa beauté, de son honnêteté,
de sa bonté, un souvenir auquel il semble que le chevalier
eût dû aimer se reporter ?
Lui fut-il fidèle ?
Vous m’en demandez trop. Certes, quand il approcha de
la soixantaine, il dut renoncer à plaire pour de bon, mais Aïs
sé ne fut pas la dernière aventure du trop tendre chevalier.
Sa correspondance montre qu’en 1749 il était parfaitement
consolé et qu’il faisait une cour des plus assidues, sinon cou
ronnée de succès, à une dame d’un certain âge, la comtesse
de Tessé, dame du palais de Marie-Josèphe de Saxe, dau
phine de France, mère de Louis XVI.
Il en était encore fort épris en 1753 et lui écrivait :
a J’ai la goutte bien serré, Madame la Comtesse, et mon
médecin prétend que non seulement je ne dois pas vous écri
re, il me défend même de penser à vous. Il dit que cela me tue.
Mon confesseur, d’un autre côté, assure que cela me damne.
Je me porte cependant mieux depuis que j’ai reçu la lettre
que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, et, de là, je con
clus que je dois vous remercier et me moquer de leurs raison
nements ».
En revanche, il fut le père le plus attentif, le plus affec
tueux, le plus prévenant que l’on puisse imaginer. Quand sa
�tille fut en âge d’être mariée, il la prit avec lui et il l’emmena
en Périgord, où il se fixa définitivement.
L’arrivée de la jeune fille y provoqua un enthousiasme
extraordinaire. Traînant tous les cœurs après soi, elle connut
dès ses premières visites, les hommages les plus flatteurs.
Sa beauté, son esprit, sa grâce enchaînaient; son sourire en
sorcelait. Ceux qu’elle venait visiter avaient tant de peine à
la laisser partir que, plutôt que de renoncer à sa présence, ils
l’accompagnaient dans ses autres visites et c’est avec l’im
posant cortège de ceux qu’elle venait de voir qu’elle abordait
au château de ceux qu’elle venait voir.
De tels succès n’étaient pas pour déplaire, il s’en faut, à
son père. Un gentilhomme de bonne maison, M. de Nanthiac,
en devint amoureux et obtint sa main entre de nombreux ri
vaux. Céliniie Leblond reçut en dot 50.000 livres. Le contrat
de mariage fut signé au château de Lanmary, le 16 octo
bre 1740.
Après le mariage de Mme de Nanthiac, le chevalier ha
bita au château de Mayac, chez sa sœur, la marquise d’Abzac et dans la compagnie intermittente de son frère, l’abbé
d’Aydie, chanoine et vicaire général de Tours. Il fut, dès
lors, complètement perdu pour la société de Paris et n’exista
plus que pour l’amitié, la chasse et les bons repas. C’est lui
même qui prend soin de nous en informer
C’est de Mayac qu’en 1754 ou 1755 il écrivait à la mar
quise du Deffand.
« Je chasse, je joue, je me divertis du matin jusqu’au
soir avec mes frères et nos enfants. Je vous avouerai tout
naïvement, Madame, que je n’ai jamais été plus heureux et
dans une compagnie qui me plaise davantage ».
Comme cette phrase en dit long sur le souvenir d’Aïssé !
Je n'ai jamais été plus heureux !
Ce n’est pas que le château de .Mayac fût une demeure
somptueuse et que la fortune du marquis d’Abzac fût consi
dérable, mais les bénéfices de l'abbé d’Aydie, les dotations
du chevalier passaient dans la maison et contribuaient à
son train et les châtelains de ce temps-là savaient pourvoir à
une large hospitalité sans beaucoup de frais.
Le château de Mayac devint bientôt le centre intellectuel
du Périgord. Sainte-Beuve nous apprend que, durant les
mois d’été, c'était le rendez-vous de la haute noblesse de la
province et de très grands seigneurs de la cour. On y venait
de Versailles en poste. Un jeune homme de qualité ne quittait
point, en ce temps-là, le Périgord pour Paris sans avoir été
�— 14 —
présenté à Mayac et s’y être pourvu des lettres de recomman
dation qui devaient l’accréditer dans la capitale.
Une lettre du chevalier d’Aydie était le gage d’un accueil
chaleureux auprès des grands de ce temps-là. Car, de sa re
traite, le chevalier n'oubliait point ses amis et entretenait
avec eux des relations épistolaires suivies où, malgré son
bonheur d’être en Périgord, il leur marquait quelque nostal
gie de Paris et de leur société.
Il écrivait à Mme du Deffand. en 1754 — il avait alors
soixante ans bien sonnés, comme nous disons —
« J’enrage d’être à cent lieues de vous, car je n’ai ni
l’ambition, ni la vanité de César. J’aime mieux être le der
nier et seulement souffert dans la plus excellente compagnie
que d’être le plus considéré dans la mauvaise et même dans
la commune; mais si je n’ose dire que je suis dans le premier
cas, je puis au moins vous avouer que je ne suis pas dans le
second. J’y trouve avec qui parler, rire et raisonner autant et
plus que ne s’étendent les facultés de mon pauvre entende
ment et l’exercice que je prétends lui donner. 11 est vrai que
nous ne traitons point les mêmes questions que l’on agite à
Paris. Nous ignorons les démarches du gouvernement, du
parlement, du Châtelet, les querelles de l’Académie, mais,
Madame, est-ce un si grand malheur ?
« Voilà encore, ajoutait-il en terminant, une lettre im
mense; je ravale pourtant mille choses que je voudrais vous
dire et dont je vous fais grâce pour ne pas trop vous aviser
combien il est dangereux d’attaquer un provincial oisif qui
ne finirait jamais s’il se laissait aller aux effusions de son
cœur et à son babil, quand quelques marques de vos bontés
viennent le réveiller. 11 faut, cependant, que j’ajoute, Madame,
que j’ai l’honneur de vous envoyer un pâté et que mon frère
et Madame de Nanthiac vous présentent leurs très humbles
respects. »
Vous voyez qu’en ce temps-là les pâtés du Périgord étaient
déjà tenus en estime et qu’ayant à faire un présent à son
illustre amie, le chevalier d’Aydie ne trouve rien de mieux à
lui offrir.
C’était d’ailleurs son présent favori.
Il écrivait à la marquise de Créquy, le 10 décembre 1751 :
« J’ai l’honneur, Madame, de vous adresser un pâté de
Périgueux. C’est le seul hommage matériel que puisse offrir
un Périgourdin. Je souhaite donc qu’il soit de votre goût. »
Il en envoyait, naturellement, à la comtesse de Tessé,
mais surtout au bailli de Froullay.
�- 15 Ces pâtés d’ailleurs n’étaient pas de la confection de son
cuisinier, mais d’une bonne femme de Périgueux, dont il
n’était pas toujours content; non qu’iil eût à se plaindre de
son talent, puisqu’il avait constamment recours à elle, mais
— et je rougis d’en faire l’aveu — de son honnêteté.
« Le premier pâté qui vous est destiné est parti le 4, écritil au bailli. Les autres suivront régulièrement et les dindes
aussi; mais il est toujours à propos que votre Excellence m’en
accuse la réception, pour que cette femme ne triche pas, com
me elle a souvent fait et a vraisemblablement toujours envie
de faire. »
Le 9 janvier 1754, il rappelle à son ami qu’iil ne lui a pas
accusé réception du premier pâté. « Je vous supplie, ajoutet-il, de ne pas l'oublier. »
Il revient encore à la charge l’année suivante :
« Vous devez avoir reçu un pâté. Accusez-les moi à me
sure que vous les recevrez et les dindes aussi; car cette fem
me qui les envoie est une tricheuse ou, du moins, une brouil
lonne, et souvent elle ne sait ou affecte de ne savoir ce qu’elle
fait. »,
Ce diable d'homme avait le génie de se faire aimer. La
douce Aïssé est le plus illustre exemple de l’attraction qu’il
exerçait; mais il connut aussi des témoignages écrits de l’a
mitié la plus ardente.
Voyez comme Montesquieu lui parlait :
« Vous êtes adorable, mon cher chevalier; votre amitié
est précieuse comme l’or...
« Votre lettre est charmante; je croyais en la lisant vous
entendre parler...
« Je vous aimerai et vous respecterai jusqu’à la fin de
mes jours. Il me semble qu’en lisant votre lettre, je faisais
plus usage de mon cœur que de mon esprit...
« Il n’y a rien de comparable au bonheur de vivre avec
vous...
« Conservez-moi toujours votre amitié que j’adore. Vous
êtes, mon cher chevalier, mes éternelles amours et il n’y a en
moi d’inconstance que parce que j’aime tantôt votre esprit,
tantôt votre cœur. »
Voltaire le nommait le chevalier sans peur et sans re
proche.
N’est-ce pas là d’illustres amitiés, auxquelles il ne faut
pas omettre d'ajouter celle de Mme du Deffand ?
Avec de telles amitiés, les puissantes protections qu’il
avait à la cour — il avait même été distingué par la reine
�Marie Leczinska — avec son grade de brigadier des armées
du roi, toutes choses dont le chevalier exit pu tirer parti,
peut-être vous demanderez-vous pourquoi, renonçant à toute
ambition, il vint se fixer en Périgord où, à part quelques
courts voyages et de plus en plus espacés, il demeura jus
qu’à sa mort, soit pendant un peu plus de vingt ans.
A ceux qui seraient tentés de poser une pareille question,
je pourrais répondre simplement qu’ils ignorent de quelle
séduction peuvent devenir la solitude et le repos pour un
homme aux approches de la cinquantaine. On a assez vécu
pour juger de l’inanité de bien des espoirs et on est en droit
de compter sur assez de jours encore pour avoir le désir de
les employer mieux.
Quel est celui d'entre les hommes d’action ou de pensée
qui, après être parvenu aux hauts plateaux de la vie, et se
retournant vers le chemin gravi et jugeant le labeur accom
pli, n’a pas murmuré, au mains une fois, la voix lasse et le
geste découragé, le déprimant : Quid prodest. ?
Le Périgord, si j’en juge par moi-même, a exercé tou
jours un singulier appel sur ceux de ses fils qui avaient cru
pouvoir vivre leur vie loin de lui.
Je m’étonnais tout à. l’heure, devant vous, que le cheva
lier aimé, riche et comblé pût se séparer d’Aïssé pour des
périodes de six mois qu’il venait passer en Périgord. Ne seraitce pas qu’il aimait encore plus le Périgord que sa maîtresse ?
Peut-être le chevalier se retira-t-il aussi en Périgord pour
soustraire sa fille aux dangers de la capitale. S’effraya-t-il,
se souvenant des malheurs d'Aïssé, des risques que son en
fant — officiellement sans père, ni mère, ne l’oublions pas,
ce qui était une circonstance particulièrement aggravante —
pouvait courir dans un monde qu’il ne connaissait que trop ?
Mais s'il ne se fût retiré à Mayac que dans ce but, rien ne
l’y eût retenu après le mariage de Mme de Nanthiac.
Peut-être encore est-ce par suite du chagrin qu’il eût de
la mort d’Aïssé ? Après ce que je vous ai dit j’en serais éton
né mais, tout compte fait, je puis m’être trompé dans mes
déductions et il n’est pas défendu d’envisager cette hypo
thèse.
Ce qui est certain, c'est que le chevalier marqua un grand
bonheur d’être revenu au pays natal.
Et c’est, aussi, il faut le dire, qu’il sut s’y organiser une
vie des plus agréables.
Ah certes, le temps présent dispose de beaucoup de sé
duction'- inconnues au xvnie siècle, mais il est un point sur
lequel nous sommes bien inférieurs à nos devanciers. Je veux
�— 17 —
parler de leur art de recevoir et de leur science du bien vivre
et cela, surtout dans nos provinces, singulièrement dans le
Périgord. Il n’était point de gentilhommière où l’on n’accueil
lit à bras ouverts et sans compter les hôtes des manoirs voi
sins. Le château de Mayac ne faisait point exception à une
tradition si répandue. 11 y excellait plutôt et il n’est pas exa
géré de dire qu’il donnait le ton. Les repas y étaient magni
fiques.
Ecoutez M. de Saint-Aulaire peindre l’hospitalité qui
était de règle au château de Mayac :
« il n’était pas rare, dit-il, de voir arriver à l’heure du
dîner, douze ou quinze convives non attendus. Les hommes
et les jeunes femmes venaient à cheval, chacun suivi de deux
ou trois domestiques. Les gens âgés venaient en litière, les
chemins ne comportant pas l’usage de la voiture. Les provi
sions de bouche étaient faites en vue de ces éventualités et la
cuisine de Mayac était renommée; mais la place manquait
pour loger et coucher convenablement tous ces hôtes. Les
hommes s’entassaient dans les salons, dans les corridors; les
femmes couchaient plusieurs dans la même chambre et dans
le même lit. »
Sans doute avec l’hiver ces visites s’espaçaient et même
s’arrêtaient. Alors, quand le mauvais temps rendait les che
mins impraticables, quand le froid, la neige, la pluie asservissaient la campagne, force était aux seigneurs de Mayac
de s’enfermer chez eux et de se resserrer auprès des hautes
et vastes cheminées flambantes de leur demeure. Mais, pour
être cloîtrés ils n’en faisaient pas moins Honneur à leur ta
ble. La ‘bonne chère n’avait rien à redouter des intempéries.
Entre les repas, ils jouaient aux cartes, à quadrille de préfé
rence qui était un jeu qui se jouait à quatre, et avec une telle
passion parfois qu’ils ne craignaient pas de référer d’un coup
douteux au bailli de Froullay pour qu’il l’arbitrât. Ils lisaient
à haute voix quelque livre nouveau, épuisaient les heures
vides en longues causeries, en projets, en rappels de souve
nirs où l’on devine la part et le succès de notre chevalier. Il
taquinait la marquise d’Abzac sur un ancien penchant pour
le bailli. Il se rappelait l’avoir même écrit jadis, de Vaugou
bert, à son ami :
« Ma sœur dit quelquefois : « Ah ! voilà une oronge
que je voudrais bien que le bailli de Froullay mangeât ! »
Savez-vous que cette sœur est la plus aimable et la plus ver
tueuse créature qui vive. Malheureusement, elle n’est pas
jolie; sans cet inconvénient, je vous conseillerais cfe venir ici
mettre à profit les préventions favorables qu’elle a sur votre
�— 18 —
compte. Je crois qu’elle a un roman dans la tête dont vous
êtes le héros. »
Et, pourtant, avec la fuite des jours, on sent son enthou
siasme diminuer, mais c’est pour d’autres raisons que l’en
nui ou le sentiment de s’être trompé.
Le souvenir lui reste toujours cher de l'accueil des siens
lors de son arrivée à Mayac, en 1740 : « Je ne sors des bras
de l’un que pour entrer dans ceux de l’autre. Ma mère, ma
sœur, mon frère, mon beau-frère, mes neveux m’inspirent, et,
me témoignent les sentiments les plus tendres. »
A aucun moment ces sentiments ne s’étaient refroidis.
Il n’avait de souvenir douloureux que la mort de sa mère
survenue en 1743.
La chasse restait toujours son passe-temps le plus favori,
qu’il s’agît de la chasse au faucon ou de la chasse à courre.
Et il ne pouvait se retenir d’instruire périodiquement son
amii des émotions qu’il y trouvait ou des évènements qui la
marquaient.
« Il est arrivé, aujourd’hui, un grand désastre à notre
fauconnerie. Un faucon de quatre mues, le meilleur qu’il y
eût au monde, je crois, s’est cassé une aile en fondant sur
une perdrix. » ' 1743).
« Nous chassons, Dieu merci, très souvent et très agréa
blement, dira-t-il une autre fois. Nous avons de jolis chiens,
de jolis chevaux, un bon piqueur, sage et qui sonne bien. En
fin, tout notre fait irait à merveille si j’avais un bon cuisi
nier: mais celui que j’ai pris sans l’éprouver assez, se trouve
si détestable que je suis obligé de le renvoyer. Il achève de
gâter celui de ma sœur qui, tout mauvais qu’il est, valait
encore mieux que celui-ci quand il travaillait tout seul. »
(11 novembre 1751).
« Nos chasses vont fort mal. II est descendu une si grande
quantité de lièvres en ce pays-ci que nous ne pouvons en
forcer aucun. Nos chiens prennent le change à tout mo
ment » (11 janvier 1754).
Le Périgord demeurait donc toujours cher au chevalier et
ne perdait rien de son charme, mais le chevalier vieillissait.
Il y avait longtemps, (en 1744) que, répondant au bailli
de Froullay qui lui annonçait combien le duc de Chartres
était amoureux, il s’était écrié ; « Qui est-ce qui ne penserait
pas de même à son âge et à sa place ? O mihipræteritos re/erat ai Jniriter annon. » ajoutait-il. C’était son habitude de
citer volontiers du latin dans sa correspondance. Et cela peut
se traduire assez simplement par : « Ah ! si je pouvais rede
venir jeune ! »
�19 —
Il n’était plus le beau d'Aydie. Et c’est dans cette vieil
lesse approchante qu’il tant chercher la cause, sinon d’une
misanthropie avérée, du moins d’une amertume désenchantée
et d’un penchant un peu trop prononcé au dénigrement de
soi.
En 1754 — il a alors 62 ans — il écrira à sa vieille amie,
Mme du Deffand :
« Vieux et goutteux comme me voilà et par conséquent
peu agréable à la société et parfaitement inutile à tous égards,
je pense que je ferais très sagement d’achever ici ma car
rière. »
Ce fut toujours une habileté de se railler soi-même pour
ôter aux autres le prétexte de le faire. Mais cela n’atténue
qu’assez imparfaitement le poids de souffrance que l’on porte
en soi.
« Je suis plus paresseux qu’un vieux âne », dira-t-il au
bailli de Froullay qui lui reproche amicalement de n’avoir
pas écrit à un M. de la Peyronie, comme il le devait. Et, ci
tant encore du latin, il ajoute « Pudet hæc opprobria nobis
et dici potuisse et non potuisse referri» «J’ai honte de
l’avouer et de ne pouvoir m’en corriger ».
Il déclare ne penser plus guère qu’une souche, savourant
les yeux mi-clos, les dernières voluptés qui lui sont permises,
ayant pris définitivement ses grades dans le collège des vieux,
Il saura même nous faire rire.
« Le brave Julien m’a totalement abandonné. Il ne m’en
voie ni livres, ni nouvelles et il faut avouer qu’il me traite
assez comme je le mérite, car je ne lis, aujourd’hui, que com
me d’Ussé qui disait qu’il n’avait le temps de lire que pen
dant le temps que son laquais lui attachait les boucles de ses
souliers ».
Il ne faudrait pas prendre au pied de la lettre tout le
mal que le chevalier d’Aydie, morose et vieilli, disait de luimême, notamment, croire sans restriction à sa paresse d’es
prit.
Ecoutez plutôt cette lettre du 23 septembre 1756 au bailli
de Froullay. Nous étions alors engagés dans cette affreuse
guerre de Sept ans, qui a porté à la France un coup si fu
neste pendant sa durée et qui, finalement, la dépouilla de ses
plus belles possessions de l’Inde. Il s’agit spécialement ici
des visées ambitieuses du roi de Prusse qui s’était joint,
contre nous, à l’Angleterre, laquelle, au mépris du droit des
�gens et en pleine paix, venait de s’emparer de plusieurs de
nos vaisseaux et menaçait nos colonies. Voici cette lettro :
« Vous avez dû trouver la cour dans de grandes délibéra
lions sur les mesures que l'on doit prendre pour arrêter et ré
primer les entreprises du roi de Prusse. Indépendamment des
traités, si toutes les nations ne s'accordent ,à punir ces sortes
de brigandages et à l'établir le droit des gens si continuelle
ment et si grossièrement violé, il faudra bien que l'Europe pé
risse incessamment. 11 est aussi très visible qu’un prince qui
prétend conserver sur pied des armées que ses Etats ne peu
vent ni soudoyer, ni recruter, se inet par là dans la nécessité
de fomenter la discorde entre ses voisins et de les rançonner
tour à tour ou de leur faire la guerre, de quelque manière que
ce puisse être. Or, le roi de Prusse étant, aujourd’hui, dans ce
cas, on ne peut espérer de paix durable qu’en le forçant à
désarmer et à ne garder que le nombre de troupes propor
tionnées à l'étendue et à la richesse du pays qu’il possède.
Mais, après la faute qu’on a faite de souffrir qu’il s’enflât et
se fortifiât outre-mesure, til n'est plus question de savoir ce
qu'on doit penser; la difficulté consiste à prendre des partis
si sages et si justes qu’on puisse se flatter de le rembarrer
sûrement dans ses limites ».
La lettre continue encore sur le même ton pendant une
grande page.
Je pourrais vous citer encore telle lettre sur les empiète
ments du Parlement, la faiblesse de l’autonité royale, l’incu
rie des ministres, digne des plus belles pages de l’Esprit des
Lois, dans laquelle il montre une singulière prescience de
l'avenir; telle autre où il expose avec une grande compassion
la misère dans laquelle la guerre de la succession d’Autriche
a plongé les campagnes, celles du Périgord entre autres. Je
ne veux pa3 abuser.
Mais ce n’est pas tous les jours que le chevalier s'occu
pait de politique étrangère ou intérieure; et son principal
souci était, maintenant que l’âge était arrivé, après celui de
plaider — car Périgourdin de race comme il était, vous ne
voudriez pas qu’il n’eût pas été plaideur — celui de se bien
porter.
« Il gèle bien serré depuis quelques jours, mon cher bail
li, et. nous voila claquemurés. Quel remède à cela ? Faire
grand feu et boire du meilleur, suivant le précepte du bon
Horace; puis nous jouons au volant et nous dansons. —
Gomment 5 noos ? — Qui, mon bailli, car je danse aussi.
Mme de Nanthiac et mes nièce# me font trotter et me traînent
autour' de la salle et disent après que j’ai fort bien dansé.
�— 21 —
L’après-dîner, j’ai d’autres occupations... Je cause avec mon
petit neveu qui a trois ans et quanti il est ennuyé de ma con
versation, je le porte sur tries épaules à la chèvre morte et
nous prenons tous deux un grand plaisir à cet exercice; en
fin je fais aller les soufflets de la forge et tourne la roue du
chevalier de Ribérac (son frère) quand il travaille. C’est sur
tout. dans ce dernier article que j’excelle. C’est là mon vrai
talent. En un mot, je me remué et cet exercice empêche que
je ne m’engourdisse tout fi fait. Mon premier objet, c’est de
me bien porter...»
Evidemment ! Mais le chevalier d’Aydie était un gros
mangeur et un fin gourmet et à ce régime où les truffes et
les foies d’oie tenaient, sans doute, une trop large part, il
avait gagné de devenir parfaitement goutteux. Et c’est d’un
accès de goutte qu’il mourut, en revenant de la chasse, au
château de Mayac, le 13 janvier 1761.
Il fut enterré le lendemain dans l’église de la paroisse.
***
Tel fut le chevalier d’Aydie, dont je vous ai conté la vie
aussi brièvement que possible et, avec, je dois l'avouer, pas
sablement de coupures. Je serais heureux si tout lacunaire
qu’ait été mon récit, notre héros restant pour vous en même
temps qu’un personnage assez représentatif de l’ancien ré
gime, un compatriote dont nous devons garder quelque fierté
et dont il y aurait quelque injustice à ne se souvenir qu’au
titre exclusif de ses amours.
Sully Prudhomme, à la fin de sa vie, ne dissimulait plus
son agacement à n’être resté pour tout un public que l’auteur
du Vase brisé. J’imagine que le chevalier d’Aydie, s’il reve
nait parmi nous, montrerait, quelque humeur à ne se voir
nommé que l’amant de la belle Aïssé.
Voulez-vous que je vous livre toute ma pensée ? Eh ! bien,
je crois volontiers que le chevalier d’Aydie ne fut libertin que
par exception et au début de sa carrière seulement. Voyez
comme sa passion pour Aïssé s’accommodait de visites espa
cées. Comment concilier cela avec un tempérament excessif ?
Le chevalier d’Aydie m’apparaît sinon comme un modèle de
chasteté, du moins comme ayant été excessivement modéré
dans le péché. Et comme cela explique qu’il ait pu prendre
non seulement son parti de la vie si réglée qu'il mena en
Périgord, mais encore l'aimer, chose au premier abord si
surprenante.
Et qui sait encore si ce n’est pas cette réputation aga
çante qu’il voulut fuir et si ce n’est pas là le secret de ce
�— 22 —
silence hermétique qu’il garda sur sa maîtresse f On n’y a
pas pensé et j’avoue que cette idée ne m’est venue que lors
qu’il était trop tard pour changer le plan de ma conférence.
Elle mérite d’être creusée.
Car, enfin, il fut bien autre chose que cet amoureux !
Ce n'était évidemment pas le premier venu celui qui pou
vait compter, au nombre de ses admirateurs ou de ses amis,
les plus belles intelligences du temps : Voltaire, Montesquieu,
Buffon, l’anglais Bolingbrdke, d’Alembert et les encyclopé
distes, Mme du Deffand, Mme de Créquy, le président Hainault et, enfin, son intime, le bailli de Froullay, que la reine
de France avait remarqué, dont le dauphin demandait assi
dûment des nouvelles, en qui ce même bailli de Froullay avait
une telle confiance, bien qu’il se dénigrât à plaisir, qu’il lui
proposait une mission diplomatique (qu’il refusa d’ailleurs),
quatre ans avant qu’il mourût.
S’il eut voulu rester à Paris, il est à peu près sûr qu’il
eût joué un rôle de tout premier plan dans les affaires de
l’Etat. Il en avait l’envergure. Mais il ne le voulut pas. Il
préféra une vie retirée en Périgord à une vie agitée aux ar
mées ou laborieuse dans les conseils du roi. En un mot, il
préféra être son maître à la servitude dorée qui eût pu être
la sienne et pouvoir dire avec Sénèque, le philosophe, dont
il avait pris cette phrase pour devise : « Inescimabile bonum
suum esse » . Inestimable bien que d’être son maître. Fut-il
sage ? Ne le fut-il pas ? Je vous laisse le soin de répondre i
la question.
����